LA DESCENTE CYCLIQUE
John Deyme de Villedieu
« L’an mil neuf cens
nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand Roy d’effrayeur
Resusciter le grand Roy d’Angolmois,
Avant après Mars régner par bonheur ».
Il est, comme on le voit, tout à fait plausible que Michel de Nostre-Dame ait voulu désigner ici la fin juillet de 1999. Mais de quoi s’agit-il en réalité ? Que sont ces grands Rois dont l’un devrait être « effrayant » et dont l’autre serait « ressuscité » ?
Beaucoup ont vu dans ce quatrain la prédiction d’une éclipse solaire. On pourrait dire alors qu’ils n’ont guère abusé de leur perspicacité. Il est vrai qu’une éclipse totale de soleil, selon les calculs, sera visible tout près de Paris en 1999, et plus précisément le 11 août. Il est même vrai, de surcroît, que ce 11 août de notre calendrier grégorien correspondrait, avec un décalage de 13 jours, au 29 juillet du calendrier julien en vigueur à l’époque de Nostradamus. On voit, en passant, combien aurait été précise, plusieurs siècles à l’avance, la détermination de cette date. En revanche, on devine mal quel intérêt pouvait bien avoir le célèbre astrologue à fixer la date de cette éclipse particulière, plutôt que celle de 1961, totale elle aussi, dans le Midi de la France, sans parler des dizaines d’autres, partielles, et cela pour le seul XXe siècle. A moins, bien entendu, que cette éclipse de 1999 ne doive s’accompagner de faits marquants, autrement importants pour le monde que le seul spectacle parisien de l’éclipse en soi.
Que nous apporte alors le « grand Roy d’effrayeur » ? Rien de clair. Certains, par exemple, croient voir là l’intronisation du fameux « Grand Monarque ». Mais comme chacun interprète ce « Grand Monarque » à son goût, nous n’en sommes pas plus avancés. On sait d’ailleurs combien de déformations et d’amoindrissements a dû subir ce qu’il peut y avoir d’authentique dans le thème du Grand Monarque, et R. Guénon considérait toutes ces manoeuvres comme particulièrement suspectes et dangereuses.
Enfin, outre ces étrangetés, il n’est pas rare de rencontrer des divergences formelles entre ce qu’écrit Nostradamus et les observations de ceux qui semblent ne l’avoir pas tous lu avec la même attention, ni sans doute avec la même méthode. C’est ainsi, par exemple, que selon M. Jean-Charles de Fontbrune, les prophéties se seraient arrêtées à la date de 1999. Or Nostradamus déclare lui-même, dans sa Lettre à César, que ses « vaticinations » s’étendent « depuis maintenant jusqu’en l’an 3797 ».
Que croire en tout cela ? D’autant que M. Jean-Charles Pichon, de son côté, conteste la réalité de 1999, date critique fournie par Nostradamus dans son quatrain, et la fait correspondre à 1316, début des grandes épidémies, calamité que traduirait le « grand Roy d’effrayeur », si nous avons bien suivi l’ « exégète » (19), ce dont nous ne sommes nullement certain…
On voit bien, devant ces quelques exemples, que Nostradamus, du fait de ses obscurités ou des interprétations que l’on a voulu en tirer, n’apporte guère de soutien réellement explicite à l’hypothèse d’une fin de cycle en 1999 (20). Du moins ces dernières considérations illustrent-elles de façon adéquate les remarques faites quelques pages plus haut concernant la vanité de certains commentaires de textes prophétiques, ou que l’on prend en tout cas pour tels.
***
2. Nous examinerons maintenant un témoignage célèbre que l’on ne nous pardonnerait sans doute pas de taire, car il « date approximativement un événement retentissant dont la connaissance s’est transmise depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, et qui est susceptible d’éclairer quelque peu notre sujet. Il s’agit de la catastrophe qui mit fin au règne des Atlantes en engloutissant leur île merveilleuse. La source qui nous en informe est actuellement considérée comme un récit légendaire par la plus vaste majorité des « spécialistes » attitrés. Mais la fin, relativement proche, de notre monde n’est-elle pas, elle aussi, considérée comme purement imaginaire ? C’est qu’aujourd’hui, en effet, les gens qui font l’opinion, qui entretiennent et dirigent certains « courants mentaux », n’admettent de différence entre le légendaire et l’imaginaire qu’en ce que le légendaire n’est rien d’autre que de l’imaginaire consacré par les anciennes superstitions (21). Entrons donc dans le légendaire traditionnel, puis voyons dans quelle mesure s’en rapproche ou s’en éloigne le légendaire platonicien ayant trait à l’Atlantide.
Si nous continuons à envisager la date hypothétique de 1999,77 comme désignant la fin de notre civilisation, elle marquerait alors également la fin de la Cinquième et dernière grande Race dont nous sommes, selon toute apparence, les ultimes représentants, malheureusement fort déchus. Cette Race, comme chacune des quatre autres Races du Manvantara, devrait avoir une durée de 12.960 ans, cette durée correspondant à ce que les Anciens appelaient une Grande Année. Si toutes les hypothèses que nous avons admises sont exactes, la quatrième Race aurait été détruite 12.960 ans avant 1999,77, c’est-à-dire en 10.960,23 avant notre ère. Or d’après le récit que Platon prête à Critias, Solon aurait appris, à Sais, d’un très vieux prêtre égyptien, que l’Atlantide s’était effondrée sous l’océan 9.000 ans plus tôt (22). Cette conversation se trouvant ainsi placée, de façon fort approximative mais suffisante ici, au début du 6e siècle avant J.-C., cela situerait la fin des Atlantes, donc de la quatrième Race, vers 9.600 avant notre ère. Ce qui ferait un peu moins d’un millénaire et demi d’écart avec les résultats obtenus lorsqu’on prend en compte les renseignements fournis par René Guénon et les précisions apportées par Michel de Socoa. Cet écart serait-il dû à une imprécision de Solon, ou à une distraction du très vieux prêtre de Sais ? Est-ce la mémoire de Critias qui se trouve fautive, bien qu’il ait appelé à son aide la déesse Mnémosyne avant d’entamer son récit ? Et même s’il se flatte d’avoir appris par coeur, « étant enfant », les manuscrits de Solon (23) ? Rappelons aussi que, selon le dire même de Platon, dans le Timée et le Critias, le renseignement en question semble bien être, à partir des archives égyptiennes, un renseignement de cinquième main (24). Si, malgré cette incertitude, on voulait accepter les 9.000 ans précis du récit platonicien tout en tenant compte des durées cycliques transmises par René Guénon, la fin de notre Manvantara, ou cycle humain, devrait être reportée de 1.999 à (12.960 - 9.600 =) 3.360 environ, c’est-à-dire presque jusqu’à la moitié du quatrième millénaire après J.-C. Ce qui accorderait encore à l’espèce humaine plus d’un millénaire de vie et de continuels « progrès » !
En vérité, cette prolongation ne nous paraît guère vraisemblable. Les hommes, nos contemporains, si l’on en juge d’après les talents qu’ils exhibent sans vergogne, ne peuvent pas être bien loin de leur terme. Ils ressemblent trop au portrait que s’accordent à faire d’eux diverses traditions pour les jours de la fin, et cette fin, dès lors, devrait être assez proche. Accorder à des êtres aussi nocifs, aussi résolument meurtriers, encore plus d’un millénaire pour saccager le monde serait faire preuve d’un optimisme vraiment excessif. Et leurs attitudes actuelles, leurs comportements, nous font songer à cette parole des Écritures selon laquelle les temps derniers seraient abrégés, car sans cette décision miséricordieuse, personne, à cause du mal ambiant, ne pourrait être sauvé.
Que ce soit à propos de l’Atlantide ou à d’autres sujets, on a beaucoup discuté les textes de Platon. A tort et à raison, sans doute : cela dépend du point de vue auquel on se place. Il est vrai que pour notre race impatiente le philosophe n’est pas toujours immédiatement clair, car il s’étend parfois sur des détails très concrets qui paraissent inopinés dans leur contexte, ou se lance dans de longues considérations que l’on est tenté de prendre pour des digressions. Il est également vrai qu’en bien des cas on a sous-estimé et peut-être désapprouvé l’étendue de son humour. Or l’humour n’est qu’une certaine disposition de l’esprit qui ne saurait lui retirer son sérieux qu’en apparence, mais qui risque de déconcerter. Et lorsque ce sont des mythes qui sont ainsi présentés, on comprend qu’aient pu être induits en erreur des lecteurs modernes, réfractaires à tout symbolisme, et prompts, de ce fait, à croire que Platon se moque ou s’amuse. Peut-être s’amuse-t-il en effet parfois dans le ton qu’il adopte, mais sans doute veut-il aussi, et avant tout, instruire en amusant. Ce qui n’est pas pareil.
Nous pensons, pour notre part, sans prétendre à plus de crédit que n’en mérite notre médiocre compétence, que Platon, essentiellement philosophe dans ses écrits (25), et qui ne nous semble guère y avoir voulu faire oeuvre d’ « historien », comme certains se l’imaginent pourtant, a surtout profité du mythe atlantidien pour faire de l’île mystérieuse le séjour d’un peuple dont il présente la carrière comme un modèle à considérer sous les rapports les plus opposés, et dont le contraste est particulièrement saisissant. Tout d’abord, il s’agissait d’un modèle à suivre, aussi longtemps que ces gens restèrent les dignes fils de Poséidon. « Tant que la nature du dieu se fit sentir suffisamment en eux, ils obéirent aux lois et restèrent attachés au principe divin auquel ils étaient apparentés. Ils n’avaient que des pensées vraies et grandes en tout point, et ils se comportaient avec douceur et sagesse (…). N’ayant d’attention qu’à la vertu (…), ils n’étaient pas enivrés par les plaisirs de la richesse et, toujours maîtres d’eux-mêmes, ils ne s’écartaient pas de leur devoir ». Aussi leur prospérité ne faisait-elle que s’accroître. Mais finalement, d’édifiant qu’il était, leur comportement devint odieusement exemplaire. En effet, « quand la portion divine qui était en eux s’altéra par son fréquent mélange avec un élément mortel considérable et que le caractère humain prédomina (…), ils se conduisirent indécemment (…), tout infectés qu’ils étaient d’injustes convoitises et de l’orgueil de dominer. Alors le dieu des dieux, Zeus (…), résolut de les châtier pour les rendre plus modérés et plus sages » (26).
Ce récit est tout à fait conforme à ce que l’on trouve dans d’autres traditions concernant la dégénérescence fatale qui guette les hommes, les ronge, et dont la conséquence est toujours, selon l’ampleur du cycle en question, la fin de leur peuple, celle de leur Race, ou même, enfin, celle de toute leur espèce. Un tel aperçu des choses, à défaut d’être optimiste, comme le souhaiteraient sans doute nos modernes contemporains (27), montre tout au moins que Platon, d’après les termes et les images mêmes qu’il utilise ici et ailleurs, n’ignore pas les caractères fondamentaux de la doctrine cyclique et de ce qui s’y rapporte. Cela nous est déjà une bonne raison pour prêter attention à « son » mythe, et ne pas croire, comme bien d’autres, qu’il a purement et simplement tout inventé pour le seul plaisir de nous exposer une fois de plus ses théories sociales.
Il est encore une chose qui nous incite à croire que Platon, loin d’avoir inventé, s’est contenté de transmettre. La source égyptienne nous paraît tout à fait plausible, et même si Proclus (28) n’en apportait pas le témoignage, nous persisterions à n’y voir rien d’impossible. Mais nous pensons surtout que Platon, comme bien d’autres Grecs avertis, devait, concernant les cycles, disposer de sources géographiquement plus proches que l’Égypte. Dans un cas comme dans l’autre, il n’avait donc nul besoin, quant au fond du problème, d’avoir recours à son imagination. Ce qu’il ne nous semble pas avoir inventé, en tout cas, bien qu’il puisse y avoir plus d’un doute sur son exactitude, c’est sa « datation » du cataclysme. Cette datation, il est vrai, nous la trouvons « incertaine ». Mais quelle datation ne l’est pas, s’agissant d’époques aussi reculées ? Certes, l’écart de plus d’un millénaire avec notre propre « datation », plus plausible croyons-nous, n’est pas sans laisser perplexe. On pourrait peut-être, pourtant, risquer ici une explication pour atténuer cette perplexité.
Selon Platon (29), dont les explications, par ailleurs, nous paraissent correspondre sensiblement aux réalités géographiques actuelles, l’île de l’Atlantide était véritablement immense. « Plus grande que la Libye et l’Asie réunies », au sens de l’époque, elle constituait à elle seule, dans l’Atlantique, un continent d’importance équivalente, sinon même quelque peu supérieure, à celle de l’actuel continent australien. Son engloutissement « dans l’espace d’un seul jour et d’une seule nuit néfastes », s’il faut l’admettre dans sa brutale soudaineté, a dû marquer les esprits d’une façon durable. Mais une telle catastrophe a-t-elle pu être datée avec toute la précision souhaitable au cours de la période de trouble et d’incertitude qui suit toujours la fin d’un cycle, quelque partiel qu’il soit ? N’en résulte-t-il pas une certaine obscurité, une certaine perte de conscience qui, à son moindre degré d’importance cosmique, est pourtant à l’image du sandhya, cet intervalle entre deux grands cycles, ce « passage par le non-manifesté », comme l’écrivait René Guénon ?
Il reste finalement que cette « erreur » d’un gros millénaire sur une période de près de 11.000 ans n’est pas assez importante pour ruiner le récit de Platon dans l’usage que nous en avons fait, et permettre de l’écarter sans plus de scrupule. Tout ce que nous avons examiné de ce récit, dans ses lignes essentielles, paraît correspondre à des données traditionnelles. Comme en bien d’autres endroits de ses dialogues, le philosophe, c’est plus que vraisemblable, a dû, sans sacrifier son sujet du moment et sans abandonner non plus tout humour ni toute malice, rappeler au passage une civilisation ancienne dont il avait connaissance, mais sans pour autant pouvoir, ou vouloir, en donner des détails plus précis, notamment quant à la date qui marqua sa fin (30).
Sous couvert de ce que l’on appelle l’ « utopie platonicienne », et que, dans une émission des « Lundis de l’Histoire », le 6 mai 1985, sur « France Culture », M. Emmanuel Le Roy Ladurie qualifiait, facétieusement peut-être, d’ « utopie communiste », il nous paraît évident que nous sont transmis au contraire divers éléments d’une doctrine ancienne et respectable. La forme « utopique » a-t-elle été délibérément choisie par le philosophe parce que plus attrayante et plus propice au badinage ? Certains commentateurs, de leur coté, ne voient-ils pas et ne veulent-ils pas faire voir, dans cette « utopie », un simple tissu de rêveries irréalisables ? Mais ne seraient-ce pas plutôt les utopies modernes qui seraient purs mirages ? Pourquoi ne pas admettre que ce terme désigne tout simplement, comme l’indique son étymologie, quelque chose qui n’est plus en aucun lieu, qui n’était déjà plus en aucun lieu du temps même de Platon, mais dont la réalité, à sa manière, s’était affirmée quelque part en une époque depuis longtemps révolue ?
M. François Châtelet se demande,
vers la fin de son Platon, si le philosophe avait l’espoir
d’influer, à travers son oeuvre, « sur le destin effectif de ses
contemporains ». Et la réponse, poursuit l’auteur, se trouve dans La République, où Socrate « déclare qu’en tout état de cause,
si le modèle de la Callipolis n’est pas applicable politiquement, chacun a au moins la possibilité
d’en user pour régler sa conduite personnelle ». Or le mythe d’Er,
qui suit, et que M. François Châtelet interprète à sa manière,
pourrait, pensons-nous, laisser entendre que toute acquisition de la
doctrine est susceptible d’apporter une aide précieuse, sinon pour
tous, en ces temps de dégénérescence athénienne, du moins pour quelques-uns,
et notamment dans une existence ultérieure. Voilà pourquoi, dit-on,
il vaut mieux éviter de boire trop d’eau du Léthé.
c) Une cyclologie salutaire
1. On voit, par les quelques exemples que nous avons tenu à citer, combien sont aléatoires, parfois, les spéculations sur les dates réelles des cycles. C’est pourquoi, sans qu’il soit interdit, bien au contraire, de se poser certaines questions, il est sage d’observer beaucoup de circonspection dans la façon de traiter les réponses, qu’il s’agisse de celles que l’on nous propose ou de celles que nous formulons à partir de nos propres réflexions.
On a critiqué, à propos des cycles et des considérations qu’ils entraînent, certaines attitudes plus ou moins fatalistes (31). Ce que l’on entend par là dénoncer, pensons-nous, c’est une prédisposition à la passivité menant à l’acceptation de toute chose, sans aucun discernement, ni la moindre velléité de réaction d’ordre mental ou psychique. C’est bien là du fatalisme, en effet, que dissimule parfois un optimisme béat, parfois une résignation muette, et dont on ne saurait trop dénoncer les effets nocifs. Malheureusement avec fort peu de chances de succès, car c’est une attitude d’esprit tout à fait commune depuis très longtemps, et qui, à notre époque d’indolence affective, d’engourdissement cérébral, d’avachissement généralisé, ne cesse de se développer et de se répandre victorieusement dans toutes les couches de la population, et jusque dans des milieux où l’instruction, la culture, voire la réflexion, ne devraient pas être de vains mots. Curieux individus que nos contemporains, plus ou moins convaincus de disposer à leur gré de leurs personnes et de leurs destinées ! Certes, ils se déplacent partout sans pratiquement aucune entrave, mais tout en se rendant compte assez confusément de la dépendance qu’entraînent leurs ressources réduites et leurs libertés rognées, ils semblent parfaitement ignorer qu’ils ne font jamais rien d’autre, à leur travail ou dans leurs loisirs, que ce que l’on a décidé qu’ils feraient. Or, les manipulations dont ces gens sont victimes, sur toute la planète aujourd’hui, ne s’arrêtent pas à diverses stratégies économiques ou à des manoeuvres d’assujettissement. On les mène en fait vers le génocide généralisé et définitif, souvent même sans que le crime paraisse profiter à personne vraiment (32).
Les quelques rares contemporains dont on n’a pas réussi à « laver » le cerveau, restent saisis mais impuissants devant cette absence d’esprit critique, cet asservissement, ce grégarisme qu’exploite, et qu’explique d’ailleurs, en notre monde pourtant imbu d’égalitarisme, la caste « seigneuriale » qui en tond les troupeaux. Comment comprendre cette inertie de l’âme, cette apathie profonde, ce renoncement au moindre sursaut, toute cette étrange léthargie qu’interrompent seulement de temps à autre les besoins matériels les plus âcres et les plus communs ? Comment admettre, jusque sur le plan social le plus primaire, ces démissions en chaîne de malheureux financièrement surimposés, honteusement assistés, grugés ? Tout cela ne brosse-t-il pas un tableau peu flatteur du prétentieux homme moderne, un tableau assez lugubre en vérité ? Et nous n’en exceptons évidemment pas les malins de la nouvelle caste « seigneuriale » dont plus d’un, sorti du troupeau bêlant, en a cependant conservé la mentalité envieuse, cupide, et, devant l’électorat, l’esprit servile. Comment, alors, de telles masses, exploiteuses ou exploitées, toutes sous hypnose dirait-on, échapperaient-elles, les unes à la négation, les autres au fatalisme qui, en dépit de toutes les mises en garde, semblent bien devoir résulter seuls de toute intrusion plus ou moins profane dans les questions de cycles ?
Nous ne saurions entreprendre ici de montrer en quoi la fatalité peut intervenir dans la vie humaine sans pour autant être fatale. D’autres l’ont fait, bien avant nous, et non des moindres (33). Nous nous contenterons, quant à nous, de répéter ce que nous disions un peu plus haut. La fatalité ne frappe les individus que dans la mesure où ils s’y prêtent eux-mêmes par leur passivité, par leur docilité à suivre toutes les injonctions du Destin sans vouloir prêter l’oreille à la voix intérieure qui leur dit de n’en rien faire. Il n’est que trop facile de se laisser aller à la pesanteur, à la nonchalance, à l’hébétude qui annihilent peu à peu la volonté intime et personnelle. Au contraire, il faut se dresser, faire violence à nos instincts les plus primaires qui nous tirent vers le bas, car, on nous l’a dit, c’est par la violence que l’on conquiert les cieux. Tel n’est-il pas d’ailleurs le sens véritable de la « grande guerre sainte » ? Mais en quoi cela pourrait-il encourager ou tout simplement intéresser une race matérialiste dont les seuls appétits la portent à satisfaire avant tout les besoins et les caprices du corps, ce conglomérat d’atomes si vite appelé à se défaire ?
L’attitude fataliste, insouciante ou passive, qui est celle de trop de gens devant les événements de la vie la plus courante, se voit naturellement adoptée aussi devant les révélations de la cyclologie où l’enchaînement des époques et des faits peut paraître inéluctable (34). Or, là encore, s’il est une certaine inéluctabilité des choses, il est pourtant une grande part de liberté dévolue aux hommes. S’ils renoncent à s’en prévaloir, par insouciance ou par mollesse, ils ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes lorsqu’ils tombent sous le joug du sort. Il faut retirer des mouvements et des soubresauts de l’histoire ce qu’ils peuvent nous enseigner, et modeler notre attitude intérieure d’après cet enseignement, au lieu de laisser aux circonstances le soin de le faire.
Autre chose, enfin, est à prendre en considération, c’est que, derrière ce que nous appelons parfois un mal, peut se cacher un bien dont nous aurions le plus grand tort de ne pas tirer parti, ou de ne pas nous réjouir. Aussi devons-nous rester vigilants devant le « double aspect ‘bénéfique’ et ‘maléfique’ sous lequel se présente la marche même du monde, en tant que manifestation cyclique (…). D’un côté, si l’on prend simplement cette manifestation en elle-même, sans la rapporter à un ensemble plus vaste, sa marche tout entière, du commencement à la fin, est évidemment une ‘descente’ ou une ‘dégradation’ progressive, et c’est là ce qu’on peut appeler son sens ‘maléfique’ ; mais, d’un autre côté, cette même manifestation, replacée dans l’ensemble dont elle fait partie, produit des résultats qui ont une valeur réellement ‘positive’ dans l’existence universelle, et il faut que son développement se poursuive jusqu’au bout, y compris celui des possibilités inférieures de l’‘âge sombre’, pour que l’‘intégration’ de ces résultats soit possible et devienne le principe immédiat d’un autre cycle de manifestation, et c’est là ce qui constitue son sens ‘bénéfique’ ». Il ne faudrait d’ailleurs pas croire que ces deux points de vue soient « en quelque sorte symétriques », car, en réalité, le « maléfique » n’a rien que de « transitoire », alors que le « bénéfique » possède « un caractère permanent et définitif ». De fait, il n’y a même plus là aucune corrélation, car seul demeure « ce qui est, et qui ne peut pas ne pas être, ni être autre que ce qu’il est » (35).
***
2. Nous avons mis en garde contre certains excès dans la crédulité et l’acceptation passive de tout ce qui se dit ou s’écrit, mais nous n’avons pas entendu nier la réalité de bien des choses, ni même, comme on vient de le voir, leur intérêt. Si la doctrine des cycles, par exemple, représentait un savoir nuisible, elle n’aurait jamais vu le jour dans les temps anciens, car, à l’inverse des nôtres, ils étaient respectueux de la santé mentale et spirituelle des hommes. Si certaines datations risquaient en elles-mêmes d’être néfastes, nous doutons fort qu’un homme comme René Guénon ait pris, quant à lui, la responsabilité de fournir tel indice pouvant conduire quelqu’un à la découverte d’une date précise, hypothétique certes, mais indicative d’une présumée « fin des temps ». C’est du reste, on l’a vu, ce qu’a fait Michel de Socoa en proposant 1999.
Sans même essayer de dater les événements avec une trop grande précision, ce qui ne présente guère d’intérêt qu’historique, il est des hommes « qui ont gardé, avec le dépôt de certaines connaissances traditionnelles, les notions permettant de reconstituer la figure d’un ‘monde perdu’, aussi bien d’ailleurs que de prévoir ce que sera, tout au moins dans ses grands traits, celle d’un monde futur ». En effet, « en raison même des lois cycliques qui régissent la manifestation, le passé et l’avenir se correspondent analogiquement, si bien que, quoi qu’en puisse penser le vulgaire, de telles prévisions n’ont pas en réalité le moindre caractère ‘divinatoire’, mais reposent entièrement sur ce que nous avons appelé les déterminations qualitatives du temps » (36).
Que de telles connaissances aient été, et soient encore, à la disposition de ceux qui en sont dignes, il n’en faut pas douter. Sinon, comment expliquer que l’on rencontre dans des textes passablement anciens, les Purânas par exemple, une peinture si étonnamment caractéristique des moeurs et de la civilisation de nos contemporains ? Sur une échelle plus vaste, d’ailleurs, il est encore des yogîs, pensons-nous, dont l’esprit « voyage » dans d’autres « mondes planétaires » passés et futurs.
Il est certaines lois cycliques, les plus intéressantes sans doute sous le rapport de la succession et de la « couleur » des diverses phases du temps, qui permettent de comprendre la doctrine dans ce qu’elle a de plus essentiel. Il en est d’autres, aussi, dont les précisions numérales permettent de projeter les résultats précédemment obtenus dans diverses périodes de l’Histoire et dont l’application autorise ainsi de nombreux rapprochements instructifs, soit que ceux-ci fassent apparaître des ressemblances entre des cycles de même parenté qualitative et s’éclairant alors mutuellement, soi qu’ils montrent au contraire des différences dues à la progression irréversible du temps, illustration de l’adage selon lequel on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve.
Quoi qu’il en soit, René Guénon, nous l’avons vu, avant même de fournir en 1937 ses premières informations assez détaillées sur « la doctrine des cycles cosmiques », avait déjà donné dès 1931, dans une simple note, la précision qui devait permettre à Michel de Socoa d’avancer la date « fatidique » de 1999. Certes, la précision consentie ne désignait que « le point de départ d’une ère connue », sans plus d’éclaircissements sur cette « ère ». Mais enfin, il est bien évident qu’elle autorisait des recherches plus sélectives, et le choix de Michel de Socoa, loin de manquer de vraisemblance, était au contraire tout à fait prévisible. N’en est-on pas alors induit à supposer, à admettre même, que René Guénon avait dès 1931, puis en 1937, d’excellentes raisons pour se départir de certaines réserves dans lesquelles il s’était jusque là tenu ? Et n’est-il pas tentant, aussi, de s’interroger sur la nature de ces raisons ?
Il semble, comme l’observe M. Jean Robin, que ce soit pour répondre aux sollicitations d’Ananda K. Coomaraswamy, qu’en 1937, « Guénon se résolut à traiter la question des cycles cosmiques ». Il en exposait déjà les difficultés en 1936 dans une lettre à son correspondant d’Amérique où l’on trouve d’intéressants détails (37). Mais ne peut-on penser aussi que des raisons moins personnelles l’engageaient à se prononcer enfin de façon plus explicite sur cette importante question ? Et même, n’étaient-ce pas déjà ces raisons qui lui avaient dicté sa brève mais capitale révélation de 1931 ?
Ce qui ne fait aucun doute, c’est que le tournant des années 30 s’est avéré particulièrement sinistre (38). Dès 1929, la crise éclate presque simultanément en Europe et en Amérique. Elle est tout à fait générale, touchant les secteurs économique, social, politique, diplomatique, et l’on pourrait même parler d’une véritable crise de notre civilisation, crise qui conduisit à la Seconde Guerre mondiale (39). Il suffit de lire l’histoire de l’époque en question pour reconnaître que l’épithète de sinistre s’applique bien, en effet, à l’ensemble de ces masses moutonnières dont les troupeaux, comme saisis du tournis, se précipitent d’eux-mêmes vers l’abattoir. De fait, on pourrait voir là le modèle d’une déliquescence dont nous subissons présentement le reflet amplifié, non pas dans sa durée, certes, qui ne peut qu’être réduite, mais sous le rapport de l’intensité et de la densité événementielles (40).
Cette dégradation des choses a-t-elle compté dans les raisons qui ont pu pousser Guénon à faire en 1937 le tableau qu’on sait de la descente cyclique, à en expliquer les causes et le mécanisme vivant, ou même, déjà en 1931, à en « dater » un des accidents majeurs, fût-ce avec discrétion et mystère ? Ces révélations ne s’adressaient-elles pas à ceux qui, animés d’un légitime désir de comprendre, se voyaient ainsi pourvus d’éléments susceptibles de leur faciliter l’interprétation très approchée des circonstances dans lesquelles ils se trouvaient pris ? Faut-il voir, même, dans ces démarches assez nouvelles, une intention d’alerter les quelques rares esprits capables de mesurer l’urgence qu’il y avait à réagir ? Mais de quelle réaction ? Sans vouloir parler d’inéluctabilité absolue, la descente cyclique, pour ceux qui la comprennent et l’admettent, n’est-elle pas terriblement déterminée ?
Cependant, comme nous le disions plus haut, il convient de se défaire de toute attitude fataliste, de ne pas s’abandonner à un optimisme aveugle ni à une morne résignation. Il est vrai qu’il existe un certain déterminisme des choses, mais il est loisible à l’homme, dans le cadre assez large de ce déterminisme, d’avoir recours à son libre arbitre. Nul n’est tenu de consentir aux événements ni aux « courants mentaux » que suscitent les « puissances infernales ». Sans doute le spectacle n’est-il pas réjouissant d’un monde qui se meurt dans de laides convulsions, mais n’y a-t-il pas toujours intérêt à prendre conscience de ce qui se passe pour en limiter l’incidence, ou du moins pour en transformer l’impact sur nous-mêmes et sur d’autres ? Quand une civilisation se décompose, que gagnerait-on à fermer les yeux ? Une observation calme et détachée des situations permet de les apprécier à leur juste valeur, d’en comprendre les causes et, même s’il est trop tard pour remédier à ces situations et les modifier de façon quelque peu appréciable, il est du moins possible de réformer une mentalité fautive, responsable de notre déchéance, et ainsi d’avancer d’un cran, à force de contrition véridique et de vigilance, vers une spiritualité dont les fruits se retrouveront plus tard, « ailleurs », dans des « futurs » dont le mystère est aujourd’hui insoupçonnable.
Dès 1927, René Guénon n’avait pas manqué de nous avertir des résistances que nous serions appelés à rencontrer. « Nous entrons, disait-il, dans un temps où il deviendra particulièrement difficile de ‘distinguer l’ivraie du bon grain’ », et ce ne seront pas les secours illusoires des « savoirs » modernes qui pourront nous tirer d’embarras. Ni les « subtilités dialectiques » de quelque philosophie que ce soit, ni les « vérités » scientifiques chères aux scientistes, n’apporteront autre chose que des « causes d’égarement » et l’occasion d’efforts « dépensés en pure perte », réduisant ainsi à néant tout désir de réaction saine et sincère.
« Ceux qui arriveront à vaincre tous ces obstacles, et à triompher de l’hostilité d’un milieu opposé à toute spiritualité, seront sans doute peu nombreux ; mais (…) ce n’est pas le nombre qui importe, car nous sommes ici dans un domaine dont les lois sont tout autres que celles de la matière. Il n’y a donc pas lieu de désespérer ; et, n’y eût-il même aucun espoir d’aboutir à un résultat sensible avant que le monde moderne ne sombre dans quelque catastrophe, ce ne serait pas encore une raison valable pour ne pas entreprendre une oeuvre dont la portée réelle s’étend bien au-delà de l’époque actuelle », car « rien de ce qui est accompli dans cet ordre ne peut jamais être perdu » (41).
Cette « oeuvre », cette « réaction »,
auxquelles René Guénon nous convie, nous pouvons tous y participer,
dans la mesure de nos forces, de nos moyens, de nos aptitudes, et aussi
dérisoire que puisse nous paraître la moindre victoire intérieure
sur l’ « ennemi », elle n’en sera pas moins un pas en avant, que
d’autres pas compléteront bientôt, dans la longue voie universellement
rédemptrice de la « grande guerre sainte ».
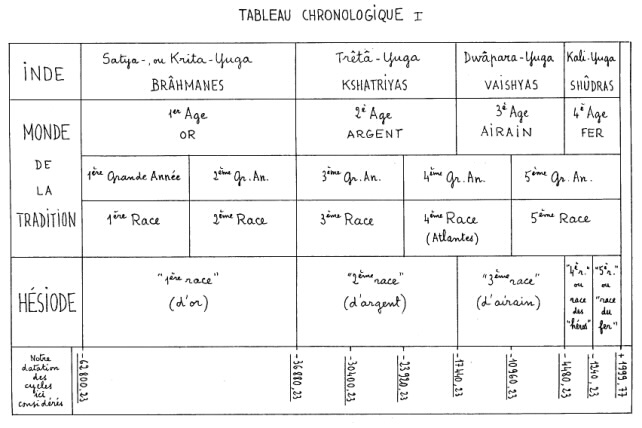
a) Le tournant du quatrième Age
1. « D’or fut la première race d’hommes périssables que créèrent les immortels, habitants de l’Olympe ». C’était au temps de Cronos. Puis fut créée la race d’argent. Et Zeus créa une troisième race, celle de bronze. Tout était de bronze, « car le fer noir n’existait pas » (42).
Après que se furent écoulées, au gré de la descente cyclique, les trois premières races de notre humanité, Zeus, poursuit Hésiode, « en créa encore une quatrième (…), race divine des héros que l’on nomme demi-dieux ». Ils périrent à leur tour, « les uns devant les murs de Thèbes aux sept portes (…), les autres (…) à Troie »… Et, se plaint alors le poète grec, « plût au ciel que je n’eusse pas à mon tour à vivre au milieu de ceux de la cinquième race (43), et que je fusse ou mort plus tôt ou né plus tard. Car c’est maintenant la race du fer. Ils ne cesseront ni le jour de souffrir fatigues et misères, ni la nuit d’être consumés par les dures angoisses que leur enverront les dieux. Du moins trouveront-ils encore quelques biens mêlés à leurs maux. Mais l’heure viendra où Zeus anéantira à son tour cette race d’hommes périssables : ce sera le moment où ils naîtront avec des tempes blanches. Le père alors ne ressemblera plus à ses fils, ni les fils à leur père ; l’hôte ne sera plus cher à son hôte, l’ami à son ami, le frère à son frère, ainsi qu’aux jours passés. A leurs parents, sitôt qu’ils vieilliront, ils ne montreront que mépris ; pour se plaindre d’eux, ils s’exprimeront en paroles rudes, les méchants ! et ne connaîtront même pas la crainte du ciel. Aux vieillards qui les ont nourris ils refuseront les aliments (44). Nul prix ne s’attachera plus au serment tenu, au juste, au bien : c’est à l’artisan de crimes, à l’homme tout démesuré qu’iront leurs respects ; le seul droit sera la force, la conscience n’existera plus. Le lâche attaquera le brave avec des mots tortueux, qu’il appuiera d’un faux serment. Aux pas de tous les misérables humains s’attachera la jalousie, au langage amer, au front haineux, qui se plait au mal. Alors, quittant pour l’Olympe la terre aux larges routes, cachant leurs beaux corps sous des voiles blancs, Conscience et Vergogne, délaissant les hommes, monteront vers les Eternels. De tristes souffrances resteront seules aux mortels : contre le mal il ne sera point de recours ».
***
2. Dès l’abord, il est une possibilité qu’il convient d’écarter. Même si Paul Mazon, dans sa traduction, utilise l’expression de « cinquième race », ce n’est pas, comme on pourrait le croire, de la cinquième et dernière grande Race que veut nous parler Hésiode. Celle-ci correspond en effet à la cinquième et dernière Grande Année, et se développe, de ce fait, non seulement pendant le quatrième Age, mais aussi, déjà, pendant la deuxième moitié du troisième Age. Elle occupe la scène du monde aussitôt après le cataclysme atlantidien, c’est-à-dire depuis 10.960,23 avant notre ère, et jusqu’à la fin des temps. De fait, cinq grandes Races humaines, rappelons-le, se succèdent au cours du Manvantara, chacune dans l’une de ses cinq Grandes Années ; et l’on ne saurait confondre ces Grandes Années, toutes de même durée, avec les quatre Ages que les Anciens assignaient à l’humanité et dont les durées dégressives correspondent aux nombres 4,3,2 et 1 (45).
Il paraît évident que lorsque Hésiode parle de ses trois premières « races », c’est aux générations ayant vécu aux Ages d’Or, d’Argent et d’Airain qu’il se réfère. Pour ce qui est des générations du quatrième Age, traditionnellement nommé « Age de Fer » dans l’Occident ancien, Hésiode y distingue deux groupes la « race divine des héros » et la « race du fer » qu’il désigne comme étant la cinquième. Or selon le texte, quatre « races » seulement sont créées, car le poète ne parle pas de création pour sa cinquième « race ». Cela ne laisse-t-il pas supposer que cette dernière « race » n’est en réalité que le résultat d’une dégénérescence au sein même de la quatrième « race », d’une chute ayant conduit de la « race divine des héros » à la « race du fer » ? Cette nouvelle génération, à laquelle Hésiode regrette d’appartenir, il semble en marquer la dégradation progressive par l’emploi de verbes au futur. Ceci pourrait confirmer qu’en dépit de leur dureté de fer, les hommes, au temps d’Hésiode, ne faisaient qu’amorcer la courbe de leur décadence. Ce n’est que plus tard, d’ailleurs, lorsqu’ils « naîtront avec des tempes blanches », que Zeus anéantira aussi à leur tour les hommes de cette dernière « race ». Comme Poseidon, 12.960 ans auparavant, avait anéanti les Atlantes.
***
3. De ce qui précède il résulte que les deux dernières « races » auxquelles se réfère Hésiode, interviennent toutes deux, selon ses propres explications, dans la seule durée du quatrième Age et ne représentent donc, dans leur totalité, qu’une portion ultime de la cinquième grande Race, et par conséquent ses derniers représentants avant la fin des temps (46).
Ce premier point acquis, il serait intéressant de préciser, dans ce quatrième Age, le moment où la « race divine des héros » disparaît pour céder la place à la « race du fer ». Or la première trouve sa fin sous les murs de Thèbes et à Troie. Sans doute ne sont-ce qu’une image et une datation approximatives que nous propose Hésiode, mais si la « race divine des héros » ne se trouve pas totalement anéantie à Thèbes et à Troie, il est certain que beaucoup de guerriers y sont immolés et surtout qu’ils y tombent dans des guerres fratricides (47). C’est le cas de Thèbes du moins, et comme on peut le supposer exemplaire, c’est sans doute celui de bien d’autres cités à cette époque. Quant à la guerre de Troie, on sait qu’elle est déclenchée par la conduite aberrante du Troyen Pâris qui ne craint pas de violer l’hospitalité de Ménélas, roi de Sparte, en enlevant sa femme Hélène. Si l’on ajoute, à ces divers aperçus d’une « histoire » brumeuse, les exactions commises par les Grecs en Troade, puis chez eux à leur retour, ne semble-t-il pas que tous ces malheurs et ces méfaits, que beaucoup veulent nous présenter comme des fables purement imaginaires, pourraient bien n’être autre chose, en réalité, qu’une synthèse fort significative, et représenter la trace d’une singulière dégradation des moeurs, dégradation qui se produit toujours de façon plus ou moins remarquable à quelque point crucial d’un cycle, qu’il soit grand ou petit ?
Ne reconnaît-on pas déjà, à la lecture de ces récits, homériques ou autres, bien des tares qu’Hésiode reproche à la « race du fer » ? Ne voyons-nous pas déjà, chez les « héros » qu’il glorifie, la dureté de ce métal qui désigne le dernier Age ? N’est-ce pas celle d’Achille et de sa cruelle inflexibilité ? « Ton coeur est de fer », lui dit Hector mourant. Que penser aussi de la haine fratricide, du viol et du meurtre devant les autels ? Ne sont-ce pas là des signes de cette redoutable « démesure » que condamne le poète, et dans laquelle il dénonce la cause de la fin des races ? (48)
Ainsi donc, si l’on en croit ces témoignages « littéraires », il semble bien que la fameuse guerre de Troie marque le tournant de cette époque et que, non seulement dans les circonstances de son déroulement, mais dans celles de l’immédiat après-guerre, fertiles en cruautés, elle atteste la décadence de cette race « héroïque » qu’exalte Hésiode. Certes, ce ne sont là que légendes peut-être, mais l’Histoire et l’Archéologie les ont tant de fois niées avant de se rendre tardivement à l’évidence de leur réalité, que nous prêtons toujours à ces légendes, quant à nous, la plus grande attention.
Nous allons d’ailleurs revenir
plus longuement sur ces récits longtemps considérés par les gens
« crédibles » comme de simples fantaisies poétiques, et nous nous
bornerons pour l’instant à une seule constatation : il semble que
l’on tienne aujourd’hui pour certain que cette guerre dont retentit
toute la littérature grecque, ne peut être que celle qu’ont entreprise
les Mycéniens, et qui s’est achevée par la destruction de la célèbre
ville de Priam (49). L’Histoire et l’Archéologie elle-même en
fixent la chute à l’an 1240 avant J.-C. Il est alors fort significatif
de constater que, dans le schéma cyclique adopté dans notre étude,
la date correspondant au milieu du quatrième Age est celle de 1240,23 avant notre ère.
b) Les « héros » et la « race du fer »
1. Hésiode, en évoquant la guerre de Troie, entend, de toute évidence, en faire un jalon important dans l’histoire grecque. Et si cette guerre, par la grâce d’Homère, a pris des teintes mythiques, il est tout à fait certain aussi qu’elle appartient à l’Histoire. Le tournant décisif que nous décrit Hésiode se trouve en effet marqué, aussi clairement que possible, semble-t-il, dans les grands événements de cette époque (50). La « race divine des héros » qui détruisirent Troie vers 1240 avant notre ère, désigne à coup sûr les Achéens, ces Indo-européens arrivés en Grèce, dit-on, un millénaire plus tôt, puis fondateurs de la brillante civilisation mycénienne quatre siècles avant la guerre troyenne. Quant à l’exécrable « race du fer » que décrit le poète, elle ne semble pouvoir représenter qu’un nouveau rameau des Indo-européens, et ce sont ces « barbares » arrivés moins d’un siècle après la chute de Troie, et qui auraient détruit les grands centres mycéniens, tuant, pillant puis brûlant tout sur leur passage. Si ce n’étaient pas déjà les Doriens, car certains historiens paraissent hésiter à le croire, il semble bien, en tout cas, que cela ait été du moins « le triomphe des épées de fer sur les glaives de bronze dont se servaient encore les Mycéniens », comme l’écrit Pierre Waltz (51). Triomphe du fer, métal « noir », qui ne manque pas de se produire avec assez d’à-propos en ce temps qu’une déjà vieille tradition appelait « Age de Fer », et que l’Inde connaissait comme l’âge « noir » ou « sombre » du Kali-Yuga.
Ceci dit, que savait au juste Hésiode de ces mouvements de l’Histoire, et que voulait-il nous en dire qui ne fût pas plus ou moins nimbé de l’auréole mythique ? Les événements qu’il relate le précédaient d’un demi-millénaire, et bien des précisions avaient dû s’en perdre. On pourrait alors se demander, comme nous le disions plus haut, si les deux « races » dont il nous entretient, et dont il idéalise si manifestement la première tout en dépréciant si sévèrement la seconde, se présentaient au moment de leur rencontre sous des couleurs aussi contrastées.
Cette « race du fer » dont Hésiode critique les excès et qu’il distingue pour cela de la race des « héros », ne se montrait peut-être pas tellement plus dure, plus barbare, que cette dernière en cette période transitoire dont nous parlons et dont elles subissaient toutes deux l’influence « fatidique ». N’appartenaient-elles pas toutes deux à ce même Age que toute l’antiquité a dénommé « Age de Fer » ? Même en tenant compte d’une dégénérescence accélérée en cet Age terminal, peut-on imaginer que l’une de ces « races », à son crépuscule, ait été beaucoup plus « chevaleresque », plus « tendre » que l’autre à son aurore ? Leurs moeurs n’étaient-elles pas tout simplement celles du siècle ? Comme il apparaît clairement dans le tableau proposé plus haut, la race « héroïque » dont Hésiode nous chante les hauts faits, avait entamé sa carrière au début du quatrième Age, et il est évident qu’au bout de plus de 3000 ans, lorsque ses descendants tombaient, « les uns devant les murs de Thèbes (…), les autres (…) à Troie », il s’agissait de guerriers dont les traditions et le comportement s’étaient sans nul doute passablement abâtardis. La rudesse et les sauvages désordres de ces années de transition ne pouvaient guère être l’apanage d’un seul peuple, ni même d’une seule race (52). Les impressions des Troyens qui, de leurs remparts, assistaient au spectacle d’Achille, tout à sa vindicte profanatrice, traînant derrière son char le cadavre d’Hector afin de le déchiqueter ; les sentiments des Troyennes qui, au cours du sac de leur cité, voyaient se précipiter sur elles les Danaens déjà ensanglantés par le massacre (53) ; les impacts enfin de tous ces « hauts faits » étaient-ils bien différents de ceux qu’éprouvèrent, quelques décades plus tard, les populations mycéniennes lorsque fondirent sur elles les envahisseurs, doriens ou autres ?
Bien entendu, la guerre n’a jamais comporté beaucoup de douceurs, mais, n’en déplaise à ses grossiers contempteurs modernes, il arrive toujours un moment, au cours des temps, où le peuple le plus pacifique, pour défendre son intégrité, doit prendre les armes. Alors, il est des manières de combattre qui valent mieux que d’autres parce qu’elles comportent plus de dignité, et c’est pourquoi il existait autrefois des codes, plus ou moins respectés certes, mais qu’aujourd’hui l’on repousse, purement et simplement, au nom d’un confusionnisme criminel (54). Or tous les vrais guerriers (55) savent, et ont toujours su, qu’il est diverses façons de conduire la guerre : les unes sont respectables, glorieuses parfois, voire héroïques, tandis que les autres sont indignes, méprisables et déshonorantes (56). C’est seulement dans les périodes de décadence que l’on fait fi de toute règle. Et sous ce rapport, la guerre de Troie, en plus d’une de ses péripéties, a sans doute inauguré et tout au moins illustré bien des bassesses. Homère, qui en a chanté les gloires ambigus quelque 400 ans après, en avait une connaissance peut-être plus vraie que ce que l’on en veut ordinairement découvrir dans ses « chants ». Un aède historien ? Et pourquoi pas ? N’est-ce pas grâce à lui que Schliemann, contre l’avis et les sarcasmes de tous les spécialistes, découvrit le site de Troie ? Outre l’Histoire, d’ailleurs, telle qu’elle pouvait alors se pratiquer, outre aussi bon nombre de poèmes précurseurs (57), Homère ne disposait-il pas de certaines connaissances traditionnelles, couramment transmises, en son temps, dans les lieux appropriés ? Averti des lois cycliques et sachant qu’il parlait d’une fin de « race », n’en a-t-il pas exposé, en toute connaissance de cause, les travers caractéristiques ?
Or si la fin des « héros » achéens ne se pare guère, en certains épisodes de la guerre de Troie, de couleurs beaucoup plus édifiantes que celles dont s’agrémente le souvenir de l’invasion dorienne quelques décades plus tard, pourquoi Hésiode marque-t-il une telle différence entre les premiers, dont il fait une « race divine », et ceux qui les ont suivis, selon lui malheureux et méprisables ? En quoi ces temps tumultueux, plutôt qu’un simple stade parmi d’autres dans la dégradation des choses, seraient-ils un jalon si déterminant de l’histoire de la Grèce et la limite séparant deux catégories humaines dans lesquelles Hésiode va jusqu’à voir deux « races » distinctes ?
Certes, tout homme, en ces jours anciens, lorsqu’il se reportait au lointain passé, ne le concevait qu’auréolé de grandeur, peuplé de demi-dieux dont on contait les exploits retentissants (58). Et nous sommes tenté de croire qu’au-delà de la guerre de Troie, fait historique dont Homère nous donne une geste poétique, tragique, parfois enrichie de légendaire, tachée d’excès cruels, voire sacrilèges, Hésiode se référait moins à des faits inscrits dans l’Histoire qu’à des traditions immémoriales, plus floues peut-être, pour certaines, mais plus authentiquement glorieuses. Cela pourrait laisser supposer, alors, que le poète, tout en déplorant d’être né dans la « race du fer », savait en même temps que coulait dans ses veines le sang des premiers Achéens. Cependant, pour avoir, avec tant de sûreté dans une époque aussi trouble, situé la fin de sa « race » héroïque au moment des grands combats de Thèbes et de Troie, ne fallait-il pas qu’il eût, après le hiatus historique du XIe siècle, quelque source plus convaincante que ses propres réflexions, mieux fondée aussi que les quelques échos recueillis, sur la place publique, de la bouche de vieillards assoupis, échos retransmis et déformés de génération en génération à partir du témoignage des survivants de ce qui fut, dit-on, un véritable cataclysme ? Comme Homère, Hésiode n’avait-il pas accès aux sources de certains Mystères dont la vérité, fidèlement mémorisée, était en quelque sorte plus authentiquement « historique » que l’Histoire elle-même ?
Quoi qu’il en soit, enfin, des motifs qui ont pu porter Hésiode à procéder à sa sévère dichotomie, nous allons en trouver une confirmation dans ce qui suit : de part et d’autre de 1240,23, cette date transitionnelle que nous avons déterminée dans le Kali-Yuga, se sont effectivement développées deux « races », comme le dit le poète, ou du moins deux civilisations, voire deux phases d’une même civilisation, dont les caractères diffèrent sensiblement, ne serait-ce que dans les résultats respectivement obtenus.
***
2. Si le fer apporte à tout l’ensemble du quatrième Age une signature bien déplaisante, il reste que certaines lois cycliques ont pu, au milieu de cet Age, en laisser apparaître clairement, aux yeux de tous, en en exagérant la violence, le caractère déplorable jusque là sous-jacent et, pour ainsi dire, non encore développé. Ce fut comme le signal d’un tournant, et, sinon comme un gage de violence accrue, du moins peut-être comme un gage de violence plus pernicieuse et dont la perfidie croissante, par la suite, devait en augmenter la malignité. Aussi n’est-il pas surprenant qu’Homère, pour restituer le climat décadent et sauvage de ces temps évanouis, ait mêlé, dans les replis de ces âmes glorieuses qu’il voulait dépeindre, quelques-uns des traits grossiers, brutaux ou malsains dont il voyait ou percevait (59) peut-être autour de lui, trois cents ans après l’invasion dorienne, et comme un souvenir d’elle, des exemples quotidiens. Ces exemples, du reste, il savait bien qu’ils étaient, en temps de paix, une marque plus certaine encore de décadence que les excès dont s’accompagne toujours, par la force des choses, une campagne militaire.
Plus que dans les prouesses extérieures qui, par ces temps de transition et de guerres, devaient se ressembler passablement d’un peuple à l’autre, c’est sans doute dans la nature foncière de ces hommes, dans une certaine manière d’être plus que de faire, que résidait alors la différence, différence dès lors plus difficile à percevoir en cette période transitoire. Le passage de l’une à l’autre de ces deux « races », de ces deux époques, qui se produisit au milieu de l’Age de Fer, ne fut donc pas si soudain quant à ses effets immédiatement visibles. Tout ce tournant du quatrième Age baignait dans une violence généralisée qui sévit pendant quelques décades, davantage même en certaines régions, et qui ne variait guère de l’un à l’autre camp. D’ailleurs, d’une « race » à l’autre, comme nous le disions, ce n’est peut-être pas tant le caractère extérieur des actes perpétrés qui change, mais la raison, l’esprit, la nature, la règle qui les inspirent. On peut massacrer sous l’effet d’une haine pure venue d’une sensibilité outragée, ou par le fait d’une brutalité grossière, fruste, à base d’indifférence et de froideur désinvolte. Ajoutons que ces violences dont l’Histoire, dans le monde égéen, nous fournit des exemples sur plus d’un siècle, témoignent d’un état des moeurs qui, au tournant médian de plus de six millénaires, a bien pu se manifester, en Egéide et ailleurs, pendant plusieurs siècles sans que les historiens en aient toujours relevé des traces formelles.
Ce n’est que l’ordre une fois rétabli, que certains lettrés ont pu mesurer la déchéance culturelle notable survenue entre la « race » précédente et la nouvelle. Encore ne pensons-nous pas que de telles constatations soient nées purement et simplement de la comparaison d’un présent plutôt médiocre avec le souvenir vécu d’un passé plus ou moins glorieux. Hésiode et Homère, nous le savons, ne parlent pas de ce passé par expérience directe, mais par ouï-dire et en tenant compte, très vraisemblablement, des échos qu’avaient pu laisser certaines traditions, non seulement au sujet de la guerre de Troie, où la « race » glorieuse vint plus ou moins finir, mais surtout au sujet des origines de cette « race », plus authentiquement héroïques sans doute. Il est vrai, en effet, qu’au début d’une nouvelle période cyclique, fût-elle celle du Kali-Yuga, il se produit toujours une sorte de redressement, quelque apparence, parfois trompeuse, qu’il puisse prendre. Puis, au fil des siècles et des années, les choses se détériorent et s’aggravent, comme même ont fini par l’admettre quelques-uns de nos contemporains.
Nous parlions plus haut du caractère plus ou moins profond dont la connaissance pouvait seule permettre de distinguer les deux « races » qu’oppose entre elles Hésiode. Mais ce caractère, en réalité, est celui que communique à chacune le « climat » de l’époque où s’écoule sa vie. Et ces deux « races », en fait, n’en sont qu’une seule à laquelle son histoire confère deux caractères successifs au cours d’un mouvement général de décadence que scinde pourtant, en deux phases distinctes, le basculement historique médian que nous étudions. Tout se passe comme si la deuxième « race » recueillait en quelque sorte, des mains de la première, au point où il en était alors de son usure, le flambeau d’une culture où la fumée l’emporte de plus en plus sur la flamme. C’est à un certain degré de dégénérescence de la première « race » que se reconnaît l’entrée en scène de la seconde « race » : le crépuscule de celle-là, dirait-on, côtoie l’aurore de celle-ci, jusqu’à s’y fondre. En fait, ce sont deux mentalités qui se succèdent et se mêlent un instant au cours d’un mouvement uniformément accéléré, et dont l’articulation médiane représente le moment où telle orientation de la pensée, en bout de course, assume une nouvelle direction, comme la solidification du monde, un jour, s’avère être convertie en une dissolution qui paraît la contredire.
Sans doute, nous l’avons vu, le moment du passage de l’une à l’autre de ces mentalités se laisse assez facilement situer après coup dans l’histoire européenne, car il correspond à la transition qui relie et sépare deux vagues successives de la race indo-européenne, celle des Achéens et celle des Doriens. Mais il en va tout autrement lorsqu’on souhaite s’enquérir des particularités respectives de ces deux peuples. Certes, on peut se faire une certaine opinion sur les Doriens, ce que facilite par exemple notre connaissance des Spartiates, leurs descendants les plus purs. En revanche, les Achéens sont bien plus mystérieux. Leurs derniers représentants, les Mycéniens, ont très vite été pénétrés de culture crétoise, et de plus, ce que les spécialistes en savent, croyons-nous, s’appuie à peu près exclusivement sur des vestiges archéologiques. Grande et riche civilisation, certes, que la mycénienne, raffinée même, c’est incontestable, mais que savons-nous de la pureté de leur éthique ? Cela, d’ailleurs, ne nous renseignerait guère sur ce qu’étaient leurs ancêtres achéens, moins raffinés sans doute, mais peut-être beaucoup plus authentiquement exemplaires. Quel pouvait être, chez eux, le caractère profond de la culture ? Leur religion aurait pu y jeter quelque lumière. Or, que nous en est-il parvenu ? L’âge du bronze, dans le monde égéen, rendait partout un culte à la Grande Déesse, comme l’indiquent les statues trouvées dans les ruines des sanctuaires. C’est une information d’ordre bien général, mais cela confirmerait une dominance de la caste guerrière à ces mêmes époques lointaines, ce qui rejoindrait certaines découvertes ou suppositions des historiens. S’agissant de peuples qui, sans aucun doute, vivaient déjà dans le Kali-Yuga, nous nous garderons bien d’en exalter trop naïvement les mérites hypothétiques. En vérité, tout n’est-il pas nécessairement de plus en plus relatif à mesure que l’on s’éloigne du seul Absolu (60) ?
C’est peut-être bien aux premiers Achéens, voire à leurs prédécesseurs, que se référait Hésiode lorsqu’il évoquait, plein de révérence, la « race divine des héros que l’on nomme demi-dieux ». Quant à ceux qui, à leur manière, ont illustré à Troie la période immédiatement prédorienne, ils n’étaient que les derniers de leur « race », comme le laisse clairement entendre le poète, et ils n’étaient sans doute pas si dépourvus de cette dureté de fer que l’on impute à leur Age. Même si l’on fait la part de l’emphase poétique, les récits homériques qui, nous l’avons vu, ne peuvent être pure fiction, sont pleins de rudesse héroïque, certes, mais aussi, parfois, d’une sauvagerie particulièrement haineuse. Les Mycéniens étaient-ils plus civilisés, plus « aristocrates » que les Doriens ? Cela paraît fort probable, mais, encore une fois, que dire de leurs moeurs ? Si l’on songe à la fin tragique des Atrides, au lendemain de la guerre de Troie, il est évident que leurs conceptions de l’honneur étaient devenues passablement sanglantes, dénaturées et que quelque chose de cette violence, à travers le légendaire, correspondait bien avec le moment cyclique désastreux dont nous parlons. La Tradition, d’ailleurs, qui associe le fer à la couleur noire, n’avait-elle pas prévu, dans le quatrième Age, un enténèbrement de plus en plus sinistre au fur et à mesure que s’écoulerait le temps et que l’humanité s’éloignerait de la lumière originelle ?
C’est ainsi que les Doriens, qui sont vraisemblablement « la race du fer » d’Hésiode, étaient, nous dit-on, des barbares terriblement ravageurs, de culture et de moeurs inférieures. Nous voulons bien le croire, en raison de la décadence qui sévit naturellement entre une époque et celle qui la suit. Mais tous les envahisseurs ne sont-ils pas ressentis, par les peuples envahis, comme des barbares, et au sens actuel, péjoratif, du terme ? Quelle invasion, au cours de l’Histoire, s’est-elle jamais produite sans quelque destruction ? Il est vrai qu’à l’actif des Doriens, on a parlé d’un arrêt pur et simple de toute civilisation, d’une sorte de vide culturel prolongé de façon inhabituelle : nous verrons plus loin ce qu’il convient d’en penser.
Il est d’ailleurs un fait significatif à observer ici : les tristes tares dont Hésiode disqualifie sa « race du fer », il n’en parle, à peu près exclusivement, qu’au futur. On pourrait les comparer à celles que prédisent aussi, pour les derniers temps, les anciens textes hindous. Le futur qu’utilise Hésiode laisse entendre que ses contemporains, dont il se plaint pourtant amèrement, n’étaient pas encore aussi dégénérés que ce que la Tradition prévoit pour les jours de la Fin. Les Doriens et leur descendants au temps d’Hésiode, en dépit de leur médiocrité, n’en étaient pas encore là, et rien n’est plus naturel si l’on veut bien tenir compte des règles inéluctables de la descente cyclique.
La « race du fer », qui occupe la dernière moitié du Kali-Yuga, était évidemment beaucoup moins calamiteuse à son origine qu’elle ne l’est devenue de nos jours, à sa fin, après plus de trois millénaires de déchéance.
C’est à ses fruits, dit-on, que l’on reconnaît la valeur de l’arbre. Si l’on se remémore les performances achéennes, plus ou moins légendaires, certes, pendant et après la guerre de Troie, comme d’ailleurs aussi les prouesses doriennes lors de l’invasion qui se produisit ensuite, il n’est pas difficile de les comparer à nos propres exploits aujourd’hui, fruits d’une brillante civilisation dont nos contemporains sont fiers et dont on attribue parfois en partie les origines, après de longues « améliorations », bien sûr, à la culture dorienne. Pour s’en tenir au domaine technique, pierre de touche avec laquelle on juge de nos jours le développement des peuples de l’Histoire, il est certain que la « race du fer » a su multiplier et affiner ses talents. Pour mesurer les progrès de son caractère léthal, par exemple, il suffit de comparer les résultats des guerres anciennes avec ceux des guerres modernes. La puissance destructrice du fer s’est prodigieusement accrue, comme n’a cessé de grandir, en d’autres secteurs que celui de la guerre, l’efficacité industrielle (61). Et le quantitatif, ici, est certainement moins signifiant que le qualitatif. Les Anciens ont détruit sans doute, mais proprement, si l’on peut dire, sans hypothéquer l’avenir, sans ruiner la nature dans ses forces vives. Après leurs guerres, cette nature reprenait son oeuvre inlassable. Or maintenant, en conformité sans doute avec notre mentalité, nous détruisons non seulement avec largesse, mais de façon malpropre : en temps de guerre, avec nos bombes atomiques, et même en temps de « paix », avec toutes nos industries polluantes et dévastatrices, qu’il s’agisse de centrales nucléaires ou de laboratoires chimiques, tous responsables, avec leurs accidents et leurs préméditations, de la mort plus ou moins lente de notre planète. Comme si la sécrétion de poisons spirituels, mentaux et physiques, était l’essentielle raison d’être de la Civilisation moderne. Ainsi donc, celle-ci, comme la plupart des empoisonneuses jadis, mourra brûlée vive. Si sont fondées les prédictions des traditions anciennes.
Après ces dernières observations,
et sans vouloir minimiser la triste signification des tares et des cruautés
antiques, ne serait-on pas porté à admettre que les fruits sont bien
amers qui nous viennent de notre civilisation moderne, héritière partielle
des premiers Doriens et terme sinistre de cette « race du fer » tant
honnie d’Hésiode ? Cette amertume n’est-elle pas le premier symptôme
d’une action toxique mortelle exercée sur l’homme et sur son environnement ?
Poison, d’ailleurs, dont les sciences trouveront sous peu le contrepoison,
comme tiennent tant à nous en convaincre, du moins, les naufrageurs
sans vergogne de l’humanité.
c) Histoire et Archéologie
1. La guerre de Troie, telle que nous la raconte Homère, comporte de toute évidence des aspects légendaires et mythiques. Ne fût-elle que légende (62), elle n’en serait pour nous pas moins significative et instructive (63). Mais en fait, les annales hittites de l’époque semblent bien relater les expéditions militaires des Achéens. Nous y découvrons que sous le règne de Thoudalias III (vers 1263-1225), les Akhaïva (Achéens ?), dirigés par leur roi Attarissias (Atrée ?), tentèrent un débarquement à l’embouchure du Scamandre et furent repoussés par les Hittites. Une génération plus tard, vers 1200, le roi de Mycènes, à la tête de ses guerriers, attaquait Ilion, capitale de la Troade, et finissait, après un long siège, par s’en emparer et la brûler (64).
Ceci dit, que pouvait représenter pour Hésiode la guerre de Troie ? Cinq siècles seulement, nous l’avons vu, l’en séparaient : durée guère moindre que celle qui nous éloigne aujourd’hui de notre Moyen-Age agonisant, et dont l’esprit véritable, on le sait, est si fièrement ignoré, dans leurs ouvrages, par quelques-uns de ceux qui se sont voués à son étude. A l’époque d’Hésiode, la mémoire humaine était-elle plus fidèle que de nos jours ? Plus apte à retransmettre l’âme du passé, au lieu de n’en recueillir que les écorces ? En tout cas, nous pensons, répétons-le, qu’outre les récits plus ou moins vrais que se sont toujours rapportés les générations, Hésiode avait à sa disposition des connaissances plus sûres. N’appartenait-il pas à l’élite de ses contemporains qu’éclairait encore, en ces temps-là, de façon secrète mais efficace, la lumière des Mystères sacrés ?
Toujours est-il qu’Hésiode nous a présenté la guerre de Troie comme le dernier jalon des beaux jours révolus, juste avant la pitoyable affaire dorienne. Or l’Histoire, à sa manière, confirme cette césure dans l’évolution culturelle de l’époque.
Le passage de l’âge du bronze à l’âge du fer, qu’inscrit en clair, dans la trame événementielle, l’invasion dorienne, avait d’ailleurs laissé, semble-t-il, quelque nostalgie significative au coeur des gens, quelque étrange déréliction. « Les murailles des citadelles mycéniennes étaient regardées comme l’oeuvre de géants, les Cyclopes ». Ces souvenirs de l’architecture ancienne, en même temps que les poèmes exaltant le passé, « étaient la preuve manifeste d’un âge d’or, depuis longtemps révolu et remplacé par un âge de fer » (65). Au XIIIe siècle, la civilisation mycénienne était encore florissante sur le continent, alors que la Crète était déjà dévastée. Bientôt pourtant, dans l’attente des ennemis nordiques, on construisit de massives murailles défensives autour des cités et à travers l’Isthme de Corinthe. Partout, dans l’Orient méditerranéen, l’on éleva de puissantes fortifications, ou bien on les améliora : à Athènes, à Mycènes, à Tyrinthe, chez les Hittites et jusqu’en Égypte. C’était une mobilisation générale contre un fléau déjà connu et redouté. Il n’empêche que vers la fin du siècle, les principaux centres du Péloponnèse furent détruits par le feu. Bien plus, ce fut le signal de l’écroulement de toute civilisation dans la région égéenne, avec, semble-t-il, une importante mortalité. Les changements se sont avérés si désastreux que l’on a pu se demander s’ils n’étaient pas dûs à quelque grave modification du climat (66). Les mêmes troubles ont été observés en Anatolie : à la suite des invasions phrygiennes au XIIIe siècle et de la chute de l’Empire hittite vers 1180, s’ensuivit une éclipse assez longue qui se prolongea jusqu’en 950 et que l’on a appelée « l’Age Sombre » (67). Une dépopulation aussi considérable et une disparition aussi marquée de la culture dans les pays égéens ont frappé les historiens et les archéologues ; c’est une catastrophe qu’il est difficile, pense-t-on, « d’attribuer à la seule main de l’homme ». On a donc supposé une altération du climat suffisamment importante pour entraîner une grave sécheresse et de sévères famines. Ainsi s’expliquerait un bouleversement aussi soudain, après tant d’années de prospérité (68).
Aurait-on prêté aux Doriens, et même aux Achéens, des ravages qui seraient dûs surtout, en réalité, à de violents soubresauts de la nature ? Certains investigateurs, certains hommes de science pensent que les envahisseurs indo-européens seraient responsables des ruines accumulées à ces époques lointaines, et même que les Doriens, quant à eux, détruisaient pour le simple et sauvage plaisir de détruire. D’autres chercheurs, cependant, ont été d’un avis différent. Ainsi sir Arthur Evans a découvert, dans ses fouilles de Crète, des indices tendant à démontrer que la mort des habitants avait été brutale et soudaine, comme sous l’effet d’une catastrophe naturelle imprévisible.
Nous ne pouvons trop nous étendre ici sur des questions aussi controversées, non seulement quant à la nature réelle des événements qui se sont produits, mais surtout quant à leur datation. Ce ne sont pas, à la vérité, les témoignages qui manquent, ni dans les inscriptions d’Egypte, ni dans les écrits de divers peuples anciens, tous apparemment contemporains de ces désastres. Mais les spécialistes sont loin de s’accorder, ni sur la signification véritable de ces témoignages, ni sur l’époque à laquelle ils se rattachent. Cela ne nous empêchera pas pourtant de relever certaines « rencontres ».
Ce que l’Egyptien Ipouwer raconte dans le papyrus qui porte son nom, semble se rapporter aux mêmes circonstances que celles que relate le livre de l’Exode dans la Bible. Les documents anciens et l’Archéologie amènent aujourd’hui « l’historien attentif » à situer l’exode des Juifs vers 1250-1200 (69). Il paraît même certain, si l’on tient compte du texte de l’Exode, que le départ des Juifs n’a dû s’effectuer qu’après la mort de Ramsès II (70). C’est d’ailleurs sous le règne de son successeur que les choses s’aggravent. Le pharaon Mineptah (71) doit en effet repousser les Libyens auxquels se sont joints les « Peuples de la Mer ». Puis sous Ramsès III, l’invasion se fait catastrophique, à laquelle participent, dirait-on, des « forces » terrestres, voire célestes. Les inscriptions de Medinet-Habou décrivent des phénomènes tels qu’il est difficile de ne pas y voir des fléaux naturels : incendies, séismes, inondations. Comme les faits relatés par le papyrus d’Ipouwer, tout cela n’est pas sans rappeler les « plaies d’Egypte ». C’est d’ailleurs à cette époque, vers 1200 avant notre ère, que, selon des constatations archéologiques, le Sahara et la Libye furent transformés en déserts. Pendant l’âge du bronze, d’après le témoignage de nombreuses peintures rupestres et les interprétations que l’on en donne, c’étaient là des pays fertiles qui nourrissaient des troupeaux considérables. Les catastrophes n’ont pas affecté que l’Afrique. Vers 1200 aussi, on les voit ravager les régions du Nord européen : sécheresses, incendies destructeurs de toute végétation, séismes qui tarissent les sources et détruisent les bâtiments, pluies diluviennes et inondations, et les famines qui s’ensuivent réduisent par endroits les hommes à la pratique de l’anthropophagie. Selon certains spécialistes, ce sont ces catastrophes, du reste, qui sont à l’origine des invasions dont nous avons parlé.
Il faut dire ici que les invasions surgies au cours de l’Histoire, et dans lesquelles on a tendance à ne voir que des entreprises agressives, sont bien souvent des fuites en avant, des retraites provoquées par quelque danger qui menace les arrières des envahisseurs. Invasions par la force des choses, ce sont en fait des tribulations, forme que prend parfois le châtiment cosmique. De telles tribulations ainsi que divers cataclysmes plus ou moins graves marquent en général la fin des cycles, comme l’enseignent la plupart des traditions.
***
2. Ce qu’Hésiode regrette fort explicitement, c’est de n’être pas « mort plus tôt ou né plus tard ». Naissant et mourant plus tôt, beaucoup plus tôt, il aurait appartenu à ce qu’il appelle une « race » de « héros », de ceux dont les derniers finirent à Troie. Naissant plus tard, il aurait échappé à une vie condamnée à s’écouler au milieu de la « race du fer ». Envisageait-il quelque « redressement » après cette « race du fer » ? Aurait-il même souhaité une « naissance » au-delà de notre Manvantara ? Ce qui reste clair en tout cas, pour nous limiter à ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c’est la désignation de deux « races » successives dont la seconde est présentée comme bien calamiteuse, comparée aux « héros » de la première (72). Clair est aussi le choix de la guerre de Troie comme l’un des signes du tournant de l’histoire grecque.
Nous avons vu, quant à nous, que certains « hauts faits » des « héros » d’Hésiode, avant l’invasion de la « race du fer », valaient bien, sans doute, les « prouesses » de cette dernière lors de son arrivée tumultueuse, et ce n’est évidemment pas sur de pareils exemples, pris à chaud, que l’on peut établir une distinction profonde entre les premiers guerriers, déjà déchus, et ceux de la « race » qui était appelée à les supplanter. Une telle incertitude est bien naturelle dans une période de transition, généralement trouble. Cela renforce l’idée qu’Hésiode, pour être aussi tranchant dans sa distinction des deux « races », ne se fiait pas à des événements relativement proches, mais à quelques éléments traditionnels remontant à une époque largement antérieure à celle de la guerre de Troie et se rapportant à deux catégories humaines successives, se touchant au moment de la succession, mais passablement différentes dans leur caractère et leur destinée. Tant il est vrai qu’à moins de se guider sur une connaissance transcendante à l’Histoire, il est bien difficile, sinon impossible, de saisir la signification véritable de circonstances passées, actuelles ou futures.
Les historiens ont relevé, dans la période que nous étudions, un changement de civilisation. Ils le situent vers 1200 avant notre ère, au moment de la désintégration de l’âge du bronze (73). Ils constatent certains traits par lesquels la nouvelle culture s’écarte de celle qui l’a précédée. Ainsi en est-il dans le traitement des défunts, où la coutume s’installe de les incinérer au lieu dé les enterrer ; dans l’armement, où l’on utilise maintenant le fer à la place du bronze ; dans l’art de la poterie, plus raffinée dans les formes et la décoration, et dont la précision annonce l’art classique. En ce qui concerne cette évolution de l’art, on estime qu’il s’agit moins d’une coupure proprement dite que d’une nouvelle façon de travailler à partir des modèles de l’ancienne culture (74). Cette continuité relative peut s’expliquer d’ailleurs par le fait que les nouveaux venus appartiennent à la même famille indo-européenne que ceux qu’ils envahissent ; et de plus, si ces derniers, à ce moment, se trouvent déjà, après des siècles, fortement pénétrés de culture crétoise et, de ce fait, apparemment plus « civilisés » que leurs envahisseurs, il est assez naturel que ceux-ci, dès le siècle suivant leur arrivée, adoptent, en y ajoutant une touche personnelle, quelques éléments de la culture locale.
Certes, il faut bien reconnaître dans l’Histoire une évidente continuité, même si elle est relative en période de transition, et cette continuité est celle qui caractérise tout « tissu » vivant, qu’il soit cosmique ou qu’il soit humain, car elle est celle de l’espace et du temps. On peut du reste l’attribuer, lorsqu’on se trouve au milieu d’un cycle comme c’est ici le cas, à l’influence qualitative plus particulière de ce point médian, influence qui s’exerce à la fois sur les événements relativement proches du passé et sur ceux de l’avenir, sur toutes gens, sur toutes choses, et qui facilite, en un point critique invisible, le passage d’une manière de vivre à une autre, d’une mentalité ancienne à une nouvelle, comme nous l’avons dit plus haut. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit là d’une influence qui, tout en rassemblant, divise, et qui, tout en conservant le « tissu » du temps, ne manque pas d’en changer « insensiblement » certains fils. Il en résulte que lorsqu’on est entraîné dans le courant des choses, on peut, si l’on y reste attentif, se rendre compte que la couleur s’en est modifiée, mais cela n’aide nullement à fixer dans le temps l’instant de la modification. C’est ainsi que l’époque transitoire dont nous parlons, faite, en ce moment historique, de la rencontre et de l’équilibre éphémère de deux influences successives, dissimule dans sa continuité quelque « hiatus » dont nul oeil humain, nulle oreille, ne sauraient saisir l’instant précis dans l’enchaînement des circonstances, instant mystérieux où l’époque ancienne se fond en partie dans la nouvelle, où l’une des influences à l’oeuvre l’emporte sur l’autre, où l’Histoire bascule d’une vision « périmée » à celle qui la remplace, dans une précarité qui ne cesse de grandir, porteuse de trouble et d’ignorance.
Telles sont aussi la servitude
et l’ironie de toute recherche dans les cycles de l’humanité : les
chiffres obtenus par l’utilisation de quelques règles, fournissent
des dates précises certes, mais l’on n’en découvre pas toujours
si facilement la signification incontestable dans la trame confuse des
événements en cours. Enfin, quant aux précisions dont nous nous prévalons,
elles reposent, redisons-le, sur une date fixée à partir d’une hypothèse,
solide sans doute, et pourtant à laquelle on ne recourt que faute de
connaître à coup sûr l’amplitude exacte des vagues humaines, et
faute surtout d’en savoir en toute certitude l’Origine et la Fin.
d) Sommes-nous les héritiers des Doriens ?
Après ces quelques développements que nous ont inspirés les plaintes d’Hésiode et les murmures parfois confus de l’Histoire, voici des réflexions formulées par un auteur dont il faut supposer qu’il connaissait bien notre poète et la civilisation de la Grèce ancienne (75).
« L’austérité de la vie dorienne, l’esprit étroitement utilitaire des nouveaux maîtres de la Grèce étaient incompatibles non seulement avec le luxe et le bien-être dont l’influence crétoise avait développé le goût, mais avec toute espèce de sentiment artistique. Aussi, après avoir tout nivelé, ne surent-ils pas reconstruire (…). Ce fut - l’expression est devenue classique - un long ‘moyen âge’ qui s’abattit sur l’Hellade et sur tout le monde égéen (…). Ce ‘moyen âge’ devait être suivi, beaucoup plus tard, d’une brillante renaissance, à laquelle l’énergie virile, le robuste bon sens, l’esprit d’ordre des Doriens et de leurs descendants (…) contribuèrent pour une large part. Ce n’en est pas moins un spectacle paradoxal et quelque peu déconcertant, de voir la nation qui devait être la grande civilisatrice du genre humain entrer dans l’histoire en supprimant brutalement tout ce qui existait de beau et de bien sur le terrain même où son génie allait se former et s’épanouir » (76).
Les Doriens, grands civilisateurs du « genre humain » ? Pourquoi pas ? Du moins si l’on veut dire par là que les peuples occidentaux, après avoir reçu, parmi leurs divers héritages, celui de la culture dorienne, quel qu’il ait alors été, n’en ont vraisemblablement saisi et gardé, comme des autres héritages, que les aspects à leur goût, c’est-à-dire les plus médiocres. Selon leur coutume, ils en ont sans doute réduit quelques significations pour les adapter à la simplicité de leur propre climat mental et psychique. Il en est résulté diverses habitudes, de plus en plus routinières, dont ils ont systématisé le culte au cours des siècles, tout en s’efforçant de le répandre dans le monde entier et de l’y imposer. Ce prosélytisme ne s’est d’ailleurs pas exercé sans succès, et l’on est bien obligé d’en convenir lorsqu’on regarde aujourd’hui autour de soi. Du moins relève-t-on plus d’une de ces tares que dénonce dans la culture dorienne le texte que nous avons cité : utilitarisme, négation croissante de tout art véritable, nivellement généralisé…
Quant au « robuste bon sens » et à « l’esprit d’ordre » qui, après le long « moyen âge » post-égéen, auraient représenté la contribution dorienne à la « brillante renaissance » culturelle de la région, il ne semble pas qu’il en soit resté grand-chose en l’état actuel de la civilisation sans précédent dont a finalement réussi à nous doter, à grand-peine, notre malheureux « genre humain ». Le « robuste bon sens », en effet, n’est guère flagrant, c’est le moins que l’on puisse dire, dans les doctrines, les thèses, les idéologies qui ont rendu possible, avec les résultats que l’on sait, l’organisation de nos sociétés. Et en ce qui concerne « l’esprit d’ordre » à l’oeuvre dans le monde, ce serait une moquerie, une feinte injurieuse, que de prétendre en chercher des traces dans la confusion, les troubles, la gabegie, les exactions, la corruption qui sévissent partout… A moins, bien évidemment, de reconnaître cet « esprit d’ordre » dans les méthodes qu’ont adoptées les gouvernements pour mettre en coupe réglée les masses qu’ils se sont soumises.
L’ « ordre » et le « bon sens », qu’ils soient doriens ou pris en soi, nous les avons clairement perdus. Autrefois, les hommes avaient d’abord des devoirs qui leur incombaient du fait de leur rôle dans la société. Ce sont ces devoirs qui, remplis, justifiaient certains privilèges, pour la seule et bonne raison que, sans ces privilèges, les devoirs en question n’auraient pu être remplis. Aujourd’hui, on ne peut même plus parler de devoirs sans susciter le rire ou le sourire. Le devoir, en effet, est une notion contraignante, en opposition à celle de liberté telle qu’on la conçoit erronément à l’heure actuelle. Or si le terme de devoir, dans nos sociétés, est rarement hasardé, on ne cesse en revanche de nous rabâcher celui de liberté dans des phrases de plus en plus creuses. Maintenant, les hommes n’ont plus que des droits, assez particuliers du reste : ceux de « manifester », de vociférer, puis de se soumettre (77).
Le « robuste bon sens » et « l’esprit d’ordre » ne sont décidément plus de ce monde. La perte en a été consommée, avec d’autres valeurs, pensons-nous, le jour où le « genre humain », après nombre de vicissitudes, s’est enfin trouvé suffisamment hébété pour que ses nouveaux pasteurs puissent lui jeter impunément à la face l’hypocrite proclamation des « droits de l’homme », tout en manoeuvrant afin de priver cet homme de son droit le plus imprescriptible en châtrant son âme de la possibilité même d’une divinisation qui lui avait été jadis promise.
a) Le tournant en quelques points du globe
1. Comme nous l’avons déjà dit, les cycles du Manvantara, s’ils concernent l’humanité tout entière, devraient, du moins dans leurs grandes articulations, se trouver confirmés, avec plus ou moins de précision, dans l’histoire des grands peuples. Or, c’est ce que nous avons cru observer là où nous avons fait quelques sondages. La césure de 1240,23, dont nous avons obtenu la date par des calculs qu’autorise la doctrine cyclique, semble y correspondre à des changements importants relevés par l’Histoire et l’Archéologie. Sans parler des résultats acquis dans le nord de l’Europe, dans la Grèce et dans l’Asie Mineure, nous avons vu que le même genre d’événements, de désordres, de catastrophes naturelles, ont, vers la même époque, affecté la Libye et l’Égypte.
Les limites que l’on assigne au règne de Ramsès II (1290-1224, ou 1291-1235) englobent, vers sa fin, la date-césure de 1240,23. Ramsès II fut un grand bâtisseur de temples Karnak, Louqsor et d’autres édifices témoignent d’un goût marqué pour le colossal. Ce pharaon se fit aussi une grande réputation de conquérant, ayant accompli de glorieuses campagnes militaires contre les Libyens, les Syriens, les Hittites même. Certes, l’Égypte était prospère alors ; cependant on sait bien que l’enflure, en quelque direction qu’elle se produise, laisse généralement présager l’écroulement de la puissance et la ruine des Etats (78).
L’Histoire rapporte précisément que l’Égypte, après Ramsès II, se divise, s’affaiblit, et que la décadence affecte le pays sous les pharaons suivants, triste prélude à la fin du Nouvel Empire qui se produit vers 1090. Nous avons cité plus haut des faits, des circonstances, des écrits, qui montrent bien que la région, à l’époque, a subi, pour dire le moins, d’importants bouleversements d’ordre géologique et humain. Que l’exode des Juifs se soit produit à la fin du règne de Ramsès II, ou sous son successeur, ou quelques années plus tard, les « plaies » qui le précèdent et l’accompagnent, et que l’emphase sémite a peut-être grandies, ont laissé suffisamment de traces géologiques, archéologiques et scripturaires, pour prouver que l’époque a bien été le théâtre de faits exceptionnels et le tournant important d’un cycle capital de l’Histoire. Lorsque Ramsès III accède au trône vers 1198, l’Egypte est déjà presque totalement dévastée : sous cette XXe et dernière dynastie du Nouvel Empire, il ne reste plus rien de la gloire et de la splendeur d’antan.
***
2. Le hiatus que nos calculs situent au milieu du Kali-Yuga, a été remarqué en Mésopotamie par certains historiens. Ainsi relevons-nous dans un vieux livre scolaire que les rois assyriens, longtemps vassaux de ceux de Babylone, finirent par imposer leur puissance. « Vers 1250 av. J.-C., ils écrasèrent les Babyloniens dont le roi fut emmené, chargé de fers, en Assyrie (…). Peuple de montagnes, les Assyriens étaient vigoureux et énergiques, mais d’une brutalité sanguinaire (79) (…). Grâce à une organisation militaire perfectionnée, ils purent terroriser l’Orient pendant plusieurs siècles » (80). Ces guerriers, venus du nord de la Mésopotamie, durent-ils leurs succès, comme les Doriens, à la qualité reconnue de leurs armes de fer ? Ils méritent bien, en tout cas, vu l’époque de leur triomphe, d’être rattachés à cette nouvelle « race du fer » dont se plaignait Hésiode.
Ici, de nouveau, mais plus sauvagement sans doute qu’avec les Doriens en Grèce, s’exprime la période de transition entre un âge de modération, fait, dans le cas présent, de sagesse, voire de spiritualité, et un âge de barbarie triomphante. Certes, nous ne devons pas oublier que lorsqu’on parle de sagesse dans le Kali-Yuga, fût-ce à ses débuts, ce ne peut être que d’une sagesse très relative, ou, plus sûrement encore, de certains exemples de sagesse que les gens, dans leur ensemble, ne brûlaient guère d’imiter. Il faut prendre garde aussi qu’en plein milieu de cet « âge d’or » (4480,23-1888,23) du Kali-Yuga, on constate des actes de cruauté qui blessent la sensibilité de beaucoup de nos contemporains, mais qu’il ne faudrait peut-être pas, sans plus d’information, attribuer à la décadence d’une culture très différente de la nôtre, et où les sacrifices humains n’étaient probablement pas rares (81). Toujours est-il qu’il nous paraît opportun de relever quelques témoignages de ce que proclamaient volontiers les monarques d’alors. Ne doit-on pas voir, vers la fin du troisième millénaire, dans le nom même du fondateur d’Akkad, Sargon ou Sharrouken c’est-à-dire « roi équitable », l’intention d’être un « roi de justice », ou tout au moins de s’en assurer la renommée ? Mais, nous dira-t-on, Sargon II, vers l’an 700, portait le même nom et ce n’était pourtant pas un saint ! Sans doute. Cependant, il faut tenir compte du fait qu’un ou deux millénaires séparent les deux souverains et que le second était un Assyrien. Il est vrai, d’autre part, même pour des contemporains, que l’on ne saurait se fier à un simple nom. Plus sûre, peut-être, est l’inscription découverte à Tello, en pays sumérien, et que nous a laissée le prince Goudéa, un roi-prêtre. « Ô mon roi, dit-il en s’adressant au dieu, ô Nin-Girsou, ô seigneur qui mets un frein à la fureur des flots, ô seigneur dont la parole étincelle (…), j’ai construit ton temple, avec joie je veux t’y introduire » (82)… Ces deux princes, d’apparente bonne volonté, vivaient dans la seconde moitié du troisième millénaire. Au début du deuxième millénaire, enfin, Hammourabi, roi de Babylone, nous a laissé un code de justice dont la sévérité contraste sans doute avec la juridiction sumérienne (83), mais où se fait jour, comme dans d’autres codes de l’époque, un grand souci d’équité. Certes, en tout cela, nous n’avons que des déclarations de principe, et il n’est point de témoin pour venir nous dire dans quelle mesure ces principes se voyaient alors appliqués. Du moins les intentions affichées étaient-elles droites et, à ces époques où la puissance absolue des monarques rendait inutiles nos hypocrisies politiciennes modernes, on peut penser que le pouvoir mettait en actes ses déclarations, et avec une efficacité certaine.
Que penser, en revanche, de ce prince d’Assour, Salmanasar I (1274-1245), qui revendiquait la gloire d’avoir éborgné 14.400 ennemis ? Or, ajoute avec un humour sombre le commentateur, « une guerre psychologique de même genre s’utilisa de plus en plus tandis que s’écoulait le temps » (84). N’est-ce pas le tournant de 1240,23 qui s’amorce alors ? C’est vers 1235 que Tukulti-Ninurta détruit Babylone et emmène son roi en captivité. C’est à cette époque et dans les suivantes que se multiplient les témoignages d’actes sacrilèges et de barbarie sanguinaire. Tukulti-Ninurta enlève sans vergogne de Babylone la statue du dieu Marduk, et finit assassiné par son fils et successeur. Dans une inscription de l’an 884, Assournazirabal se targue de ses cruautés sur les prisonniers lors d’une expédition contre le rebelle Hulaï : « Je m’abattis sur la ville, je la conquis, 600 de leurs guerriers je passai au fil de l’épée, 3.000 prisonniers je livrai aux flammes (…). Hulaï, je le pris vivant de ma propre main, je l’écorchai, j’étendis sa peau sur la muraille »… Mis en appétit, le roi s’empare d’une autre ville : « Je fis un grand nombre de prisonniers vivants : aux uns je coupai les mains et les doigts, à d’autres le nez et les oreilles ; à beaucoup j’enlevai la vue (…). Leurs jeunes gens et leurs filles, je les ai jetés dans le feu ». Plus de deux cents ans après, Assourbanipal n’est évidemment pas plus tendre : il fait un carnage à Babylone, rase la ville de Suze avec ses temples, après avoir fait main basse sur toutes les richesses, qu’il emporte avec lui, ainsi que « toute la famille royale », les notables, les bestiaux… Cela ne lui suffit pas, car c’est un raffiné : « sur une distance d’un mois et vingt-cinq jours de marche, je dévastai le pays, j’y répandis le sel et les épines » (85). Or le sel stérilise, et planter des ronces détériore le sol. On voit qu’Assourbanipal pouvait se flatter d’une pensée déjà très moderne. Non content de traiter les prisonniers de guerre selon l’usage assyrien, il ruinait et polluait de son mieux tout l’environnement (86). Ce qui ne l’empêcha pas de fonder à Ninive une des plus importantes bibliothèques de l’antiquité. Grâce à ses pillages ?
Il n’est pas que la barbarie qui se développe en cette nouvelle époque. Les moeurs sacrilèges, on l’a vu, s’instaurent sous bien des aspects. L’on n’hésite pas à falsifier le nom des dieux dans des textes comme l’Enuma elish, poème de la création du monde, et l’on s’assassine en famille, ce dont on ne s’est pas privé dès le début. Sennacherib est, lui aussi, finalement tué par un ou deux de ses fils dans le temple même du dieu Ninurta, un de ces dieux qu’au fil de ses conquêtes il n’avait jamais craint d’offenser (87).
Devant ces quelques exemples de l’évolution des choses en Mésopotamie autour de la date transitoire de 1240, on doit convenir qu’un changement notoire s’est fait sentir, après cette date, dans l’orientation des esprits et des moeurs. On pourrait en trouver peut-être une sorte de confirmation dans des sculptures des périodes concernées. Que ces peuples se soient représentés tels qu’ils étaient, ou avec une certaine complaisance, leur aspect nous parait très significatif. Le Sumérien, de type indo-européen, « celui des guerriers grecs », précisent Malet et Isaac, de même que le Sémite de Chaldée, bien que fort différents dans leurs visages, ont tous deux des traits fins et paisibles. En revanche, le Sémite d’Assyrie possède un visage nettement plus grossier et non dépourvu d’une certaine cruauté malicieuse, sans parler de sa barbe postiche dont l’ampleur grotesque ne parvient pas à nous distraire de cette physionomie sauvage. Les longs siècles qui séparent l’Assyrien des deux premiers personnages suffisent-ils à faire éclater à eux seuls cette différence ? La césure culturelle de 1240 n’y est-elle pas aussi pour beaucoup (88) ?
Les fouilles archéologiques en Mésopotamie n’ont pas manqué de découvrir des traces de déluges et d’incendies, mais les limites de cette étude intervenant aussi dans les recherches que nous nous sommes imposées, ne nous ont pas permis d’en rencontrer l’attestation à la fin du XIIIe siècle avant notre ère, comme c’était pourtant le cas dans les pays de la Méditerranée orientale et même ailleurs.
Il n’en reste pas moins que de part et d’autre de notre date cyclique de 1240,23, deux temps et deux esprits bien distincts se succèdent, nous semble-t-il, dans le cours du Kali-Yuga : d’abord les civilisations de Sumer et de la Babylone chaldéenne, ensuite la puissance conquérante d’Assour et de Ninive.
Ne nous leurrons pas. Il aurait été assez surprenant qu’en cet Age de Fer, si bien nommé, et même à son aurore qu’il faut, en dépit de tout, appeler son « âge d’or », il ne se fût pas perpétré çà et là, comme à Sumer par exemple, quelques actes qu’aujourd’hui nous qualifierions facilement d’horreurs. Mais il est évident qu’il faut faire la différence entre une époque où l’on se flatte, comme Sargon, d’être un « roi équitable », où un prince comme Goudéa nous lègue la prière qu’il adressait à son dieu, et l’époque suivante, où l’on énumère avec complaisance les prisonniers brûlés, écorchés, amputés… Il y a un très grand écart entre les époques où la réprobation du mal n’entraîne pas sa complète suppression, et celles où l’on cultive le mal comme un art et un titre de gloire…
En attendant les moments concluants où la courbe ascensionnelle de la civilisation moderne atteindrait son apex, et où les parangons de notre brillante culture s’esclafferaient aux récits d’histoires macabres. C’est là que nous en sommes aujourd’hui. Dans tel film, nous promet-on, le comique s’associe au meurtre, et l’on y précise, nous dit-on, en ponctuant d’éclats de rire les détails de la chose, le nombre de cailloux dont il faut lester les poches d’un cadavre pour le faire couler, selon qu’il s’agit d’un homme, d’une femme, ou d’un enfant (89) !
***
3. A l’autre bout du monde, en Chine, vers la même époque, se produit un événement important : le passage de la deuxième dynastie à la troisième. Les dates en sont très incertaines. La dynastie des Chang, par exemple, qui mène à son apogée l’art du bronze, règne, selon l’école orthodoxe, de 1766 à 1122, et selon d’autres écoles, de 1523 à 1027. Il n’est donc pas facile, du strict point de vue historique, de savoir ce qui se passait au juste autour de 1240, date médiane du Kali-Yuga selon notre hypothèse de travail. Ce qui, plus qu’un changement de dynastie, pourrait plaider en faveur de l’importance de cette date, c’est qu’elle se trouve incluse dans la durée de la dernière capitale des Chang, c’est-à-dire entre 1301 et 1050 ou, d’après une autre computation, entre 1388 et 1122.
Le peu que l’on sait des Chang avant cette époque est surtout, semble-t-il, tributaire de l’Archéologie (90). On n’ignore pas, cependant, que vers le commencement du deuxième millénaire, lors de la révolution qu’apporte le bronze, et peut-être même au début de la période des Chang, la société se trouve encore régie selon une structure essentiellement traditionnelle. Au sommet règne le Wang, Fils du Ciel, chef de la hiérarchie religieuse et, parce qu’il est roi en même temps que pontife, garant de l’ordre cosmique d’où découle la paix terrestre. Au-dessous du Wang, brille l’aristocratie guerrière qui domine sur toute une population de paysans, base substantielle de l’Empire. Mais dans l’ensemble, ces temps-là sont comme enveloppés d’une brume protectrice due à l’absence de documents tangibles, certes, mais aussi, croyons-nous, à l’éloignement abyssal qu’engendre une pensée moderne, imbue de ses préjugés. De ceux-ci les moindres ne sont pas son fétichisme à l’égard de toute preuve palpable, pesamment concrète, et aussi la méfiance qu’elle entretient envers tout ce qui dépasse les bornes singulièrement étroites de son « univers » mental.
Pour ce qui est de la littérature historique, telle qu’elle apparaît dans ses témoignages les plus anciens, on ne peut guère, disent les spécialistes, s’y fier avant le premier millénaire, en raison de l’importance qu’y prennent les légendes, et, aussi, de crainte que cette littérature n’ait été plus tard « modifiée à des fins politiques ou sociales » (91). Il semble que l’on se trouve là devant une de ces « barrières » que rencontre, selon R. Guénon, la recherche historique, et qui sont évidemment de plus en plus impénétrables au fur et à mesure que l’on remonte plus haut vers les origines du Kali-Yuga. Cependant, nous apprenons tout de même que, « durant les trois derniers siècles de gouvernement des Chang à Yin, la civilisation chinoise apparut, pour la première fois, distincte des autres civilisations anciennes », et cela, avec une soudaineté imprévisible (92). Aussi, la date de 1240, qui occupe une position à peu près centrale dans la durée historique de la cité de Yin, pourrait bien revêtir, de ce fait, une signification toute particulière (93).
Les premiers rois, à Yin, sont assistés dans leur règne par une hiérarchie nobiliaire et, sauf exception, ne conduisent pas eux-mêmes la guerre. Ils ne sont, d’ailleurs, que des intermédiaires entre leurs sujets et des puissances invisibles, car leurs ancêtres royaux, depuis leurs demeures célestes, sont réputés exercer le pouvoir réel (94). Tout cela parait témoigner d’une attitude encore respectueuse à l’égard de traditions vénérables. Cependant, à la fin de cette deuxième dynastie, se produisent des révoltes populaires. Nous n’avons pas essayé de retrouver, à cette époque de l’histoire chinoise, des indices de catastrophes naturelles, comme nous en avons rencontré en Europe et en Egypte au cours de l’époque correspondante. Seules pourraient dénoncer de telles catastrophes, en l’absence de références historiques ou archéologiques directes, les modifications apportées au calendrier, notamment par les rois Wu-ting (1324-1266) et Tsu-chia (1258-1226) (95), ou les données réputées « mythiques » du Chou-king. Et sans doute ne faudrait-il pas négliger non plus, sous ce rapport, le brusque changement de civilisation que nous avons signalé plus haut dans la période Yin (1301-1050, ou 1388-1122), car ce genre de discontinuité culturelle, à cette même époque, dans d’autres pays, se présente souvent, comme on l’a vu, à la suite de secousses ou de désordres naturels plus ou moins considérables.
La nouvelle dynastie des Tcheou (1122-770) débute officiellement à la suite d’une victoire décisive que remporte Wu Wang, des Tcheou, sur Ti Hsin, dernier roi des Chang, alors qu’il est occupé à combattre des rebelles. Certes, il faut à peu près un siècle pour remonter de cette bataille de 1122 jusqu’à notre date cyclique de 1240,23. Mais comme nous l’avons déjà fait observer, un siècle d’écart par rapport à la date médiane exacte de 6.480 années d’Histoire ne saurait faire sortir un événement de la zone d’influence de cette date. D’ailleurs, dans les exemples de peuples que nous avons choisis jusqu’ici, c’est aussi parfois quelques décades plus tard que se sont particulièrement manifestés les événements de l’Histoire. De plus, il faut noter que la fameuse bataille de 1122 n’est qu’une sorte de « régularisation » d’une situation de fait très significative à l’époque de Wen Wang, père de Wu Wang, puisque cet important personnage des Tcheou contrôlait alors déjà les deux tiers de la Chine ; il reconnaissait cependant de façon manifeste la supériorité culturelle et politique des Chang (96).
Sans doute ce passage de la deuxième à la troisième dynasties implique-t-il un affaiblissement des Chang, mais les signes de la dégénérescence ne nous apparaissent pas avec autant d’évidence que dans le cas du Nouvel Empire égyptien. Il est vrai que le dernier représentant des Chang, le roi Ti Hsin, est en proie à bien des difficultés. Le royaume est épuisé par la lutte contre les nomades et les révoltés. Faut-il voir un signe de dégénérescence dans le fait qu’il doive, contrairement à ses ancêtres, mener lui-même ses troupes contre les rebelles ? Les problèmes n’épargnent pas non plus les Tcheou : ceux-ci en sont réduits à organiser un système féodal dont la dispersion des cités, qui est aussi faiblesse, semble être requise pour contrôler un plus grand territoire où les nations hostiles ne manquent pas. Toujours est-il qu’à partir de ce tournant de la fin du XIIIe siècle, la nécessité de guerroyer se fait incessante, qu’il s’agisse des révoltes troublant la fin du règne des Chang, ou des hostilités dues à la résistance que rencontrent les Tcheou dès leur arrivée au pouvoir. Tout cela ne dénote-t-il pas, pour le moins, une autorité passablement contestée, et donc, peut-être, contestable ? Ce qui est certain, c’est que sous les Tcheou, le pouvoir de l’Empereur décline au profit des Etats féodaux. Ne s’est-on pas alors considérablement éloigné de la notion de « Wang », ce Roi-Pontife nanti du « mandat du Ciel » et qui, de ce fait, est légitimement reconnu comme Fils du Ciel (97) ? Ne sommes-nous pas amenés, devant ces faits, à constater un singulier décalage depuis la société que nous évoquions un peu plus haut, et qui florissait autour de l’an 2000 (98) ?
b) Rencontre du poète Hésiode et du prophète Daniel
1. Outre ce que nous avons reçu des poètes grecs et ce que nous ont transmis l’Histoire et l’Archéologie au sujet de certaines césures culturelles dans la continuité des temps humains, il est un héritage traditionnel qui non seulement nous assure d’une division du quatrième Age en deux parties distinctes, mais qui nous apporte encore quelques éléments d’information particulièrement décisifs sur les deux « races » qui leur correspondent et dont la dernière se trouve marquée par une hétérogénéité caractéristique. C’est ce que nous expose la Bible à travers un songe du roi Nabuchodonosor dont le prophète Daniel nous révèle l’interprétation.
Il semble que l’on ait souvent sollicité ce texte où l’on parle d’une statue merveilleuse d’aspect « terrifiant » (99), et dont a rêvé le roi. Mais Daniel, tout en appliquant le songe à son temps, nous en donne une explication assez claire et conforme, pensons-nous, aux données traditionnelles. Les quatre parties principales de la statue se suivent de la tête aux pieds, et sont faites de quatre métaux ; elles représentent quatre royaumes et correspondent manifestement aux quatre Ages des traditions occidentales. La succession de l’or, de l’argent, de l’airain et du fer, métaux dont la qualité est de moins en moins précieuse, exprime la dégénérescence des royaumes et des Ages. Daniel note d’ailleurs que le second royaume est « moindre » (100) que le premier, et il est bien évident que cet « amoindrissement » va se poursuivre au cours de la dégénérescence générale et jusqu’à l’écroulement final (101).
Ce qui nous intéresse particulièrement ici, c’est que, sous d’autres images, nous retrouvons le même schéma que dans le texte d’Hésiode. Celui-ci, on s’en souvient, tout en rappelant les quatre Ages traditionnels, avait fait état de cinq « races ». Or, dans le texte biblique ici évoqué, même si l’on ne distingue, avec le prophète Daniel, que quatre royaumes, et donc quatre Ages, le songe fait état de cinq matières différentes dans la constitution de la statue. Le premier royaume correspond à l’or, le second à l’argent, le troisième à l’airain. Quant au quatrième royaume, à la différence des trois autres, il se voit attribuer deux matières. Celles-ci, en effet, viennent compléter la constitution de la statue : les jambes en sont de fer, métal qui « broie et pulvérise tout » (II:40), mais les pieds, « en partie d’argile de potier et en partie de fer », offrent un mélange qui, avec cette « argile boueuse », amène la « division » dans le royaume (II:41), ou quatrième Age (102). Il semble bien, d’ailleurs, que l’on doive entendre cette « division » dans un double sens.
Tout d’abord, ce royaume est de fer, sans mélange, comme les jambes de la statue, et il « brise » alors tous les autres royaumes (II:40). N’est-ce pas dire que dès le début de l’Age de Fer, âge de grossièreté et de brutalité, sont anéanties les prérogatives anciennes dues à des qualités dont on n’a plus que faire maintenant, et que symbolisaient autrefois l’Or, l’Argent et l’Airain ? N’est-ce pas dire encore, ceci expliquant cela, que ces qualités, après s’être dégradées pendant des millénaires, sont alors, sinon complètement disparues, du moins réduites jusqu’à ne plus subsister, dans l’ensemble des humains, que sous forme de caricatures ?
Enfin, après des siècles et des siècles écoulés dans cet Age de Fer, survient un changement : à la « solidité » première se mêle une « fragilité » de mauvais « aloi » qui produit comme une « race » nouvelle. Des jambes de la statue, nous passons à ses pieds, et ce passage est l’occasion d’une véritable scission, premier aspect de la « division » de ce quatrième royaume, qui fait succéder, à une « race » homogène, une « race » hétérogène. Quant au second aspect de la « division », il est dans cette hétérogénéité même où le fer se mésallie à l’argile (II:41), en un « mélange » sans « adhésion » (II:43).
Aux quatre Ages traditionnels, ou Yugas, la doctrine hindoue fait correspondre les quatre castes. Or si les Shûdras, comme on le dit, prédominent durant le quatrième Age, ou Kali-Yuga, il semble bien qu’en cette même époque terminale, les Tchandâlas, ou « intouchables » finissent par « dominer » aussi, à leur tour. Dans le symbolisme de la statue rêvée par Nabuchodonosor, il est logique d’associer les Shûdras proprement dits aux jambes de fer, et les Tchandâlas, avec leur sang mêlé, aux pieds qui sont, dit la Bible, « en partie de fer et en partie d’argile ». Daniel voit dans ce mélange un symbole du métissage intempestif auquel se livrent, à un moment donné, les gens de ce quatrième royaume, lesquels forment alors, selon l’expression de Louis Segond, des « alliances » qui cependant ne les « unissent » pas plus que ne « s’allie » le fer avec l’argile (II:43) (103).
Cette union factice, illégitime, contre nature, dirait-on, qui introduit dans le fer pur originel une argile étrangère, produit, à l’intérieur de ce qui est un même Age, une sorte de rupture et de divergence dans sa progression. Mais à quel moment de cet Age ? Selon les tristes paroles d’Hésiode et ce qu’atteste çà et là l’Histoire avec plus ou moins de précision, une divergence, nous l’avons constaté, semble bien se manifester au milieu même du quatrième Age. C’est alors la fin de la « race divine des héros » à laquelle se substitue la « race du fer », et ce, dans la même famille aryenne, bien que l’on puisse admettre avoir affaire à deux « races » différentes. Hésiode et le prophète Daniel se réfèreraient-ils au même événement ?
***
2. La Bible, comme d’autres sources anciennes, nous rapporte, on le voit, la tradition des quatre grands Ages de l’humanité. Elle atteste en outre un partage du quatrième de ces Ages en deux périodes successives que caractérisent respectivement deux catégories humaines suffisamment dissemblables pour justifier cette distinction. Sans doute, d’après une règle très connue de la doctrine cyclique, le quatrième Age, comme d’ailleurs ceux qui le précèdent, peut-il comporter bien des subdivisions que séparent des césures plus ou moins importantes. La modification qui se produit dans le caractère et les moeurs, de l’une à l’autre de ces périodes, se voit exprimée de diverses manières selon l’époque dont il s’agit, et aussi selon les sources d’information. C’est que les époques ne sauraient se confondre, même quand elles se ressemblent, et c’est aussi que les tempéraments varient d’un peuple à l’autre en fonction des climats, tel aspect d’un caractère ou d’une éthique paraissant plus important en tel lieu qu’en tel autre, lors même que ce caractère ou que cette éthique ne varieraient pas d’un peuple à l’autre comme ils le font parfois d’une façon assez considérable. Or ces diverses césures, dont la succession exprime traditionnellement une dégradation des choses au cours du temps, ne se mentionnent guère de façon isolée, mais plutôt en relation les unes avec les autres. Ici, le choix que fait d’une seule césure le texte biblique, laisse supposer qu’il s’agit dans cet Age d’un tournant assez particulier.
Le prophète Daniel parle de « solidité » ou de « force », puis de « fragilité », mais nous n’avons rien trouvé, dans ses explications, qui nous autorise à dater le passage de l’un à l’autre de ces deux caractères. Certes, d’après le texte (II:1) et les datations admises par certains spécialistes, il semblerait que le songe de Nabuchodonosor et son interprétation par Daniel aient eu lieu en 602 avant J.-C. Comme, dans les traductions qui nous sont proposées, Daniel parle au présent pour le premier « royaume », qu’il attribue à Nabuchodonosor, puis au futur pour les « royaumes » suivants, on pourrait penser qu’il s’agit de « prédictions » et que cela ne concerne donc que l’avenir. Ainsi, non seulement ces versets n’envisageraient nullement la césure « datée » par Hésiode, l’an 1240, mais encore ils se réfèreraient à des événements de beaucoup postérieurs au règne de Nabuchodonosor, lequel s’achève en 562. Or nous allons voir avec quelle prudence il convient de lire ce qu’écrit Daniel.
Nous ne rentrons d’ailleurs dans ces détails de l’histoire que parce que certains ont cru « vraisemblable » d’attribuer les trois derniers « royaumes » aux Mèdes, aux Perses, puis à Alexandre le Grand et ses successeurs. Mais il va sans dire qu’il nous paraît bien difficile de retenir cette hypothèse, car les durées de ces « règnes » ne sont guère compatibles avec ce que laisse entendre la succession traditionnelle des Ages d’Or, d’Argent, d’Airain et de Fer. Nous nous sommes même demandé jusqu’à quel point l’auteur lui-même du Livre de Daniel pouvait être au courant des règles de la doctrine cyclique évoquée par la succession des quatre métaux, et s’il ne se contentait pas de rapporter, sans plus, l’écho peu explicite d’une tradition seulement fragmentairement connue. L’Histoire, de son côté, semble vouloir faire de Daniel un personnage presque légendaire. En outre, la Bible hébraïque ne le range pas parmi les Nebiim, ou Prophètes, mais place son Livre dans les Ketoubim, qui sont des récits hagiographiques. Ce Livre de Daniel, toujours selon l’Histoire, aurait été rédigé peu avant la révolte des Maccabées (104), c’est-à-dire fort tardivement par rapport au règne de Nabuchodonosor. De plus, certaines assertions, dans le récit, seraient erronées. Enfin, on pense que l’auteur, comme tout hagiographe, a pu se complaire dans certains embellissements.
Quoi qu’il en soit de l’authenticité historique du Livre de Daniel, de ses récits disparates ou de sa chronologie incertaine, c’est sous un angle tout à fait différent qu’il nous intéresse ici, et d’autres, avant nous, n’ont pas manqué de s’y intéresser aussi, chacun selon ses curiosités propres (105). En ce qui nous concerne, ce sont les passages se rapportant au songe de Nabuchodonosor qui retiennent notre attention, car nous y constatons une sorte de rencontre entre Hésiode et Daniel : tous deux signalent en effet, au cours du quatrième Age, une césure à laquelle ils attachent, chacun à sa manière, une importance toute particulière.
Hésiode, quant à lui, célèbre l’héroïsme de la première période dont il situe la fin au moment de la guerre de Troie, et dénonce dans la seconde période de cet Age noir une misère s’aggravant de telle sorte qu’à l’approche de son terme, la fourberie, le parjure, le crime sont seuls respectés. Il ne reste plus alors à Zeus qu’à détruire ces gens nés « avec des tempes blanches ».
L’auteur du Livre de Daniel, à son tour, et quels que puissent être par ailleurs ses embellissements de l’Histoire, nous offre sans fioritures, parmi d’autres récits, celui ayant trait à une tradition commune aux plus grands peuples de l’humanité, la tradition fameuse des quatre Ages consécutifs. En ce cas particulier, on ne saurait parler ni d’embellissement ni même d’Histoire proprement dite, car il s’agit d’un exposé purement symbolique, mise à part l’attribution du premier « royaume » à Nabuchodonosor, qualifié pour la circonstance de « tête d’or » (II:38), attribution, du reste, dans laquelle il ne faudrait peut-être voir rien de plus qu’une innocente ou prudente flatterie (106).
Le passage que nous avons trouvé le plus intéressant pour notre propos est celui où Daniel prévoit, dans le quatrième Age, un moment fâcheux où « l’argile boueuse » se mêlera au « fer » solide, jusque là seul souverain : c’est un moment dont nous avons pensé qu’il pouvait désigner l’apparition des Tchandâlas, cette nouvelle « race » issue de divers métissages incongrus. L’auteur n’enjolive rien dans ces lignes, et si elles peuvent s’appliquer à l’Histoire, c’est au lecteur qu’il revient d’interpréter les symboles pour en tirer une intelligence des événements terrestres. L’auteur ne porte pas non plus de jugement explicite, et l’on ne trouve aucune condamnation dans ses paroles. Son compte rendu est d’une sécheresse tout objective, toute professionnelle, sans la moindre trace d’émotion. Il retransmet, sans s’étendre, des choses lues ou entendues dans son milieu.
Si l’on en juge, cependant, par le nombre des versets, Daniel attache une grande attention au mélange du fer avec l’argile, dans lequel il voit l’image d’un métissage sans avenir car il est fait de parties impropres à s’unir (107). Sans doute est-il fort juste, ici, de parler d’alliances ou plutôt de mésalliances humaines, mais le mariage mal assorti de l’argile et du fer est susceptible aussi d’une autre interprétation, qui n’exclut d’ailleurs nullement la première, et qui apparente singulièrement ce que prévoit Daniel aux considérations pessimistes d’Hésiode. En effet, la coupure médiane du quatrième Age, celle de l’an 1240, n’est-elle pas, chez le poète grec, l’annonce d’une sorte de métissage qui serait celui de la mollesse avec la fermeté, de la dissolution avec la rigueur, de la corruption avec la vertu, de la lâcheté avec la bravoure ? Ne retrouve-t-on pas ces contrastes fort adéquatement transposés dans celui de l’argile glissante et complaisante avec le fer et sa rigide âpreté ? Evidemment, cette mollesse dissolue, d’une viscosité croissante, se mêle de plus en plus tragiquement à une brutalité sauvage, et ce n’est plus seulement de couples disparates, de mariages d’individus entre castes différentes, qu’il s’agit, mais de leur résultat déplorable, c’est-à-dire d’un métissage où s’affrontent souvent, au sein même de l’individu, deux hérédités irréconciliables. C’est un tel métissage, nous semble-t-il, qui sévit, comme nous le disions plus haut, dans la « race » nouvelle des Tchandâlas. Bien entendu, les proportions du mélange ne sont pas les mêmes en chaque individu : chez les uns, c’est la mollesse et la soumission qui prévalent, et chez les autres, la rébellion et la violence.
Après ce que nous venons de dire, on comprendra que, pour nous, le clair aperçu de la doctrine cyclique chez Daniel se réfère surtout à l’ensemble du Manvantara (108). Nous en trouvons une confirmation dans le verset qui marque la fin du quatrième « royaume » après sa division. Un nouveau « royaume » va le remplacer, « un royaume qui ne sera jamais détruit » et qui « ne sera pas laissé à un autre peuple ». Ce « royaume », est-il encore précisé, « subsistera à jamais » après avoir anéanti tous les autres « royaumes » (II:44), c’est-à-dire « le fer, le bronze, l’argile, l’argent et l’or » (II:45). Si les quatre Ages traditionnels, qui correspondent à l’ensemble du Manvantara, se trouvent éliminés de l’Histoire et de l’Existence, n’est-ce pas à dire qu’il s’agit de la Fin des temps (109) ?
Telles sont les raisons qui,
nous semble-t-il, autorisent l’acceptation d’une rencontre d’Hésiode
et du prophète Daniel. Sans doute les deux points de vue ne sont-ils
pas parallèles dans les détails, mais loin de se contredire, ils se
compléteraient plutôt. A la différence de Daniel, Hésiode nous fournit,
bien qu’indirectement, une datation précieuse de certains événements
qui les situe dans notre grand Cycle et nous permet ainsi d’y contrôler
quelque cohérence. Mais Daniel, quant à lui, dénonce clairement la
cause de la dégénérescence chez les hommes. Le Grec décrit tout
le déclin de sa « race du fer » à partir de 1240, et sa fin après
que seront nés les malheureux « aux tempes blanches ». L’Hébreu,
de son côté, insiste sur un métissage malvenu, dont le lecteur a
tout lieu de conclure qu’il est la cause de la destruction du dernier
« royaume » et de celle de tous les autres en même temps. Sans doute,
encore, faut-il noter qu’Hésiode déplore amèrement la décadence
des moeurs, alors qu’elle nous paraît laisser Daniel passablement
imperturbable, même si l’on peut penser qu’il n’approuve pas
ces unions inconvenantes : leur disparité entraîne en effet l’absence
de toute « adhésion » véritable et, sous ce rapport, elles se présentent
en quelque sorte comme illicites, puisque, pour reprendre les termes
de Louis Segond, ce sont des « alliances » qui, de manière contradictoire,
n’ « unissent » nullement. Faut-il voir, dans ces appariements insolites,
le résultat des abus et de la démesure que déplore Hésiode ? En ce
cas, le métissage funeste qu’évoque Daniel pourrait bien signer
ces derniers temps que le poète grec présente comme étant celui de
ces hommes qui « naîtront avec des tempes blanches » (110).
c) Valeur transitionnelle des dates médianes
Si l’on veut bien accorder quelque crédit aux résultats de nos trop brèves recherches, on conviendra que l’Histoire elle-même semble témoigner d’un changement de climat dans les moeurs de divers peuples vers le milieu du Kali-Yuga. Cependant, la longueur de cette transition médiane et l’intervention naturelle de cycles secondaires, propres à ces peuples, rendent impossible, historiquement parlant, la détermination d’une date exacte et unique (111). Celle de 1240,23 n’est que la conséquence de résultats obtenus par des calculs se référant à certaines lois cycliques et sur la base d’une Fin de notre Manvantara dont la fixation dans le temps ne peut être que plus ou moins hypothétique. Pourtant, c’est bien vers 1250 avant notre ère que s’affirme le triomphe écrasant de la puissance assyrienne et que vont s’imposer désormais, dans le pillage et les cruautés, ses armées redoutables. Les raffinements d’antan, en perdant de leur délicatesse, empruntent des voies nouvelles. C’est bien vers la même époque aussi, pense-t-on généralement aujourd’hui, que les Mycéniens ont détruit la ville de Troie, et ce qui, encore, confirme la signification dramatique de ce tournant de l’Histoire, c’est, peu après, l’élimination de la riche culture mycénienne par les Doriens. Ce qui nous frappe, un peu partout dans le monde, c’est la fin d’une culture dont la délicatesse, voire le raffinement, s’exprimait de façons diverses selon les pays, et son remplacement par des moeurs autres où dominent une certaine grossièreté, le respect à peu près exclusif de la force, et très souvent la pratique d’une férocité gratuite. Pour toutes ces raisons, il est compréhensible que notre attention soit retenue par ce milieu du Kali-Yuga qui se révèle comme l’époque d’un important changement de « race » devant affecter plus de 3.000 ans d’Histoire (112).
Ceci dit, comment justifier de manière appropriée la valeur transitionnelle de cette date médiane, sinon par quelque explication tirée des faits qui parsèment la descente cyclique, grâce à l’intelligence qu’on peut en recueillir ? Pourquoi les événements qu’elle semble marquer se produiraient-ils au milieu du Kali-Yuga et non pas dans ses premières années ou vers sa fin ? Existerait-il, dans notre Manvantara, d’autres dates évoquant le même type d’événement notable, de brusque transition, et se situant au milieu d’une période cyclique déterminée ? Tel est bien le cas en effet, et nous en rencontrerons par la suite plus d’un exemple. Nous en citerons pourtant un dès maintenant car il est celui d’un désastre dont nous avons déjà parlé dans notre premier chapitre, et qui mit fin à la fameuse Atlantide. Ce désastre, en effet, nous l’avons situé, rappelons-le, en 10.960,23 avant notre ère, et cela en raison de la durée des Races et de l’hypothétique Fin du Manvantara en 1999,77. Or cette date de 10.960,23, justement, divise en deux périodes de même durée le cycle immédiatement antérieur au Kali-Yuga : il s’agit du Dwâpara-Yuga qui s’étend de 17.440,23 à 4480,23. Ici, le milieu du cycle coïncide avec la fin de la quatrième Race dans la catastrophe atlantidienne, et c’est sans doute cette convergence qui explique l’importance de l’événement. Ce n’est pas seulement, comme en 1240,23, le passage de la « race des héros » à la « race du fer », dont se plaignait Hésiode. Ces deux catégories « raciales », rappelons-le, ne couvrent que la dernière moitié de la cinquième et dernière grande Race. En 10.960, en revanche, c’est bel et bien le remplacement tragique de la grande Race atlante par notre cinquième Race. Le gigantisme et la superbe y sont détruits dans un cataclysme à leur mesure (113). Sans doute est-ce le même genre de phénomène qui sévit vers 1240, mais c’est alors à une moindre échelle, comme nous l’avons vu. Cette similitude, tout extérieure du reste, est ce qui a pu amener certains auteurs, par habileté ou par ignorance, à confondre ces derniers événements, secondaires quoique graves, avec la terrible coupure qu’a représentée, dans le Manvantara, la perte de l’Atlantide (114).
Le témoignage platonicien que nous avons longuement cité dans notre premier chapitre, n’est probablement pas de nature à éclairer des esprits trop étrangers aux questions traditionnelles. Ce n’est évidemment pas à eux qu’il s’adresse : il ne comporte aucun argument pour convaincre, mais un simple récit et quelques explications. L’ensemble ne saurait emporter l’adhésion des sceptiques, et ce n’est du reste pas son but. Mais pour qui connaît le « mythe » atlantidien par d’autres sources, il apparaît clairement que Platon sait de quoi il parle. Nous nous sommes, quant à nous, strictement conformé aux indications magistrales que fournit René Guénon sur la tradition atlantéenne, et dont l’intérêt, la mesure et la précision resteront longtemps sans concurrence.
Comme nous le disions plus haut, les deux dates médianes capitales dont nous venons de parler ne sont pas les seules que l’on puisse observer au cours du Manvantara. Bien d’autres se rencontreront dans la suite de notre étude, qui n’en sont que des reflets. Les transitions qu’elles entraînent occupent des durées de plus en plus courtes en se rapprochant de notre époque, ce qui n’en exclut nullement la valeur explicative ni, parfois, la violence sous une forme ou une autre, et toujours, en tout cas, elles témoignent d’un passage remarquable, inéluctable dirait-on, entre une période et la suivante, passage où il n’est pas difficile de constater une détérioration dans les choses et les gens.
Cependant, pour comprendre et expliquer le rôle et la récurrence persistante de ces dates transitionnelles, il ne suffit évidemment pas d’en recenser le nombre et il serait plus satisfaisant de trouver, aussi près que possible des origines mêmes de l’ample Geste humaine, quelque fait d’autant plus signifiant et décisif qu’il assumerait, par sa position initiale, un caractère d’antériorité plus indéniable, plus authentique, plus éminent. Ne pourrait-on découvrir, en climat traditionnel, quelque justification plus sérieuse et probante, enfin, qu’une simple accumulation d’incidents ? Ne serait-il pas possible de repérer, dans le haut passé de notre Manvantara, tel « événement » exemplaire dont l’empreinte se reproduirait à travers le temps, comme sous l’effet d’une loi cosmique ? N’est-il pas d’usage, quand on se réfère à la Tradition, de faire appel à des souvenirs immémoriaux dont quelques-uns se confondent presque avec le mythe, intemporel quant à lui ? Cela ne permettrait-il pas d’en retrouver le parfum et les normes dans des temps plus récents (115) ?
Sans doute est-ce bien, dans une certaine mesure, ce que nous avons voulu faire déjà en rappelant un « souvenir » de l’Histoire que les milieux autorisés s’accordent à discréditer sous ce terme même de « mythe » dont ils font un synonyme de « mensonge ». Le « déluge » atlantidien, en 10.960, n’est-il pas alors, selon toute vraisemblance, le moment transitionnel le plus ancien auquel notre connaissance puisse ou ose accéder sans encourir quelque déconsidération ? Son exemplarité, par sa relative proximité dans le temps, serait peut-être la plus appropriée pour servir de modèle, sur le plan événementiel, à tout hiatus dans l’histoire des siècles ultérieurs. Remonter plus haut que les Atlantes ? Quel intérêt communicable cela revêtirait-il aujourd’hui ? Ne serait-ce pas pénétrer dans l’ère mystérieuse de la troisième grande Race, dans le domaine des spéculations hasardeuses ? Ne serait-ce pas là que les légendes, à vouloir trop se rapprocher des origines, se font de plus en plus étrangères, voire contraires, à l’Histoire ordinaire, parce que cette Histoire est de moins en moins discernable à travers des temps dont l’irréalité chronologique ne cesse de grandir ?
La chute exemplaire de la quatrième grande Race s’effectue dans une sphère déjà plutôt assombrie et dense, où les facultés d’ordre sensible ont pris plus de part que les vertus dans la conduite humaine, et les émois psychiques plus d’importance, dans les préoccupations, qu’un intérêt purement spirituel devenu, d’une façon générale, tout à fait désuet. Aussi cette chute spectaculaire est-elle, comme nous le disions, plus susceptible de toucher, de frapper la conscience de l’homme contemporain, particulièrement réceptive aux modalités concrètes (116), que ne le feraient peut-être d’autres « aventures » plus anciennes, plus proches des origines, plus proches aussi, pour cette raison même, des valeurs essentielles, qui sont moins familières, et par là moins évocatrices pour les esprits de notre temps. Ces « aventures », alors, avaient pour théâtre un monde bien moins « solide » que celui des Atlantes ou, surtout, que celui de la cinquième et dernière grande Race dont nous sommes les rejetons ultimes. La conscience de la durée, en ces « siècles » de légende, n’avait probablement pas grand rapport avec ce sentiment aigu du temps qui nous assaille et nous cerne aujourd’hui.
Or, en dépit de l’ « étrangeté » de ces époques reculées que l’on ne peut guère comparer aux nôtres sous le rapport de la compacité existentielle, mais qui, pour cela même, peuvent être d’une exemplarité plus « éclairante » et plus « principielle », nous y risquerons quant à nous un regard et nous nous autoriserons en outre de l’ère manvantarique, évaluée par René Guénon à 64.800 ans, pour y placer quelques dates correspondant à ses cycles, aussi légendaires qu’apparaissent les relations qui nous en sont parvenues. Les légendes, d’ailleurs, pour autant qu’il s’agisse en ce cas d’événements légendaires à proprement parler, ne sont pas pour offusquer ceux qui s’intéressent aux choses de la Tradition, car elles sont bien souvent le seul héritage qui nous reste du passé et qui nous permette alors, autant que possible, de le rejoindre.
Il est encore un point qu’il convient de souligner. Le repérage d’un tournant fâcheux au milieu du Kali-Yuga, et son renouvellement en mode réfléchi dans des cycles secondaires également terminaux, auraient pu laisser croire que ce genre de faille ne se produit que dans de telles périodes. Or, on l’aura compris, il n’en est rien. La catastrophe médiane du Dwâpara-Yuga nous le montre déjà suffisamment, et l’on en trouve l’exemple reproduit dans les sous-cycles de type dwâpara. En fait, une « coupure » médiane s’observe dans tous les cycles et les sous-cycles que nous avons tant soit peu étudiés. Pourquoi donc ne retrouverions-nous pas le même phénomène dans le Cycle majeur que représente notre Manvantara ? Cette « coupure » initiale, alors, serait comme le « modèle » de toutes les autres, encore qu’au fur et à mesure de l’écoulement des millénaires et des siècles, les reflets du « modèle » soient de plus en plus déformés du fait de la dégradation des choses, au point que l’on n’y retrouve plus guère que des caricatures.
Nous allons, dans ce qui suit,
essayer de remonter à travers la nuit des temps et de découvrir, au
milieu de notre Manvantara, le « modèle » mythique, bien plus
qu’historique, dont les reflets jalonnent les détours nombreux et
compliqués de la descente cyclique.
a) La « solidification »
1. On sait qu’il y a correspondance analogique « entre un cycle principal et les cycles secondaires en lesquels il se subdivise » (117). Chacun de ces cycles secondaires voit donc se répercuter en lui la même subdivision, et cela se reproduit dans des cycles de plus en plus réduits où, en vertu de la même loi, se retrouve, bien qu’amoindrie et finalement déformée, l’image du grand cycle initial.
D’un bout à l’autre de notre Manvantara, sont ainsi déterminées diverses « périodes » où l’influx cyclique, au cours de l’Histoire, se traduit chaque fois de manière similaire en même temps que différente. Les faits qui les illustrent, bien que se trouvant en corrélation avec d’autres qui les précèdent et auxquels ils ressemblent, sont pourtant bien loin de leur être identiques. C’est qu’en effet, ils prennent forcément la teinte du moment nouveau où ils se situent dans la descente cyclique. « Chaque phase d’un cycle temporel, quel qu’il soit d’ailleurs, nous dit Guénon, a sa qualité propre qui influe sur la détermination des événements » (118). Cependant, sous leur teinte « de circonstance », on pourra souvent reconnaître la présence d’une note plus fondamentale trahissant leur analogie avec quelque « circonstance » importante du passé.
Les dates médianes dont nous avons pu remarquer la valeur transitionnelle, devraient alors trouver leur modèle et leur explication dans celle qui signe le milieu de notre Manvantara, 30.400,23 avant notre ère, date établie, dans le cadre de notre hypothèse, selon nos calculs habituels. Inutile de dire qu’il n’est plus vraiment question d’Histoire à pareille époque du moins, si certains événements d’importance ont pu s’y produire en quelque mode que ce soit, on ne peut guère attendre de la science historique, ni de l’Archéologie, ni de la Paléontologie, ni même d’aucune autre science, qu’elles nous en précisent la signification véritable, voire simplement le moment, avec la moindre approximation. Aussi est-il hors de question de se fier à des disciplines scientifiques pour éclairer les « faits de civilisation » qui nous intéressent ici. Faire aujourd’hui, par de tels moyens et en quête d’une telle civilisation, un retour de plus de trente-deux millénaires vers nos origines, serait, c’est le moins que l’on puisse dire, extrêmement décevant. Nous renonçons également, d’ailleurs, aux datations proposées çà et là, car elles varient passablement de l’un à l’autre de nos hommes de science. Surtout, ces datations nous paraissent dépendre trop souvent de croyances que nous savons erronées, bien plus que de constatations « objectives », comme on dit de nos jours, car il s’avère que, dans trop de circonstances, des faits relevés « sur le terrain » sont, avec une partialité délibérée, « mis de côté » pour la « bonne » raison qu’ils viennent contredire des hypothèses chimériques auxquelles s’attachent à peu près tous les cerveaux de l’Occident. Nous nous contenterons, en passant, de donner un aperçu de l’ « objectivité » tant réputée des milieux scientifiques, et qui touche, dans ce cas, à notre sujet.
Ainsi, des empreintes de pas, fossiles, très caractéristiques de celles que laissent les humains, ont été découvertes un peu partout, et notamment dans des roches de la période carbonifère, de même que dans des couches crétacées, où certaines atteignent une longueur de près de quarante centimètres. Elles dateraient, selon les estimations scientifiques, les premières de 250 millions et les dernières de 80 à 90 millions d’années. Or, les boutades recueillies à de telles occasions laissent entendre que la Raison académique oppose à ce genre de vestiges une fin de non-recevoir. Les deux chercheurs respectivement intéressés, Albert C. Ingalls (119) et Roland T. Bird (120), ont, avec d’autres scientifiques, et avec un bel ensemble, déclaré que ces empreintes devaient être d’habiles sculptures faites aujourd’hui par des Indiens (121). Pour ce qui est du Carbonifère, on a également pensé que les empreintes en question auraient pu être laissées à cette époque par quelque amphibien jus qu’ici inconnu…
Tels sont quelques-uns des procédés explicatifs de notre Science. Et cela se comprend. On ne saurait envisager, scientifiquement, que ces empreintes aient pu appartenir à des hommes. Ce serait là une hypothèse irrecevable. Pour plus d’une raison. D’abord, l’homme ne pouvait exister déjà, il y a 80 millions, voire 250 millions d’années, comptées certes selon des critères parfois étranges, mais qui « font foi » dans de tels milieux. Ensuite, la pensée qu’une race d’hommes géants ait pu jadis peupler la terre, ne pourrait effleurer qu’en songe des gens dont l’habitude est de tout mesurer à l’échelle actuelle, et de rejeter, dans les brumes du légendaire, qui pour eux n’est que fabulation, les indices et même les faits qui viendraient troubler leur quiétude routinière (122). Enfin, n’est-il pas quelque peu difficile, pour des scientifiques, de concilier ces empreintes « humaines » géantes, que l’on dit associées à celles de dinosaures au mésozoïque, avec ces ancêtres de l’homme que l’on veut trouver parmi les primates ?
***
2. Selon les concordances cycliques que nous avons établies, la date de 30.400,23 avant notre ère marquerait le milieu des 12.960 années vécues par la troisième Race. Comme elle marquerait aussi le milieu du Manvantara, c’est-à-dire le passage d’une phase de 32.400 ans à une nouvelle phase de même durée, il serait vraisemblable que des changements particulièrement importants pour notre humanité fussent alors survenus dans le déroulement des événements. C’est ainsi que le début du Trêtâ-Yuga, qui se produit selon nos cycles en 36.880,23 avant notre ère, pourrait être envisagé comme un prélude à ces changements et d’ailleurs, il « parait coïncider, nous dit Michel de Socoa, avec l’ère que les préhistoriens appellent le paléolithique ancien et avec ‘l’apparition’ de l’homme sur la terre » (123). Quoi qu’il en soit de ce que l’auteur veut entendre exactement par là, nous rappellerons ce que nous disions, quant à nous, à la fin de notre chapitre III, sur une certaine « fluidité » inhérente à ces époques très lointaines, où l’on avait affaire à un ordre de choses considérablement moins « concret » que celui qui règne de nos jours, et ce, dans tous les domaines possibles. Sans doute s’agit-il, en un tel cas, de réalités que la mentalité actuelle n’accepte pas sans difficulté (124), mais rien de tout cela n’est plus naturel et plus cohérent lorsqu’on a compris que la marche descendante du cycle, en s’éloignant graduellement du principe, s’accompagne, dans l’ordre cosmique et dans l’ordre humain, toujours « étroitement liés », d’une « sorte de ‘matérialisation’ progressive », ou, pour parler d’une façon plus expressive, peut-être, d’une « solidification » toujours croissante (125).
René Guénon revient à plus d’une occasion sur la manière dont se déroule le phénomène. Il s’agit, dans l’ensemble, d’une règle inéluctable : toutes choses, au cours de la descente cyclique, prennent « un aspect de moins en moins qualitatif et de plus en plus quantitatif », et c’est ainsi que se prépare peu à peu et que s’instaure, vers la fin du cycle, le « règne de la quantité ». Du reste, cet aspect quantitatif ne provient pas seulement de la façon dont les choses « sont envisagées au point de vue humain, mais aussi d’une modification réelle du ‘milieu’ lui-même ». Il existe « une corrélation constante entre l’état du monde (…) et celui de l’humanité », d’où résulte une sorte d’opacité grandissante qui, au cours des âges, s’installe entre le cosmos et la perception de l’homme. Les « barrières » du temps, qui s’opposent à la pénétration rétrospective des historiens modernes, résultent de la « myopie intellectuelle » d’une science incapable d’admettre qu’il ait pu exister dans le passé des conditions différentes de celles de notre époque. Or les conditions de notre milieu terrestre ne cessent de se modifier dans le sens d’un durcissement et, soit dit en passant, ce sont ces modifications qui, s’ajoutant à la « myopie » humaine, font trouver aujourd’hui « fabuleuses » des choses qui « ne l’étaient nullement pour les anciens ». Ces choses, d’ailleurs, ne sont pas plus surprenantes, à l’heure actuelle, pour ceux qui ont su conserver « certaines connaissances traditionnelles », et il leur est possible, par exemple, « de reconstituer la figure d’un ‘monde perdu’, aussi bien d’ailleurs que de prévoir ce que sera, tout au moins dans ses grands traits, celle d’un monde futur » (126). La doctrine cyclique, en particulier, permet de comprendre comment la densification progresse chez l’homme et dans le cosmos, dans un jeu d’interactions incessantes.
Parlant de la « solidification du monde », René Guénon la désigne comme « la véritable cause pour laquelle la science moderne ‘réussit’ (…) dans ses applications pratiques ; en d’autres époques où cette ‘solidification’ n’était pas encore aussi accentuée, non seulement l’homme n’aurait pas pu songer à l’industrie telle qu’on l’entend aujourd’hui, mais encore cette industrie aurait été réellement tout à fait impossible ». Le degré qualitatif des choses et des êtres humains s’y seraient alors opposé. Mais aujourd’hui, l’homme, presque toujours amoindri par cette sécheresse et cette rigidité qu’impose en tout domaine le « règne de la quantité », a « perdu l’usage des facultés qui lui permettraient normalement de dépasser les limites du monde sensible, car, même si celui-ci est très réellement entouré de cloisons plus épaisses, pourrait-on dire, qu’il ne l’était dans ses états antérieurs, il n’en est pas moins vrai qu’il ne saurait jamais y avoir nulle part une séparation absolue entre divers ordres d’existence », sans quoi le monde sensible, privé des principes de sa réalité même, « s’évanouirait immédiatement ». Mais, comme on l’a dit, la transparence communicative des choses est maintenant perdue pour la grande majorité des humains « car les réactions générales du milieu cosmique lui-même changent effectivement suivant l’attitude adoptée par l’homme à son égard » (127). Devant un regard aveugle, indifférent, le monde se voile d’une opacité accrue. « A des époques antérieures, où le monde n’était pas aussi ‘solide’ qu’il l’est devenu aujourd’hui, et où la modalité corporelle et les modalités subtiles du domaine individuel n’étaient pas aussi complètement séparées », l’homme « percevait bien des choses » dans un monde qui « était vraiment différent qualitativement, parce que des possibilités d’un autre ordre se reflétaient dans le domaine corporel et le ‘transfiguraient’ en quelque sorte (…). Quand certaines ‘légendes’ disent par exemple qu’il y eut un temps où les pierres précieuses étaient aussi communes que le sont maintenant les cailloux les plus grossiers, cela ne doit peut-être pas être pris seulement en un sens tout symbolique ».
Enfin, pour mieux expliquer les doutes que nous exprimions plus haut quant à la portée d’une quelconque science en ces « matières », et pour réduire à ce qu’elles peuvent valoir les rares traces matérielles de notre lointain passé humain, disons que ces vestiges « ont forcément participé, comme tout le reste, à la ‘solidification’ du monde ; s’ils n’y avaient pas participé, leur existence n’étant plus en accord avec les conditions générales, ils auraient entièrement disparu, et sans doute en a-t-il été ainsi en fait pour beaucoup de choses dont on ne peut plus retrouver la moindre trace ». Du reste, « les archéologues examinent ces vestiges mêmes avec des yeux de modernes, qui ne saisissent que la modalité la plus grossière de la manifestation, de sorte que, si même quelque chose de plus subtil y est encore resté attaché malgré tout, ils sont certainement fort incapables de s’en apercevoir (…). On dit que, quand un trésor est cherché par quelqu’un à qui, pour une raison quelconque, il n’est pas destiné, l’or et les pierres précieuses se changent pour lui en charbon et en cailloux vulgaires ; les modernes amateurs de fouilles pourraient faire leur profit de cette autre ‘légende’ ! »
En guise de conclusion, R. Guénon pose les deux termes d’une alternative qui, d’ailleurs, comme il le remarque, « ne s’excluent point » : « ou bien on voyait autrefois ce qu’on ne voit plus maintenant, parce qu’il y a eu des changements considérables dans le milieu terrestre ou dans les facultés humaines, ou plutôt dans les deux à la fois (…) ; ou bien ce qu’on appelle la ‘géographie’ avait anciennement une tout autre signification que celle qu’elle a aujourd’hui » (128).
Si nous avons cru devoir insister sur les transformations survenues non seulement dans le milieu terrestre, mais aussi dans l’être humain, c’est qu’elles expliquent bien des déficiences de la civilisation qui nous a été progressivement imposée, et que nous en découvrons les conséquences les plus récentes dans notre fin de cycle. Ces transformations ont lieu continuellement, mais elles s’observent plus particulièrement, sans doute, à l’occasion des divers hiatus que nous avons signalés et dont R. Guénon a désigné quelques-uns des plus importants sous le terme évocateur de « barrières ». Il en compte trois depuis la disparition de l’Atlantide, et fait observer qu’il serait inutile, pour les historiens, « de vouloir remonter encore plus loin », car avant qu’ils n’y parviennent, « le monde moderne aura eu grandement le temps de disparaître à son tour » (129). C’est dire que, pour franchir toutes ces « barrières », ce à quoi nous oblige maintenant notre étude, il n’est guère de ressource, à défaut de science historique ou autre, que dans les données traditionnelles qui ont pu nous parvenir.
Nous croyons avoir montré jusqu’ici, à travers quelques textes anciens et en nous référant aux témoignages de ces temps reculés, que si la descente cyclique se déroule, dans l’ensemble, avec une vitesse dont la croissance augmente régulièrement, il se produit pourtant, à certaines époques déterminées, comme des hiatus ou des « chutes », souvent accompagnés de fléaux ou de cataclysmes, et plus ou moins remarquables selon que le « tournant » en question revêt plus ou moins d’importance dans le cycle considéré. Ces points « fractionnels », dans la continuité cyclique, se présenteraient donc, d’après tout ce que nous avons déjà dit, comme des moments de « solidification » plus intense, mais celle-ci se verrait compromise aussi, nous y reviendrons bientôt, par une fragilisation proportionnelle (130). Chaque fois, cela se manifeste par un durcissement dans les choses et un raidissement inquiet chez les gens. Le milieu se fait alors plus opaque à l’homme, et moins pénétrable, tandis que, de son côté, l’homme s’est épaissi, plus aveugle encore qu’auparavant, à la réalité des choses. Cette double aliénation, à chaque nouvelle « chute », ne manque pas de rendre plus incertaine et plus précaire la situation de l’être humain en voie de « solidification ». C’est ce qui se passe généralement aux dates médianes transitionnelles, et c’est aussi ce qui a dû arriver à la troisième Race au milieu de sa course, vers 30.400,23 avant notre ère, mais de façon plus marquée encore, plus décisive sans doute, puisqu’il s’agissait alors du milieu de notre Manvantara.
Cette « matérialisation » dont nous parlons, et qui se traduit par un durcissement et une fragilisation, ne doit d’ailleurs pas être entendue, on l’a bien compris, en un sens strictement corporel, mais comme un phénomène affectant aussi le domaine subtil. Ce phénomène modifie chez l’homme « sa constitution ‘psycho-physiologique’ », et c’est sans doute pourquoi il a été amené à porter au monde sensible une attention de plus en plus exclusive au fur et à mesure de la descente cyclique. Or cet intérêt grandissant pour la matérialité des choses a été un jour transformé en une véritable foi matérialiste, laquelle n’a pu que renforcer cette « solidification » du monde qui l’avait « tout d’abord rendue possible ». C’est que, insistons-y, « les réactions générales du milieu cosmique lui-même changent effectivement suivant l’attitude adoptée par l’homme à son égard ».
Nous n’omettrons pas de rappeler, comme nous y avons déjà fait allusion et comme il est utile de le faire chaque fois qu’on parle de « solidification » à propos de notre monde, que cette « solidification » ne saurait se poursuivre indéfiniment : à mesure qu’elle « avance, elle n’en devient toujours que plus précaire, car la réalité la plus inférieure est aussi la plus instable ». On sait que tout durcissement s’accompagne souvent de « fissures ». Et l’on voit par là que toute nouvelle « solidification », dans le monde, ne peut être « en fait, qu’un pas de plus vers la dissolution finale » (131).
Nous reviendrons plus loin
sur cette question, mais il est utile de savoir, dès ici même, qu’à
chaque tournant médian d’un cycle, lorsque la « solidification »
apparaît à son maximum, c’est en réalité la tendance à la dissolution
qui prend la relève et s’affirme, ce qui manque rarement de se traduire,
dans les sociétés, par des troubles plus ou moins « révolutionnaires ».
b) La révolte des Kshatriyas
1. Aux tendances naturelles que sont, dans la descente cyclique, la « solidification » et la « dissolution », se mêle encore autre chose : il y intervient, de l’avis même de René Guénon, une « oeuvre de déviation » qui agit « en utilisant, en mode ‘diabolique’, les conditions présentes du milieu lui-même » (132). L’idée sera reprise et précisée plus loin où l’on nous dit que l’origine de la dégénérescence actuelle « se rattache à la perversion de quelqu’une des anciennes civilisations ayant appartenu à l’un ou à l’autre des continents disparus dans les cataclysmes qui se sont produits au cours du présent Manvantara ». Ici, une note se référant au chapitre VI de la Genèse, laisse clairement entendre, nous semble-t-il, que la source de la contre-initiation serait à rechercher en quelque époque du cycle atlantéen (133) : en effet, R. Guénon, ailleurs, identifie au déluge biblique le cataclysme qui mit fin à l’Atlantide. En tout cas, on ne saurait rechercher parmi les Atlantes, comme certains nous ont paru le faire, les fameux Kshatriyas révoltés contre les Brâhmanes. Cependant, on pourrait voir, dans la révolte de cette caste guerrière, le « modèle » de plus en plus grossièrement suivi, dans la suite des temps, par les soulèvements, les révolutions et les troubles de toutes sortes, et c’est ce qui a dû se passer chez les Atlantes. Mais nous allons voir les choses d’un peu plus près.
Nous ferons tout d’abord observer que le « satanisme » auquel René Guénon fait allusion à propos de la contre-initiation, représente le « degré le plus extrême » de la dégénérescence. Aussi ne saurait-il concerner que de façon fort lointaine la révolte première des Kshatriyas puisqu’elle est au contraire, semble-t-il, à l’origine même de cette dégénérescence. Cette révolte est d’ailleurs la seule que l’on puisse leur reprocher avec raison, car les autres, que l’on a pu par la suite désigner de leur nom, n’en sont en réalité que des imitations plutôt caricaturales dont le genre est de moins en moins « kshatriya », ou, si l’on préfère, de moins en moins « noble ». R. Guénon, du reste, touche, en passant, à ce sujet. « Cette attitude des Kshatriyas révoltés, écrit-il, pourrait être caractérisée assez exactement par la désignation de ‘luciférianisme’, qui ne doit pas être confondu avec le ‘satanisme’, bien qu’il y ait sans doute entre l’un et l’autre une certaine connexion : le ‘luciférianisme’ est le refus de reconnaissance d’une autorité supérieure ; le ‘satanisme’ est le renversement des rapports normaux et de l’ordre hiérarchique ; et celui-ci est souvent une conséquence de celui-là, comme Lucifer est devenu Satan après sa chute » (134). Pourtant, dans la volonté des Kshatriyas d’imposer « une doctrine tronquée » mais où « subsistent encore certaines connaissances réelles », R. Guénon reconnaît « une attitude qui, bien que condamnable au regard de la vérité, n’est pas dépourvue encore d’une certaine grandeur » (135). Nous sommes loin ici, on le voit, du « satanisme » précédemment associé à la contre-initiation qui se trouve à l’oeuvre à une certaine époque de l’histoire des Atlantes. De fait, R. Guénon apporte une précision qui, pour nous, lève dès l’abord tous les doutes. Il lui suffit pour cela de rappeler « l’histoire de Parashu-Râma, qui, dit-on, anéantit les Kshatriyas révoltés, à une époque où les ancêtres des Hindous habitaient encore une région septentrionale » (136). De plus, autre précision qui rejoint la première, cette rivalité des Brâhmanes et des Kshatriyas « était représentée chez les Celtes sous la figure de la lutte du sanglier et de l’ours, suivant un symbolisme d’origine hyperboréenne, qui se rattache à l’une des plus anciennes traditions de l’humanité, sinon même à la première de toutes, à la véritable tradition primordiale » (137). Tous ces éléments de la Tradition renvoient donc à des temps bien antérieurs à ceux des Atlantes qui vivaient en outre dans une région méridionale (138).
***
2. On ne saurait, nous semble-t-il, être plus clair quant à ce qui nous intéresse ici. Le sanglier et l’ours, à l’origine de ce symbolisme, désignaient deux fonctions qui, loin d’être rivales, et encore moins ennemies, étaient complémentaires. Ce n’est que bien plus tard que l’incompréhension puis l’animosité ont dû naître, et ce, dans le coeur des Kshatriyas surtout. Puisque le Trêtâ-Yuga est considéré comme l’Age où s’établit la prédominance de la caste « administrative » et « chevaleresque », c’est dès le début de cet Age sans doute que se fit jour une mentalité nouvelle, responsable, à la longue, de l’antagonisme qui divisa Kshatriyas et Brâhmanes jusqu’à ce que les premiers se révoltent à proprement parler contre l’autorité spirituelle.
René Guénon, empruntant une expression à Dante, nous dit que « la langue originelle fut tutta spenta dès la fin du Krita-Yuga » (139). C’était déjà l’indice d’un déclin. Cela fut-il sanctionné par quelque cataclysme particulier, un de ces cataclysmes évoqués plus haut et dont R. Guénon nous dit qu’ils sont en relation avec certaines crises de l’histoire humaine ? On pourrait le penser car le moment est d’importance particulière : la seconde Race laisse la place à la troisième, et, surtout, c’est la fin de l’Age d’Or, c’est-à-dire, sans doute, parmi les dates transitionnelles de notre Manvantara, celle qui mérite le mieux le terme de « coupure ». Cependant, nous ne devons pas oublier qu’à cette époque lointaine, qui correspond dans nos calculs à la date de 36.880,23 avant notre ère, les conditions de vie étaient très différentes de celles qui sont les nôtres aujourd’hui, tant sous le rapport des valeurs spatiales et temporelles que sous celui de la densité des choses. C’est dire que le bouleversement dont il est ici question reste finalement un mystère pour les hommes de notre temps (140).
Ce qui est certain, en tout cas, c’est que s’applique ici l’influence particulière de chaque Yuga : à un caractère contemplatif de notre jeune humanité, correspondant au Krita-Yuga, succédait un caractère organisateur et combatif, correspondant au Trêtâ-Yuga. La contemplation, chez les êtres humains, allait céder le pas à l’action. L’énonciation d’un tel fait n’évoque, à première vue, rien de spectaculaire. Rien de bien tragique, pensera le lecteur distrait, rien de semblable à l’effondrement de l’Atlantide. Et cependant, à mieux y réfléchir, on se rend compte qu’il s’agit là d’une véritable césure, d’une véritable révolution, d’un renversement capital de l’ordre des choses.
Au lieu d’une attention toute d’intériorité, voilà l’humanité qui reporte cette attention autour d’elle, dans un souci d’extériorisation (141). C’est bien ce qui se passe à la fin du Krita-Yuga, et donc à la fin de ce que la tradition chrétienne appelle « le Paradis terrestre » et que la tradition hébraïque représente comme « le Jardin d’Eden ». Alors se produit ce que l’on interprète le plus souvent comme l’expulsion d’Adam et d’Eve. Que s’est-il donc passé ? Leurs yeux « s’ouvrirent », dit le texte de la Genèse. « En définitive, commente Leo Schaya, ce sont tous leurs sens qui, dans leur passion, s’affirment au plus haut point et, en se projetant à l’extérieur, ‘percent’ pour ainsi dire l’unité ou l’homogénéité à la fois matérielle et spirituelle de leurs corps de lumière. Auparavant, ceux-ci étaient totalement centrés en eux-mêmes ; centripètes, ils étaient théocentriques : ils s’identifiaient au Centre omniprésent dont ils étaient coextensifs de par leur substance éthérée, apte à se réduire à son propre germe infinitésimal aussi bien qu’à remplir le monde entier ». Le corps glorieux du premier homme « ayant été d’abord comme un seul organe cognitif, contemplatif et unitif de nature micro-macrocosmique, ce corps s’est réduit lors du péché au seul microcosme humain dominé par les cinq sens extériorisés, centrifuges, déifuges » (142)… Cette projection vers l’extérieur, avec laquelle s’accorde si bien ce qui la suit, c’est-à-dire l’image de l’expulsion d’Adam et d’Eve, débouche fatalement sur l’action, comme nous le disions plus haut, et puis, quelques temps après, comme une conséquence de la multiplication progressive de l’espèce humaine et de la rivalité qui l’accompagne, se manifeste une nécessaire combativité. Ce goût pour le combat est bien naturel en milieu guerrier, mais ici, les choses prennent bientôt un tour qui s’avère contraire à l’ordre légitime des choses. C’est ce que laisse entendre la fameuse révolte des Kshatriyas (143).
***
3. Arrivé à ce point de notre développement, quelques remarques sont nécessaires pour une compréhension plus satisfaisante de ce qui va suivre.
Le Trêtâ-Yuga, nous explique la Tradition, est l’Age où prédominent les Kshatriyas. On nous dit aussi que c’est au cours de cet Age que se produit leur révolte contre le sacerdoce brahmanique, révolte ensuite réprimée par Parashu-Râma qui rétablit les Brâhmanes dans leurs prérogatives. Or, si les Brâhmanes reprennent leur rang légitime, qui est le premier, avant même que ne s’achève la période de prédominance kshatrienne, c’est que la simultanéité de ces deux faits n’est contradictoire qu’en apparence. Il n’est donc pas inutile, ici, d’entrer dans certains détails, pour essayer de rendre moins indéchiffrables de telles circonstances.
En vérité, nous ne voyons guère au dilemme posé qu’une seule explication, et qui le résout : la prédominance kshatrienne en question n’est pas à proprement perler celle d’une caste organisée en tant que telle, mais celle d’une mentalité à peu près générale affectant l’élite humaine du Trêtâ-Yuga. Les brâhmanes, dans leur ensemble, se trouvent donc touchés par cette mentalité qui n’est pas, à l’origine, celle de leur caste, mais dont ils vont être de plus en plus imprégnés. Ainsi sont-ils rétablis dans leurs prérogatives et privilèges en tant que Brâhmanes, tout en étant au moins partiellement gagnés par une mentalité de Kshatriyas. C’est d’ailleurs, nous semble-t-il, une telle possibilité que laisse entendre René Guénon lorsque, parlant de la dégénérescence de la vocation intellectuelle des « vrais Brâhmanes » vers une vocation plus spécifiquement religieuse, il l’attribue à des « circonstances diverses » et surtout au « mélange des castes », par la faute duquel il arrive qu’il se trouve parmi les nouveaux Brâhmanes « des hommes qui, en réalité, sont pour la plupart des Kshatriyas » (144). Sans doute est-ce déjà, mais à un degré moindre en ce lointain Trêtâ-Yuga, un semblable appauvrissement spirituel qui, chez beaucoup de Brâhmanes, s’esquisse dans le passage de la contemplation à l’action. Et l’on pourrait peut-être, là aussi, en attribuer la responsabilité à une sorte de métissage, mais ce ne serait alors, du moins avant la fameuse révolte, qu’un métissage de deux pensées, avec pourtant les conséquences que cela risque d’entraîner, c’est-à-dire l’abâtardissement de son élément supérieur sans pour autant que l’élément inférieur s’en trouve sensiblement amélioré.
Cette dégénérescence, qui a dû se faire sentir dès le début du Trêtâ-Yuga, s’est vue suivie de conséquences de plus en plus fâcheuses. Peut-être la caste guerrière s’est-elle illusionnée sur l’ampleur de l’affaissement de l’autorité spirituelle ? Peut-être s’est-elle indûment exagéré ses propres capacités ? Ou, plus probablement encore, a-t-elle perdu le sens des réalités devant ce double mirage (145) ? Il a fallu, de toute manière, qu’elle soit elle- même passablement déchue déjà pour ainsi se laisser induire à une révolte qui non seulement, dans l’immédiat, ne lui apportait que quelques satisfactions d’amour-propre, voire quelques avantages « matériels », mais qui, plus tard, en amenant une désagrégation générale de l’ordre social, devait entraîner, en premier lieu, sa propre perte.
Il est difficile de savoir ce qui s’est passé exactement lors de ce mémorable événement que fut la révolte des Kshatriyas. On ne peut guère s’en faire une idée qu’en remontant jusqu’à elle, si éloignée dans le temps, par une sorte d’induction à partir des révoltes connues qui s’en font l’écho, écho de plus en plus dégradé à mesure qu’on se rapproche des temps actuels. Il semble à peu près assuré, par bien des exemples, que toute insubordination du pouvoir temporel vis-à-vis de l’autorité spirituelle s’accompagne de divers symptômes, à peu près toujours les mêmes en « essence », quoiqu’ils puissent différer quelque peu dans la forme. Nous n’y insisterons pas, mais nous en donnerons tout de suite un bref aperçu, car lorsqu’on les rencontre, au cours de l’Histoire, isolés ou à plus forte raison réunis, ils dénoncent à coup sûr un abus du pouvoir que l’on nommait autrefois « temporel », mais qui n’est plus, depuis assez longtemps, que « politique ».
Toute exaltation du pouvoir temporel ou politique à l’encontre de l’autorité spirituelle s’accompagne généralement de courants tels que l’individualisme ou le naturalisme qui sont toujours, d’une façon ou d’une autre, le premier une négation du Soi, et le second une ignorance de toute transcendance, ce qui revient au même, qu’il s’agisse de l’homme ou de son milieu. On constate parfois aussi l’immixtion d’un point de vue « magique » et la promotion d’un élément féminin dévié, ce qui n’est d’ailleurs pas sans rapport avec certaines puissances de la Nature. On pourrait dire, au fond, qu’il s’agit là tout simplement d’un rejet de toute métaphysique proprement dite au profit d’un domaine physique dans lequel, de surcroît, l’homme affiche, de plus en plus crûment, la prétention de s’imposer.
Il est bien évident cependant, rappelons-le, que tout ce qui vient d’être rapporté doit être convenablement transposé, dès lors qu’il s ‘agit de l’appliquer à des époques très lointaines de l’Histoire, ou plus exactement même, ici, de la Préhistoire la plus reculée.
Ceci dit, il resterait à fixer dans le temps cette importante révolte des Kshatriyas. Nous savons qu’elle a eu lieu au cours du Trêtâ-Yuga. C’est en effet dans cet Age que naquit Parashu-Râma, dans le but exprès de délivrer les Brâhmanes de la domination des Kshatriyas. On dit aussi qu’il anéantit ces derniers dans une région septentrionale, probablement dans ce que les Celtes appelaient la « terre de l’ours » (146). C’est donc bien avant le règne des Atlantes que ces événements se sont déroulés et, comme nous l’avons dit plus haut, nous pensons que la révolte des Kshatriyas, circonstance capitale pour tout le Manvantara, a pu se produire en son milieu, autour de 30.400,23 avant notre ère, point de l’ « Histoire » qui correspond aussi au milieu de la troisième grande Race. C’est une hypothèse au moins plausible, et si ce n’était pas cette fameuse révolte qui sévi à cette date, il resterait à déterminer quel événement a pu s’y dérouler à sa place, et dont l’écho se laisse percevoir, avec de semblables caractéristiques, en diverses dates médianes que nous avons étudiées.
Nous ajouterons encore quelques observations pour mieux montrer combien toutes ces choses se tiennent entre elles jusque dans certains détails. Ainsi, c’est avec l’arme qui le caractérise que le sixième avatâra de Vishnu élimine les Kshatriyas révoltés. Or cette arme offre une signification qui n’est sans doute pas à négliger ici. En effet, selon René Guénon, « la hache de pierre de Parashu-Râma et le marteau de pierre de Thor sont bien une seule et même arme », c’est-à-dire un symbole de la foudre (147). Celle-ci possède « un double pouvoir de production et de destruction », mais, plus justement encore, « c’est la force qui produit toutes les ‘condensations’ et les ‘dissipations’ que la tradition extrême-orientale rapporte à l’action alternée des deux principes complémentaires yin et yang, et qui correspond également aux deux phases de l’‘expir’ et de l’‘aspir’ universels » (148). Ce double pouvoir est donc aussi celui de l’arme de Parashu-Râma : elle est vivificatrice et, du même coup, destructrice des puissances contraires. Il s’agit, en fait, d’un pouvoir de transformation, ce qui n’a rien de surprenant puisque cette arme n’est autre que la hache de Shiva dont celui-ci, un jour, fit don à Parashu-Râma. Finalement, ne faut-il pas voir dans le parashu la réunion des deux pouvoirs qui s’appliquèrent à la race des Kshatriyas ? N’est-ce pas le pouvoir de mort qui extermina ses guerriers, et le pouvoir de fécondation qui rendit ensuite mères leurs épouses par le fait des Brâhmanes ? Ne peut-on pas voir là une certaine « mutation » de la race guerrière et, en somme, sa réhabilitation, du moins à quelque degré ?
Il est encore autre chose, que nous ne ferons que signaler en passant, car il s’agit là de questions assez délicates et qui, pour être convenablement exposées, demanderaient des recherches et des développements débordant le cadre de cette étude. Il n’est donc pas possible de les entreprendre ici, même s’ils pourraient éclairer ces époques lointaines de bien intéressantes considérations. Ces temps, sur lesquels nous avons essayé de jeter quelques lueurs et que les géologues désignent comme étant ceux du paléolithique, ont peut-être plus de rapports que ce que l’on pourrait imaginer aujourd’hui avec le symbolisme de la pierre.
Dans le même ordre d’idées, R. Guénon, après avoir mentionné les « bétyles », évoque le mystère des hommes « nés de la pierre », et « dont la légende de Deucalion offre l’exemple le plus connu ». Il est certain que « ceci se rapporte à une certaine période dont une étude plus précise, si, elle était possible, permettrait assurément de donner au soi-disant ‘âge de pierre’ un tout autre sens que celui que lui attribuent les préhistoriens » (149). Or ces temps méconnus se situent entre notre époque et la fin de l’Atlantide (150). Que dire alors de ces jours encore plus lointains qui virent la révolte et le châtiment des Kshatriyas et qui sont ceux de la troisième Race, à la sortie du Paradis terrestre ? Dans l’esprit de ces époques « chevaleresques », serait-il sans fondement d’examiner le symbolisme de la pierre dans la signification qui le rattacherait à une Déesse primordiale, vierge et mère à la fois ? Et, en rapport avec les questions que nous venons d’aborder, ne faut-il pas se rappeler encore que « la pierre avait aussi une relation particulière avec Kronos »(151) dont on sait les liens avec l’Hyperborée ?
***
4. Puisque nous avons été amené à parler de diverses péripéties de la troisième Race, Race passablement mystérieuse en raison de son éloignement dans le temps, nous ferons état d’un phénomène qui n’est pas sans rapport avec notre sujet et qui, pour la Science qui le constate et le mesure, demeure pourtant, quant à sa cause exacte, une véritable énigme.
Nous avons signalé çà et là au cours de notre travail, mais sans y insister, l’intervention de cataclysmes plus ou moins graves tout au long de la geste humaine. Parmi tous ceux qu’ont relevé les scientifiques, on pourrait établir deux catégories les plus récents, que l’on taxe de « légendes » pour ne pas troubler les esprits dans la quiétude dont on les a toujours bercés, et d’autres tellement anciens qu’ils perdent, pour ces mêmes esprits, toute réalité inquiétante.
Tout en rappelant la prudence dont il ne faut jamais se départir lorsqu’il s’agit de datations remontant à de lointains millénaires (152), nous ne croyons pas sans intérêt d’attirer l’attention sur un article de M. François de Closets paru en juillet 1972 dans la revue Sciences et Avenir : il concerne les inversions magnétiques subies par le globe terrestre au cours des temps. « C’est seulement, dit l’auteur, pendant les années 60 que l’on a définitivement admis la possibilité pour le Nord magnétique de se déplacer d’un pôle à l’autre au cours des âges ». L’article rapporte en particulier une découverte faite en Auvergne par Norbert Bonhommet, de l’Institut de Physique du Globe de Strasbourg : une époque de polarité inverse qu’il aurait décelée entre les années 30.000 et 20.000 avant notre ère. Cette découverte, poursuit M. de Closets, « tendrait à prouver que l’Homo sapiens connut un pôle Sud dans l’Arctique…sans s’en douter évidemment ». Mais cette dernière restriction pourrait être contestée, qui vise à nous faire admettre, sans plus d’arguments, l’ « évidence » d’une primarité mentale chez nos très lointains ancêtres. Aussi Denys Roman la conteste-t-il en passant, dans sa recension de l’article, dont il cite encore, du reste, une phrase intéressante. Il semble, en effet, « que le rythme des inversions magnétiques était beaucoup plus lent dans le passé »(153). Ceci n’apporterait-il pas une illustration scientifique involontaire de ce qu’enseigne la Tradition sur les durées décroissantes des Races humaines et des cycles, que semblent rythmer divers cataclysmes selon ce que nous ont transmis les Anciens ?
En fait, c’est une certaine coïncidence de datations qui nous a conduit à rappeler ces choses. La vie de la troisième Race, dont nous avons relaté quelques événements, s’est écoulée de 36.680,23 à 23.920,23 avant notre ère. C’est dire qu’elle aurait couvert approximativement l’époque de polarité inverse qui prit place entre 30.000 et 20.000. Nous verrons un peu plus loin ce que pourrait représenter la convergence même de ces datations, à la condition, du moins, que celles-ci soient assurées.
Selon un autre article, dû à S. K. Runcorn (154), de Cambridge, « les pôles géomagnétiques nord et sud ont inversé leur position plusieurs fois [au cours des temps]…Le champ s’interrompait soudainement et se reformait avec une polarité opposée » ; « soudaineté », ajouterons-nous, qu’on pourrait dire « cataclysmique ». Du fait de ces variations dans le champ magnétique terrestre, « des changements notables dans la vitesse de rotation de notre planète deviennent alors plus explicables ». En tout cas, « il ne semble pas douteux que ce champ est lié d’une façon quelconque avec la rotation du globe », et il s’ensuit que « l’axe de rotation terrestre a également changé ; en d’autres termes, la planète, vacillant, a déplacé ses pôles géographiques ». Du reste, S.K. Runcorn a relevé quelques-unes des diverses positions que le pôle nord géographique a occupées à l’occasion de ses variations (155).
Ces dernières observations intéressent l’histoire et la géographie anciennes en ce qu’elles pourraient expliquer des variations dans la durée de certaines années, ainsi que la raison de bien des migrations. Pour ce qui concerne notre présente étude, seul un déplacement relatif des pôles géographiques pourrait expliquer, par exemple, une migration importante de peuples fuyant leur pays natal nouvellement entré dans le cercle polaire. Quant à un échange « pur et simple » de pôles entre le nord et le sud, neiges pour neiges, il semble évident qu’à l’exception de « quelques » phénomènes « déplaisants » au cours de l’échange, et de la « surprise » de voir le soleil se déplacer en sens inverse après l’échange, cela n’aurait provoqué aucun changement sensible de climat. Aussi, qu’il s’agisse d’ « un pôle Sud dans l’Arctique », comme il en est question dans le texte de M. François de Closets, ou bien d’un pôle Nord dans l’Antarctique, comme cela arriverait du même coup, on pourrait sans doute s’y tromper après l’échange, pour ce qui est du climat proprement dit. Mais si nous n’avons pas le loisir, ici, de nous attarder à énumérer les « phénomènes » survenant dans ce genre de transfert, il est bien certain que les terriens, quant à eux, et pas seulement les habitants des régions polaires, auraient plus de temps qu’il n’en faudrait, à leur goût, pour en « apprécier » les aspects phénoménaux. Les rescapés, finalement, une fois dissipées les épaisses fumées volcaniques accumulées durant le transfert, auraient tout loisir pour remettre un peu d’ordre et voir, aux pôles, le soleil tourner autour d’eux selon une direction nouvelle (156).
Que l’emplacement des pôles ait changé plusieurs fois au cours des temps géologiques, nous ne pensons pas que cela puisse être contesté, et il ne semble pas non plus que ces changements aient pu se faire sans quelques cataclysmes plus ou moins prononcés. Que certains de ces bouleversements aient eu lieu en des époques historiques relativement récentes, cela nous paraît aussi assez clairement attesté. Mais toutes ces indications manquent évidemment de « détails » tant soit peu décisifs, et, finalement, la science, avec quelques rares exemples localisés, ne peut guère apporter qu’une illustration incertaine à l’appui des affirmations répétées des peuples anciens concernant diverses « fins de monde ».
Ce qui nous paraît assuré,
en tout cas, c’est que les catastrophes terrestres et les tribulations
humaines qui en résultent, ne sont pas que de poétiques fabulations.
Sans doute frappent-elles les imaginations, mais elles sont également
bien réelles, même si elles ne sont rien d’autre que des conséquences
(157), des accidents passagers qui scandent le long déroulement des
civilisations.
c) La révolte des Kshatriyas est un moment déterminant de notre Manvantara
Au terme de cette « enquête », après avoir examiné rapidement la question des cataclysmes et de leurs causes, question qui, bien que secondaire dans le cadre de notre travail, ne pouvait être complètement omise, il est utile de rappeler plusieurs points qui nous paraissent acquis, lesquels, quant à eux, concernent très directement notre propos.
Tout d’abord, si l’origine de la contre-initiation peut être située à un moment donné du cycle atlantéen, peut-être en son milieu, ce qu’on appelle la révolte des Kshatriyas pourrait bien représenter, quant à elle, sinon tout à fait le premier signe de la dégénérescence de notre humanité, du moins une aggravation marquée de cette dégénérescence, et qui devait être sans rémission. Il résulte aussi de tout ce que nous avons vu, que la chose a dû se produire bien avant que les Atlantes, ou quatrième Race, ne se soient imposés, il y a près de 26.000 ans, sur le théâtre du Manvantara. En fait, si, comme nous le disions, la tradition hindoue semble bien placer le châtiment des Kshatriyas, et donc leur révolte, dans une terre septentrionale, il ne nous reste guère d’autre possibilité que de situer ces événements, comme nous l’avons fait, entre la fin du Krita-Yuga et l’origine de la tradition atlantéenne, c’est-à-dire approximativement entre 36.880,23 et 23.920,23 avant notre ère. En effet, on ne peut que difficilement imaginer pareille entorse à la pureté traditionnelle dans un Age comme le Krita-Yuga, celui de la perfection et qui, ne l’oublions pas, porte aussi le nom de Satya-Yuga, ou Age de la Vérité. D’ailleurs, c’est au Trêtâ-Yuga que vivait Parashu-Râma, et ses activités punitives eurent lieu dans une terre nordique, donc pas en Atlantide, terre méridionale c’est dire qu’elles s’exercèrent en quelque moment des deux premiers tiers du Trêtâ-Yuga, et avant que ne commence la migration des peuples du Nord en direction du Sud (158).
Ceci étant admis, encore que sous toutes réserves, le reste est pure hypothèse de notre part, bien que nous trouvions cette hypothèse, nous l’avons dit, tout à fait plausible, et même probable. D’abord, il nous semble fort peu vraisemblable que les événements « révolutionnaires » dont nous parlons, se soient déroulés très près de ces limites de 56.880,23 et de 23.920,23, qui sont celles de la troisième Race ; et il se trouve, d’autre part, que le milieu de cette Race et celui de notre Manvantara se rencontrent à cette époque en un même point de l’Histoire, qui a dû représenter, dès lors, nous l’avons dit, un moment capital de notre humanité. C’est pourquoi nous avons choisi de placer vers cette date de 30.400,23 la fameuse révolte des Kshatriyas ; nous y voyons l’archétype de toutes les dates médianes ultérieures et, phénomène déjà en lui-même luciférien, le point de départ d’une dégénérescence graduelle des Races et des castes qui ne devait plus avoir et n’aura plus de cesse avant la fin de notre cycle.
Après avoir insisté, dans
nos dernières lignes, sur quelques points saillants de ce chapitre,
nous essayerons, au cours des pages qui suivent, de justifier l’importance
qui paraît s’attacher aux tournants médians des cycles. Les quelques
exemples que nous avons fournis jusqu’ici nous semblent assez éloquents,
mais un certain nombre d’explications complémentaires ne seront pas
inutiles, et pourraient même donner à penser qu’il s’agit là
d’un vaste phénomène naturel ou, plus justement peut-être, d’une
loi omniprésente dont on retrouve l’application dans les aspects
les plus inattendus de la Manifestation universelle.
a) « Solidification » et
« dissolution » dans la succession et la simultanéité
1. Il faut « prendre garde de ne pas appliquer à des cycles particuliers et relatifs ce qui n’est vrai que de l’Univers total, pour lequel il ne saurait être question d’évolution ni d’involution ; mais toute manifestation est du moins en rapport analogique avec la manifestation universelle, dont elle n’est que l’expression dans un ordre d’existence déterminé ». Ces précisions une fois apportées, René Guénon les complète en nous rappelant que « le maniement de l’analogie » reste d’un usage « assez délicat » (159).
Aussi procèderons-nous avec toute la prudence permise par ce que nous pouvons posséder de discernement, et en nous appuyant sur l’autorité de René Guénon. C’est surtout dans son étude sur les dualités cosmiques, datant de 1921, que nous choisirons, parmi toutes les observations de l’auteur, ce qui intéresse plus particulièrement notre propre travail, c’est-à-dire certains aspects de la cosmogonie concernant le cycle et son milieu. Nous y relèverons en premier divers caractères des deux phases du cycle cosmique, puis nous examinerons le résultat de leur rencontre en son point médian, et enfin nous tâcherons d’indiquer, à très grands traits, comment les influences cosmiques nous paraissent se faire sentir sur le comportement de nos contemporains.
***
2. Les dualités multiples que l’on constate dans les choses, nous dit René Guénon, se présentent comme les divers modes de l’unique Dualité qui se trouve à l’origine de l’Existence. On voit sans doute parfois, dans certaines de ces dualités, le fait d’un antagonisme, et cela peut bien n’être pas purement imaginaire. Mais souvent, c’est parce qu’on l’y cherche, qu’on y trouve un effet de l’opposition du bien et du mal, « point de vue tout humain ». A un tel point de vue échappe naturellement le jeu du complémentarisme des forces en présence, lequel possède un degré plus profond de réalité que celui de l’opposition (160). Cette conscience de la réalité profonde des choses, si elle échappait au point de vue de la morale en 1921, n’en échappe d’ailleurs pas moins aujourd’hui à l’immoralisme de rigueur dans la course à l’enflure égotiste et expansionniste. Mais qu’il s’agisse de complémentarité ou d’opposition, retenons que cette rencontre, pacifique ou belliqueuse, est permanente depuis l’origine jusqu’à la fin d’un cycle.
Au cours de son étude, René Guénon, en comparant diverses théories, présente celle du Dr. Gustave Le Bon qui distingue « entre deux phases radicalement opposées de l’histoire du monde(…) : d’abord condensation de l’énergie sous forme de matière, puis dépense de cette énergie », c’est-à-dire, comme l’ajoute Guénon, « dissociation de la matière », notre période actuelle, soit dit en passant, correspondant à cette seconde phase.
En ce qui concerne ces deux phases successives du cycle, on peut aussi prendre en considération le froid, principe de condensation, et le chaud, principe d’expansion. On dira alors que, pendant la première phase, « l’abaissement de la température traduit une tendance à la différenciation, dont la solidification marque le dernier degré », et que, dans la seconde phase, « le retour à l’indifférenciation devra, dans le même ordre d’existence, s’effectuer corrélativement, et en sens inverse, par une élévation de température » (161), aboutissant ainsi à la dissolution. Et dans ces conditions, la fin du cycle sera, comme il se doit, analogue à son origine, c’est-à-dire immatérielle.
Ce que nous relèverons, ici, c’est que la tendance à la différenciation conduisant à l’individualisation, la tendance contraire devrait entraîner avec elle une régression de ce processus d’individualisation, et c’est ce qu’il n’est pas toujours facile de percevoir clairement aujourd’hui. Encore pourrait-on en trouver quelque approximation, peut-être, dans les phénomènes de masses dont notre époque est le théâtre, et où les individus, souvent pour fuir leur propre désolation ou combler leur propre vide, abdiquent leur individualisme, voire même, dans la mesure du possible, leur individualité, et ce, afin d’aller se fondre dans quelque âme collective (162). Cependant, ces mouvements de foule où se dissout l’individu, semblent contredire l’individualisme forcené de cette même époque où le goût de l’indépendance, l’égocentrisme, l’égoïsme sont devenus monstrueux. Mais cette contradiction ne provient-elle pas précisément de l’interdépendance des deux tendances dont nous parlons et qui se prolonge tout au long du cycle, même si, de nos jours, la tendance « dissolutive » se fait de plus en plus prépondérante ?
En effet, la Dualité première que nous évoquions au début, de ces considérations, exerce son influence partout dans le Monde, et à tout instant dans le déroulement puis dans l’enroulement du cycle. Aussi les deux processus cosmiques de « condensation » et de « dissipation » ne sont-ils pas, à proprement parler, consécutifs, mais bien simultanés. S’il y a succession, malgré tout, ce n’est donc pas celle des deux processus conçus comme indépendants l’un de l’autre, mais celle de leurs tendances à la prédominance, chacune s’imposant à l’autre à son tour. Par exemple, lorsqu’on envisage les termes de la première Dualité sous le symbolisme du Ciel et de la Terre, comme le fait notamment la tradition chinoise, on constate que, dans la première partie de la descente cyclique, ce sont les influences terrestres qui tendent à prévaloir, alors que dans la seconde partie, ce sont les influences célestes qui l’emportent peu à peu, réalisant, les unes avec les autres, d’abord la « condensation » puis la « dissipation » du Monde manifesté.
Toujours sous le rapport des deux tendances qui, au cours des cycles, s’interpénètrent sans se confondre, on pourrait, de façon plus explicite peut-être, parler encore des « attractions respectives du Ciel et de la Terre », ces deux pôles de la Dualité primordiale : toute attraction à un pôle produit une « condensation » à laquelle correspond, au pôle opposé, une « dissipation », double mouvement garant, dans le cosmos, de l’équilibre total. Ainsi, à chaque stade de la première phase cyclique, toute « condensation » d’ordre substantiel s’accompagne d’une « dissipation » d’ordre essentiel et, de même, à chaque stade de la seconde phase, toute « condensation » d’ordre essentiel s’accompagne d’une « dissipation » d’ordre substantiel (163).
Il est du reste une autre façon d’envisager l’écoulement du cycle, et c’est en tenant compte de l’activité de deux principes que l’on désigne dans la tradition hindoue comme Vishnu, celui qui conserve les êtres individuels dans leurs limitations à première vue confortables, et Shiva, celui qui détruit ces limitations, mais qui, au gré de cette transformation souvent inconfortable, donne accès « à la plénitude de l’être » (164).
Les temps que nous vivons aujourd’hui sont les temps ultimes de notre Manvantara et, de ce fait, ils sont soumis, plus que tous les autres, aux conditions matérielles et pesantes, car ils se situent au milieu même de notre Kalpa, où ces conditions sont à la fois les plus contraignantes et les plus instables. Il convient ici de souligner la rencontre de ces deux conjonctures : celle du Kalpa arrivé au tournant capital où son durcissement va céder la place à la tendance inverse, et celle du septième Manvantara qui touche à sa dissolution. Telle est la concordance logique des lois cosmiques.
***
3. Après avoir distingué les deux phases du mouvement universel et montré l’interaction incessante des deux tendances qui le caractérisent, venons-en maintenant à l’étude sommaire du point médian qui sépare ces deux phases et les unit en même temps. C’est en ce point que les deux tendances, adverses ou complémentaires, s’affrontent avec le plus d’opiniâtreté, car elles s’y rencontrent, pour ainsi dire, avec des « énergies » égales, alors qu’en tout autre point du parcours cyclique, l’avantage favorise toujours plus ou moins l’une ou l’autre d’entre elles, qu’il s’agisse de la « solidification » ou de la « dissolution ».
Lorsque Dante nous décrit, dans sa Divine Comédie, le séjour de Lucifer, ce qu’il nous expose, en fait, à travers ces images symboliques, ce sont précisément les conditions correspondant au milieu du cycle cosmique. C’est « le point le plus bas », aboutissement de la phase descendante et origine de la phase ascendante, phases où se manifestent successivement la prédominance de tamas, puis celle de sattwa, c’est-à-dire celle des « forces de contraction et de condensation », puis celle des « forces d’expansion et de dilatation ».
C’est le lieu où triomphe la tendance à l’individualisation avec toutes ses limitations. Ce séjour de Lucifer est ce que Dante appelle « il punto al qual si traggon d’ogni parte i pesi » (165), c’est-à-dire, ajoute René Guénon, « le centre de ces forces attractives et compressives qui, dans le monde terrestre, sont représentées par la pesanteur » (166). A partir de là s’effectue pour Dante « un changement de direction » car il aborde maintenant la phase ascendante de son « voyage » (167). Ce passage, qui symbolise celui de la première à la seconde phases du cycle, est pour nous, ici, d’un grand intérêt. Suspendu au cou de Virgile, Dante le suit dans une manoeuvre assez particulière. Virgile, s’accrochant aux flancs velus de Lucifer, descend le long de son corps, et, à un point que marque sa hanche et qui représente le centre du Monde ou du cycle, tourne la tête là où il avait les pieds et se met ainsi à grimper le long des jambes de Lucifer pour s’arracher, avec Dante, de l’Enfer. Sans parler du fait que ce retournement semble bien être une allusion à une formule initiatique illustrant notre sujet, il est très évocateur aussi de ce basculement dont nous avons souvent parlé à propos du franchissement des points médians dans diverses périodes cycliques.
Sous le rapport de ce renversement dans l’ordre des choses, René Guénon nous rappelle encore que « si l’on considère le milieu du cycle cosmique en regardant les deux tendances comme agissant simultanément, on s’aperçoit que, loin de marquer la victoire complète, au moins momentanément, de l’une sur l’autre, il est l’instant où la prépondérance commence à passer de l’une à l’autre » (168). Il s’agit donc d’un point où l’équilibre est fort instable (169), et lorsqu’on y parvient, au cours d’un cycle historique, il n’est guère surprenant que l’on y constate des changements parfois importants dans le domaine des idées et de la vie sociale, jusqu’à provoquer même des troubles, voire de véritables révolutions.
En fait, dès le début du Manvantara, bien avant la révolte des kshatriyas, au coeur même de la période paradisiaque où s’écoulent successivement deux grandes Races, le phénomène médian, dont l’impact est universel, se fait sentir plus d’une fois dans des combats redoutables qui s’avèrent finalement lourds de conséquences. Mais comme il s’agit alors de la première phase du cycle, c’est la « solidification » qui, en chaque occurrence, accroît peu à peu sa prédominance, en même temps que la pesanteur sévit et entraîne les « chutes » (170). Au cours de la seconde phase, en revanche, c’est la tendance « adverse » qui va prendre la relève : à chaque moment médian, lorsque se rencontrent, « à forces égales », les deux tendances dont nous parlons, le processus densificateur, de moins en moins prononcé, doit céder le pas à la tendance « dissolutive » qui va s’affirmer avec de plus en plus d’évidence jusqu’à la fin du cycle.
***
4. Tout au long des temps, s’enchaînent les périodes cycliques. Cependant, au fur et à mesure qu’elles se rapprochent de leur fin et que se réduisent leurs durées respectives, il va de soi que les moments médians sont de plus en plus voisins les uns des autres, chacun suivant de plus en plus rapidement le début de la période qu’il divise, et précédant avec la même célérité sa fin. Les événements se succèdent à une vitesse qui ne cesse d’augmenter, et vont jusqu’à se chevaucher bientôt dans le plus grand désordre, comme on le constate aujourd’hui autour de nous. Alors, ce chaos événementiel s’ajoute à la déliquescence des moeurs et de toutes choses dans le climat général de « dissolution » qui s’accentue à tout instant.
Telles sont les caractéristiques principales de la descente cyclique, mais le mouvement en est sans doute bien trop lent, par rapport à celui de la succession des générations humaines, pour que les gens, à chaque époque, en prennent vraiment conscience, surtout pendant la première phase du processus. Il en va d’ailleurs à peu près de même au cours de la seconde phase, à cette exception près que dans les dernières années, et particulièrement aujourd’hui, les choses paraissent se dessiner avec moins d’incertitude. D’une part, l’accélération de notre chute s’est tant accentuée que quelques-uns de nos contemporains, de moins en moins rares, ne manquent pas de la percevoir, ne serait-ce qu’à cause de la corruption qui, au cours d’une seule et même génération, est passée d’une activité relativement restreinte ou discrète, à une activité multiforme, sans vergogne et même ostentatoire, progrès très net de la dissolution dans notre monde. D’autre part, en dépit du désordre dont nous parlions plus haut, et de l’abrutissement qui en résulte, on n’a pas été sans remarquer des phénomènes curieux qui s’étalent partout autour de nous et que l’on attribue, sans y voir plus de malice, aux caprices de la mode. Or il ne serait peut-être pas si difficile de deviner, sous ces phénomènes très courants, des effets excessifs que l’on pourrait rapporter à telle ou telle influence cosmique.
Quoi qu’il en soit, ce qui nous frappe, quant à nous, c’est l’apathie dont la plupart des gens font preuve devant ce que nous venons de résumer. Et parmi ceux, peu nombreux, qui font observer d’évidentes anomalies, il n’en est à peu près point qui en dénoncent les véritables causes. Quelques voix ont protesté, mais elles se sont perdues dans le brouhaha général, bien que « récupérées », conclusion dérisoire, par des mouvements « politiques » de contestation systématique ayant précisément pour but de décomposer le tissu social. Certes, on remarque bien, de temps à autre, telle expression d’inquiétude, tel propos fort raisonnable dans son analyse critique, mais l’on a si habilement accoutumé les foules à l’anormalité, que sa dénonciation même leur semble tantôt insolite dans l’indifférence concertée des « responsables », et tantôt purement anecdotique dans l’incohérence des « informations » médiatisées.
Malgré les difficultés de l’entreprise, malgré l’enchevêtrement
actuel des influences cycliques,
peut-être serait-il possible d’en repérer quelques effets, en notre
époque terminale, dans certains cas exemplaires de la vie contemporaine.
Aussi allons-nous essayer de découvrir, dans la société qui nous
entoure, les traces éventuelles de la « dissolution » et de la « solidification »
que suscite la force cosmique : nous tâcherons de discerner ces deux
tendances sous les formes qu’elles paraissent adopter pour « rivaliser »
encore entre elles aujourd’hui, puisque telle est la manière dont
s’applique souvent, en notre monde, la loi de la Dualité.
b) L’attraction du Ciel
1. Si l’on garde en mémoire la complexité des influences cosmiques découlant de la Dualité primordiale, influences dont nous avons essayé de donner plus haut quelques exemples, on comprendra que nous ne puissions guère, ici, relever, en cette époque ultime, que certains de leurs effets probables parmi les plus éloquents ou les plus visibles. De fait, nous nous attacherons surtout à déceler ce qui relève de l’attraction du Ciel, car elle est évidemment prédominante en ce moment extrême de notre cycle, et c’est elle, en définitive, qui déterminera la dissolution du Monde manifeste. Or cette attraction, dès aujourd’hui, s’affirme par un certain « dépouillement » des formes corporelles, et l’on sait bien qu’en vertu de la règle, « ce qui est ‘dissipation’ sous le rapport de la substance est une ‘condensation’ sous le rapport de l’essence » ? Mais pour se faire une idée plus juste des choses, et en vue aussi de ce qui va suivre, il est utile de rappeler une restriction faite à ce sujet par René Guénon. Certes, l’attraction du Ciel, par son action « dissipatrice », entraîne le retour des « composés individuels(…)à leurs principes originels ». Cependant, l’auteur apporte plus loin une précision très limitative. Cette « dissipation », écrit-il, est un « mouvement de retour vers le non-manifesté, ou tout au moins », corrige-t-il aussitôt, « vers ce qui, à un niveau quelconque, y correspond en un sens relatif » (163). Comme nous le verrons à loisir, cette restriction souligne judicieusement la relativité de bien des choses.
En ce qui concerne, par exemple, la « condensation » d’ordre essentiel, qui semblerait devoir logiquement se produire avec plus de facilité en fin de cycle en raison de l’attraction du Ciel, il serait imprudent de se prononcer. Peut-être cette attraction devrait-elle se manifester par un regain d’élévation spirituelle, mais il va de soi que, de toute manière, celle-ci ne pourrait être que fort discrète, et d’autant plus, d’ailleurs, qu’elle serait plus élevée. Elle en serait donc d’autant moins discernable pour les regards extérieurs. A cette discrétion s’ajoute le fait qu’une notable extension de la spiritualité serait assez difficilement imaginable dans nos milieux « évolués » où les esprits sont imbus de matérialisme, et les corps considérablement alourdis d’une matérialité qui n’a jamais été aussi pesante. Dans de telles conditions, le nombre des élus que favoriserait le souffle spirituel devrait être fort restreint, comme le prévoient les Écritures. Mais en ce domaine purement qualitatif, le nombre n’est-il pas un critère de bien piètre valeur, et l’Esprit, en outre, ne souffle-t-il pas où il veut ?
Afin que l’on comprenne mieux ce dont il s’agit ici, et que, s’agissant de « condensation » et de « dissipation », l’on acquière une notion plus pertinente de ce que peut être l’emprise de l’esprit sur le corps, afin aussi de montrer, par là, à quel degré de transcendance peut atteindre l’élan de la spiritualité, nous mentionnerons le fait exemplaire, mais fort rare, d’une « condensation » d’ordre essentiel appelant une « dissipation » correspondante d’ordre substantiel. Le phénomène se produit alors de façon tout à fait remarquable, car on y observe une véritable disparition de la substance corporelle dans les moments qui suivent la mort, c’est-à-dire à la fin d’un cycle individuel humain. La forme corporelle, au lieu d’être abandonnée, comme c’est la règle la plus générale, passe par résorption à l’état subtil ou parfois même à l’état non-manifesté, sans laisser aucune trace sensible (171). Mais ne serait-il-pas abusif, dans ce cas très particulier, de parler d’une « dissipation » de la substance corporelle, alors qu’il s’agit au contraire pour ce corps d’une véritable « intégration » ? Quand, au moment de la mort, il y a dissipation des éléments corporels, comme c’est le cas le plus général, n’est-ce pas, dans une certaine mesure, une perte pour l’être concerné, alors que si, par exception, ils sont « spiritualisés », c’est au contraire un gain, un gage de cohésion et d’unité plus parfaites, un signe d’achèvement (172) ? Aussi, peut-être est-ce là un exemple qui dépasse de très haut ceux qu’il est permis d’examiner aujourd’hui en ce qui concerne les « condensations » et les « dissipations » multiples qui font l’objet de cette étude.
Dans un ordre d’idées beaucoup plus modeste, on pourrait parler de l’ascèse, qui n’est qu’une voie conduisant vers le haut, et qui, dans ce but, consume les « écorces » corporelles et psychiques. Plus simplement encore, il serait possible d’envisager quelque grande élévation d’esprit qui détourne l’homme des tentations corporelles. Il ne serait pas inexact d’admettre, dans ces conditions, que l’attention spirituelle remplace peu à peu, dans les âmes et dans les corps, leurs préoccupations les plus dérisoires et les plus grossières. Tout alors n’est plus qu’une question de degré. Mais comme nous le disions ci-dessus, ce sont là des choses dont il est difficile de mesurer l’ampleur car leur caractère intime ne se dévoile guère. Aussi, comment pareille voie tenterait-elle un nombre appréciable de nos contemporains ? N’adhèrent-ils pas toujours, de préférence, à ce qui s’offre à eux de plus spectaculaire ?
Or à chaque sensibilité correspond dans le monde, en toute équité, un moyen de la satisfaire…
***
2. La vraie spiritualité ne se donne pas en spectacle. Aussi n’est-elle jamais flagrante, et pour satisfaire les curiosités peu difficiles, il n’est de séduisant, dans nos moeurs actuelles, qu’un ensemble de pratiques aberrantes, souvent « exotiques », où certains croient découvrir des fins spirituelles. Ce qui distingue cette fausse spiritualité de la vraie, c’est qu’il s’agit ici de démarches « libres », dites « sauvages », que l’on entreprend sans aucune aide réellement qualifiée. On déserte les religions, auxquelles d’ailleurs on est généralement hostile, alors qu’au contraire, dans les groupes « mystiques » à la mode, on se confie à d’étranges « gourous ». En fait, ce n’est là que trahison pure et simple de toute authenticité, trahison que scelle une dangereuse confusion du psychique et du spirituel.
La vogue contemporaine et déjà vieillie des « sciences » parapsychologiques (173), tous les « retours » en force du « spirituel » dont les médias se font l’écho depuis quelques années, toutes ces activités qui obéissent au New Âge, tous ces mouvements, enfin, axés sur la fréquentation de zones souvent suspectes du psychisme, représentent incontestablement une emprise de mode subtil sur bien des esprits de notre temps (174). Or, s’il convient de distinguer nettement entre « subtilisation » et spiritualisation, du moins faut-il admettre qu’au gré de ces activités psychiques, il intervient des « forces » appartenant à un domaine relativement plus proche du Non-manifesté que ne le sont les énergies musculaires et mentales en jeu dans notre monde ordinaire. Du reste, il s’exprime, dans ces diverses tendances, un désir évident d’échapper aux courants matérialistes ambiants, et sous ce rapport elles se rangent à juste titre sous l’influence de l’attraction du Ciel. Ce n’est pas pour autant qu’il faudrait y voir le moindre essor spirituel. Et souvent, même, les naïfs sont tombés de Charybde en Scylla (175).
Il est intéressant, en tout cas, de noter que certaines de ces compromissions avec le monde intermédiaire favorisent, bien plus souvent qu’on ne se l’imagine, chez ceux qui participent à ces « expériences », une véritable « dématérialisation », même si celle-ci n’est que partielle et passagère (176). Sans doute cette dissociation de la « matière » humaine se rapporte-t-elle bien, apparemment, à la « dissipation » d’ordre substantiel que suscite l’attraction du Ciel, mais il n’en est rien en réalité. Comme cela se passe dans toute décomposition des tissus nécrosés dont les produits entrent ensuite dans la composition normale d’autres organismes, il s’agit ici, mais à partir de tissus vivants, d’une sorte de transfert, et les éléments subtils et corporels qui disparaissent d’un côté sont immédiatement réutilisés, par exemple, pour la matérialisation ectoplasmique. Pourtant, outre la distinction notable qui sépare les deux catégories de tissus envisagées, il est encore une différence entre les deux processus, et c’est que, dans notre exemple, à l’inverse de ce qui a lieu dans la décomposition des cadavres, la durée du transfert n’est dans l’ensemble qu’assez éphémère, et que les éléments d’abord dispersés retournent théoriquement à leurs possesseurs légitimes : or, c’est alors que peuvent arriver divers accidents responsables de situations ou de troubles ultérieurs plus ou moins malsains (177).
De spiritualité, du reste, en tout cela, on comprend qu’il ne saurait être question, et ce qui se passe dans de tels phénomènes, y compris le mécanisme de la « dématérialisation », est évidemment sans aucun rapport avec la « condensation » d’ordre essentiel dont nous parlions plus haut.
Il est enfin bien entendu que si l’humanité se rapproche, à l’heure actuelle, du Non-manifesté dont elle est jadis sortie, ce ne peut être en soi un gage de spiritualité. C’est le moins que l’on puisse dire, et il suffit, pour s’en convaincre, d’assister au spectacle que nous donnent les humains. Du reste, ne l’oublions pas, le Non-manifesté « commence » aux deux Pôles de notre Manifestation universelle, et si l’un est l’Essence, l’autre est la Substance, celle-ci n’étant, en somme, qu’une réserve de potentialités à la disposition de celle-là.
La dissolution du monde grossier, il devrait être superflu de le rappeler, n’implique nullement, comme en une sorte de contrepartie, la promesse d’un accès aux sphères spirituelles. Tant s’en faut. Contrairement à ce que s’imaginent beaucoup de gens, aujourd’hui, la mort ne confère d’autre degré d’élévation que celui dont le mourant s’est rendu digne au cours de sa vie. C’est ce qu’ignorent aussi, et c’est plus curieux, bon nombre d’initiés ayant dépassé la « Maîtrise » dans des Organisations pourtant réputées authentiques.
Il est clair, pour ceux qui ne se payent pas de mots, que le « renouveau spirituel » qui distrait un certain public depuis quelques années, ne saurait être comparé qu’à de vaines et confuses aspirations. Toutes ces démonstrations éclectiques, dans leur ensemble, sont loin de pouvoir soutenir la comparaison avec ce dont il s’agissait au tout début de ces considérations sur l’attraction du Ciel. Comment le pourraient-elles, d’ailleurs, face à cette « condensation » d’ordre essentiel qui, à un degré tout à fait éminent de spiritualité, appelle à s’accomplir une « dissipation » correspondante d’ordre substantiel, « dissipation » qui n’est alors rien d’autre, en vérité, qu’une « intégration » de l’évanescent dans l’immuable, du temporaire dans le final.
***
3. Même si elle se trouve sans rapport avec les préoccupations spirituelles, il existe une « dissipation » d’ordre substantiel qui n’en est pas moins intéressante, ni moins répandue, bien au contraire, et que l’on pourrait attribuer, elle aussi, avec plus de probabilité encore, peut-être, à l’attraction du Ciel. Cette « dissipation » est celle qui vise actuellement la nature corporelle sous presque toutes les formes qu’elle comporte dans notre monde terrestre. On peut, à ce sujet, se livrer à des observations diverses et, parfois, d’apparence contradictoire. Parmi les exemples qui vont suivre, certains ne proviennent que de bribes d’informations recueillies dans les médias, médias dont on sait en outre que la fiabilité est souvent douteuse. Cependant il est clair que l’on ne saurait écarter ces témoignages de façon systématique : sans doute sont-ils fragmentaires, contradictoires certes, mais cela ne retire pas la vérité de tel ou tel détail. Enfin, ce que nous disent les médias représente, malgré les lacunes et les incertitudes, toute une gamine de renseignements que nous pouvons corriger et compléter par ce que nous voyons et entendons autour de nous, saisi sur le vif.
Outre les incendies de forêts qui ravagent régulièrement des centaines de milliers d’hectares, et que les pouvoirs semblent renoncer à limiter, il n’est pas rare que l’on signale, de part et d’autre dans la presse, au gré d’articles plus ou moins complets, l’extinction croissante d’espèces animales, et l’on s’en inquiète parfois comme d’un signal de mauvais augure. On entend aussi parler d’épizooties catastrophiques, lesquelles, souvent dues à la contagion, ne manquent pas de troubler l’opinion (178). Tout cela nous semble répondre bien ironiquement à l’obsession maladive de croissance générale et systématique, obsession qui entraîne notre humanité vers une fin qu’elle croit pour l’instant impossible, et qui va cependant lui échoir à très court terme.
En attendant, le capital corporel humain, tel un redoutable présage, ne cesse d’augmenter, si l’on en croit les chiffres officiels, en dépit des cadavres qui s’accumulent, sur tous les continents, à la faveur des rébellions, des guerres civiles et des hécatombes diverses qui semblent devoir se multiplier partout. Ainsi, la croissance numérique de la population mondiale se trouve en quelque sorte corrigée, sinon très sérieusement dans ses chiffres peut-être, en tout cas dans sa signification, par l’amoindrissement corporel qui résulte de toutes ces morts. De plus, nous allons voir qu’à côté de cet amoindrissement dramatique, il en est encore un autre, non moins grave, qui frappe de nouvelles catégories humaines, d’ailleurs de plus en plus importantes, elles aussi. Or si, dans les guerres, on tue de propos délibéré, et pour ainsi dire sous contrôle, il s’agit, dans ce dont nous allons parler, d’un désir inconscient d’extinction, et qui s’exprime par des voies sournoises.
En effet, outre les divers cas de morts globales et brutales qui amputent les sociétés humaines d’une part corporelle importante (179), il faudrait sans doute prendre en considération certains phénomènes de « macération » ridicule, certains processus de dissolution qui frappent dans leur chair des êtres toujours plus nombreux. Ces phénomènes et processus, dans leur expression individuelle, nous paraissent relever aussi, et de façon beaucoup plus significative, de la « dissipation » d’ordre substantiel dont nous parlons.
L’obsession actuelle de la minceur, due à des raisons qui ne sont ni médicales, ni esthétiques, mais purement idéologiques, inquiète les médecins. C’est d’un véritable culte qu’il s’agit, nous dit l’historien Philippe Perrot, « avec ses pénitents et ses renégats ». C’est un indéniable phénomène de société. « La minceur, écrit Marie-Thérèse Guichard, est désormais devenue un critère d’embauche parmi d’autres », et ce critère s’applique aux hommes aussi bien qu’aux femmes. La « diététique » est aujourd’hui une religion nouvelle, où de nouveaux « gourous » prêchent à leurs victimes la haine de leur propre corps. Cette obsession atteint même de très jeunes adolescentes. Le professeur Marian Apfelbaum est effrayé, dit-il, « de voir des gamines de 11-12 ans se lancer dans des régimes de famine. La majorité des adolescentes(…) suivent actuellement un régime ». Il en résulte « un nombre croissant de troubles alimentaires particulièrement graves ». Telle anorexique, après avoir décidé « de perdre quelques kilos », peut voir « le phénomène lui échapper ». Elle risque ainsi de « perdre jusqu’à 25% de son poids, ce qui est gravissime »(180). Le professeur Apfelbaum pense que nous connaîtrons bientôt une situation « à l’américaine », où 80% des adolescents ont commencé un régime dès l’âge de 9 ans (181). En attendant, le fait est qu’il existe dès aujourd’hui de nombreux cas d’anorexie dont certains se concluent par la mort.
Il y aurait beaucoup à dire sur cette « dissipation » d’ordre substantiel qui va s’accentuant au cours de la deuxième phase des cycles et s’exerce plus spécialement dans leurs derniers temps. Elle se manifeste notamment aujourd’hui, non seulement par l’engouement que nous avons constaté pour une étrange « minceur », mais encore par la tendance à l’émaciation qui résulte de l’usage de certaines drogues et du développement de quelques maladies remarquables sévissant à l’heure actuelle (182). Curieuse rencontre où l’humanité, dans une proportion croissante, se trouve conduite, à la fois dans le « choix » de ses maladies corporelles et dans celui de ses manies psychologiques, voire psychiques, à dédaigner et à condamner, comme malgré elle, sa composante la plus pondérable, celle pourtant qui lui est le plus chère et qui sollicite à l’ordinaire, avec le plus d’obstination, ses attentions dévoyées.
Mais enfin, il reste que l’indice le plus frappant de cette « dissipation » de substance humaine, indice plus significatif encore, nous semble-t-il, que celui des maladies, est peut-être bien cette propension à se faire maigrir dangereusement pour des motifs parfaitement injustifiés. Il faut toute l’emprise d’une « mode » particulièrement hostile aux goûts les plus naturels, pour que l’on assiste de nos jours à de telles ferveurs de décharnement. Cette manie ne va-t-elle pas, chez certains mannequins de la haute couture, jusqu’à l’imitation d’une horreur dont on n’avait jusqu’ici vu le résultat pervers qu’à la fin de la dernière guerre européenne, à la sortie des camps de concentration ? Cette maigreur des corps, que les habitudes de notre temps encouragent et tendent même à imposer, chez les femmes surtout mais également chez les hommes, n’a-t-elle pas quelque chose d’insolite ? On pourrait presque y voir, de la part des intéressés, comme une inconsciente et vaine tentative d’imiter de leur mieux la diaphanéité que semblerait promettre le processus de « dissipation » d’ordre substantiel à l’oeuvre en fin de cycle.
***
4. Ceci dit, n’y aurait-il pas, en réalité, quelque alarmisme dans tous ces rapports de médecins ou de spécialistes qui parviennent à se glisser de temps à autre à travers les barrages de la censure ? Beaucoup de nos contemporains le pensent, qui n’aiment pas que l’on vienne troubler leur quiétude optimiste ou bovine. Quelques-uns, que l’on taxe de « pessimisme », s’inquiètent pourtant… Mais de quoi s’inquiète-t-on au juste ?
Que l’on nous comprenne bien ! Nous ne pensons pas que la survie de l’humanité soit directement menacée par l’extension des cas cités au cours de cette étude. Ce ne sont pas les volontés de génocide qui ont fait défaut tout au long de notre cycle moderne et même avant, mais dans la pratique il est bien difficile de mener la chose à terme. Nous ne croyons donc pas que le genre humain parvienne à s’autodétruire malgré toute sa bonne volonté. Les échos « alarmistes » que nous avons rapportés, n’arrivent d’ailleurs guère à la connaissance des gens que par la voix des médias, et nous savons bien, expérience faite, qu’il faut se méfier des « informations » médiatiques.
Mais il faudrait être aveugle, aujourd’hui, pour ne pas s’apercevoir que l’humanité, et depuis longtemps, suit une démarche suicidaire de tous points de vue, comme si, au tréfonds d’elle-même, elle portait quelque lassitude existentielle et l’espoir d’une délivrance, ne fût-elle que momentanée. Il importe peu, d’ailleurs, que le suicide s’effectue de la main même de la victime, ou bien qu’il résulte des conditions de vie instaurées par les divers pouvoirs, en vue du « bonheur » de cette victime « ingrate », et en son nom même. Les masses partagent largement avec leurs maîtres, surtout en régime démocratique, la responsabilité des turpitudes humaines, et chacun, selon ses mérites, en recevra finalement la juste rétribution.
Pour notre part, nous ne pouvons que relever la direction unique prise par tant de « volontés » séparées, qu’elles soient individuelles, comme celles des personnes qui se portent à elles-mêmes préjudice, ou qu’elles soient « collectives », « anonymes » même, comme celles qui se manifestent dans telles « sectes », mais aussi dans tels milieux scientifiques et tels clans politiques dont les décisions portent atteinte à de grands nombres d’êtres humains. On pourrait du reste se demander quelle est la source qui inspire toutes ces « volontés ». Seraient-elles quelque chose de plus, peut-être, que l’écho immémorial d’une sorte de prescience de mort, à laquelle on répondrait par une futile et dérisoire « fuite en avant » ?
Or, l’humanité manquera son suicide, faute de temps sans doute, car ses jours sont comptés, et même, selon les Écritures, seront « abrégés » du fait de la Miséricorde céleste.
***
5. Il faut dire encore qu’en contradiction, peut-être apparente, avec ce que nous avons rapporté sur la tendance au décharnement et sur les dispositions suicidaires de l’humanité, l’on constaterait, dans les années 90, une propension à rechercher les rondeurs, et notamment dans le corps féminin. Mais s’agit-il vraiment, en cela, d’un embonpoint « de bon aloi », quoique très relativement triomphant ? Sommes-nous bien devant une réelle promotion de la chair ? Faut-il voir, dans le phénomène, la manifestation actuelle de cette tendance à la « solidification » sur laquelle nous avons insisté, et qui s’impose dans la première phase du cycle, mais qui, désormais, en notre époque terminale, n’est plus, à proprement parler, tellement « triomphante » ? Certes, il peut s’en exprimer çà et là quelques témoignages, car la tendance en question est toujours présente jusqu’à la fin du cycle, mais cependant, il semble que l’on ne doive guère la rencontrer aujourd’hui que sous la forme d’un durcissement équivoque et fragile plutôt que sous celle d’un épanouissement véritable. Au lieu d’une expansion satisfaite, « localement » victorieuse, ne serait-il pas plus justement question, dans cet embonpoint insolite, d’une sorte de retrait derrière un écran protecteur ? Devant la dureté des temps, pour se rassurer, nous explique-t-on, l’on arrondit les angles jusque dans la construction des voitures et des aspirateurs ! Les femmes aussi prendraient du galbe, mais ce serait en réalité pour se faire « maternelles », accueillantes, enveloppantes, beaucoup plus que pour être « enveloppées » et « pneumatiques » selon l’expression évocatrice d’Aldous Huxley. Du reste, ne serait-ce pas également pour amortir en leur propre faveur les chocs et les agressions de notre actualité ? L’embonpoint chez les femmes, comme chez certains hommes d’ailleurs, ne serait-il pas un abri contre les duretés et les déceptions de l’existence ? Toute cette recherche des rondeurs et du cocooning pourrait bien n’être en fait, selon Eric Bonnin, que « le signe d’un retour à la terre matricielle ». Comme si les hommes et les femmes se mettaient à craindre les coups à venir (183)…
Les images conjuguées que nous apportent le cocooning, ce refuge dans la tiédeur feutrée du milieu familial, et le regressus ad uterum, cet autre artifice qu’inspire la nostalgie du sein maternel, n’expriment peut-être rien de moins, finalement, que le rêve las ou désespéré d’une fuite vers quelque relative indifférenciation. Ce refus d’une « existence » devenue agressivement artificielle dans nos sociétés modernes, ne serait-il pas alors, malgré l’embonpoint trompeur, tout autre chose qu’une obéissance à l’attraction de la Terre ? Ne faudrait-il pas, dans ce reniement informulé de nos cadres de vie, soupçonner au contraire quelque biais instinctif, mais sans gage d’essor spirituel, pour répondre en dépit de tout à l’attraction du Ciel, ce Ciel qui, Pôle actif de notre Manifestation, représente directement le Principe universel qui la régit ? (184)
***
6. Dans notre recherche des effets produits par l’attraction du Ciel sur les derniers représentants de notre humanité, nous n’avons jusqu’ici relevé qu’un nombre limité de possibilités et de faits parmi ceux qui nous ont paru les plus significatifs. Nous avons d’abord examiné les faits positifs, rares ou discrets, qui se rapportent à une « condensation » d’ordre essentiel, sans oublier leurs parodies, volontaires ou non. Nous avons ensuite observé des faits qui entrent dans le cadre d’une « dissipation » d’ordre substantiel, et qu’illustrent divers exemples sur la manière dont peut se trouver singulièrement réduite, lésée, l’intégrité de la nature corporelle chez les humains et les animaux. Ces exemples, nous aurions pu les compléter encore, outre notre mention des incendies de forêts, par l’énumération de plusieurs autres destructions criminelles et systématiques du monde végétal et de l’équilibre naturel dans son ensemble, entreprises nocives pour la nature, certes, mais qui atteignent indirectement les hommes. Enfin, il se pourrait que les cas d’embonpoint, qui viennent contredire la mode visant au décharnement, ne soient pas toujours l’expression d’un combat d’arrière-garde pour quelque triomphe désuet de la chair, mais celle d’un rempart qu’on dresse devant soi contre les agressions de la société moderne, et finalement, aussi, l’expression d’un refuge dans le renoncement, l’insensibilité, l’indifférenciation.
Tous ces exemples, déjà relativement peu nombreux, pourraient facilement passer pour des exceptions s’ils étaient envisagés isolément, mais réunis en faisceau, ils possèdent aussitôt un certain pouvoir de persuasion, et il serait facile de les multiplier à satiété, tant est mortifère notre civilisation si louangée.
Il reste pourtant que les faits que nous avons cités ne concernent finalement qu’assez peu de gens, tous plus ou moins consciemment sensibles à l’attraction du Ciel, que ce soit à leur avantage ou à leur détriment. Qu’ils soient en bonne santé ou qu’ils souffrent d’états morbides, ce sont des êtres dont le regard ne s’arrête pas à l’apparente impénétrabilité des choses autour d’eux, ou qui en ressentent confusément les influences occultes, lesquelles ne sont pas toutes « bénéfiques », il s’en faut de beaucoup.
C’est maintenant vers d’autres
humains que nous allons nous tourner. Sans doute, par certains côtés,
sont-ils, eux aussi, comme tout le milieu terrestre, quelque peu sensibles
à l’attraction du Ciel, mais ce ne peut être que dans ses modalités
les plus ordinaires, les plus grossières, comme les désordres de la
santé par exemple. Et ils riraient bien si quelqu’un venait leur
parler des attractions du Ciel ou de la Terre !
c) Le jeu actuel de la « solidification » et de la « dissolution »
1. Les catégories humaines précédemment envisagées, exemplaires sans doute, extrêmes peut-être, n’englobent qu’une petite minorité de personnes, celles dont les éléments psychiques et corporels sont plus ou moins intensément engagés dans divers processus qu’engendre l’attraction du Ciel. Toutes ces personnes se trouvent là rapprochées parce qu’elles ont des intérêts ou des faiblesses en rapport avec cette attraction, mais il y a en fait beaucoup de disparité dans un tel rassemblement.
Les gens dont nous allons maintenant parler, au contraire, semblent représenter partout dans le monde, et particulièrement en Occident et dans les pays occidentalisés, une très forte majorité. Ce sont d’ailleurs des individus curieusement semblables sous le rapport de leurs intérêts, étant férus surtout d’actualité, et ne pensant, pour la plupart, que par télévision interposée, respectueux de ses diktats, bercés par ses ondes audio-visuelles, tous en communion, à la même mangeoire, absorbant au même instant leur provende insipide, dénaturée sinon délétère. Ils existent, plutôt du reste qu’ils ne vivent, « à l’unisson ». Mais pas en harmonie.
D’un point de vue authentiquement humain, selon lequel l’humanité participe de la Terre et du Ciel, et si l’on se place dans une perspective très large du sacré en tant qu’il ressortit à la fois à ces deux Pôles de la Manifestation, les gens dont nous parlons maintenant n’ont surtout d’humain que leur apparence corporelle à laquelle ils subordonnent tout. Matérialistes bornés, ce sont de rudes profanes, ayant de la rudesse le caractère à la fois fruste et farouche, incultes qu’ils sont dans le domaine du sacré, et fiers de l’être. De là une superficialité paradoxalement fondamentale, qui n’exclut nullement, en ses soubassements immédiats, le foisonnement fluctuant des petites ou monstrueuses passions. En eux, c’est une activité mentale, prétendument raisonnable, qui voudrait dominer, toujours sous-tendue, et souvent submergée, par une affectivité qui tombe facilement dans le sentimentalisme, et que troublent en outre les appétits du corps et les caprices du caractère.
Aussi, en dépit de cette sorte d’anonymat que leur valent leur similitude et leur égalisation, en dépit aussi de leur plate superficialité, toutes particularités qui n’abolissent pas leur caractère de créatures, ces humains ne laissent pas, à leur manière, d’être sensibles aux deux tendances cosmiques dont nous avons longuement parlé : la « solidification » et la « dissolution ». Mais à cause de leur carapace d’indifférence, de leur imperméabilité au sacré, il va de soi que les tendances en question ne les atteignent qu’en leurs modalités les plus ordinaires : le corps avec ses failles, et le caractère avec ses penchants. Nous ne reparlerons pas ici de ces déperditions organiques envisagées plus haut, et dues à des maladies qui frappent également les animaux, voire les végétaux, peut-être même les minéraux (185), et qui concernent alors dans son ensemble le vaste monde des corps, obligatoirement soumis, bon gré mal gré, à l’attraction du Ciel.
C’est donc sous le seul rapport du caractère et de ses comportements que nous intéresse ici la sensibilité « cosmique », tout à fait inconsciente, de nos contemporains les plus nombreux. Dans leurs attitudes, leurs manières, leurs manies, nous retrouvons la marque de la dualité qui signe la Manifestation tout entière. Selon la Kabbale, notre monde, à l’Origine, fut créé au moyen de la lettre Beith, de nombre Deux. En nos jours, proches de la Fin, nous vivons, qu’on le veuille ou non, sous la loi de l’Ordinateur, dont les calculs se fondent sur le binaire. D’ailleurs, si nos techniciens ont adopté ce système, c’est qu’il correspond à quelque chose de fondamental dans la façon dont on pense à l’heure actuelle. Or un véritable gouffre s’interpose entre la Dualité vue dans la perspective ancienne et symbolique du Nombre, et la dualité toute quantitative dont la notion se mêle à l’emploi de la numération ou des chiffres dans les sciences modernes. Aussi, en nos temps ultimes, dans nombre d’attitudes mentales, ne manque-t-on pas de rencontrer, proposée là comme un grotesque simulacre de la Dualité première et féconde, l’expression d’une dualité dernière et stérile dont la forme est passablement abrupte et les termes irréconciliables. Il n’est pas jusqu’au régime démocratique, par exemple, dont on ne voie la justification et la garantie dans la contradiction permanente qu’apporte à l’affirmation des uns la négation des autres. On est si bien entiché de cette « absoluité » binaire que l’on va même jusqu’à découvrir un dualisme chez Platon ! Mais si cette dualité irréductible est la pire des illusions, il n’en est pas moins vrai qu’un grand nombre de dualités, dans notre monde, correspondent à quelque chose de bien réel, comme nous l’avons vu, puisqu’elles sont l’effet d’une première polarisation de l’Etre universel. Il n’en faut pas, pour autant, les durcir, les radicaliser, en faire un usage par trop roide, comme on a si facilement tendance à le faire aujourd’hui où la mode est aux intégrismes comme aux intégrations de toutes sortes, lesquels déplorent à l’unanimité, dans un même souci d’égalisation, l’existence de telle ou telle dualité, trouvée plus ou moins encombrante, qu’on l’exagère ou qu’on la minimise, et qu’on s’efforce de la réduire par la violence ou par le subterfuge.
***
2. Il y aurait beaucoup à dire sur les problèmes que pose la dualité, mais nous n’avons à les envisager ici que sous leur forme la plus primaire. Ainsi, l’irréductibilité que l’on prête à la dualité fait d’elle un véritable dualisme, et donc, d’un point de vue traditionnel, une conception erronée des choses. C’est un tel dualisme que l’on attribue à tort ou à raison au manichéisme, et ce terme, en tout cas, est souvent utilisé aujourd’hui dans ce sens.
Quoi qu’il en soit, si l’on ne se préoccupe guère, dans les sphères populaires, de ce que peut être le manichéisme, il est évident qu’on en connaît bien la signification courante, celle qui voit en lui l’expression d’une lutte inexpiable entre le Bien et le Mal. Plus précisément encore, dans le contexte social, obsession majeure de l’homme moderne, on traduit volontiers cette lutte comme celle des classes, c’est-à-dire comme l’opposition entre les « bourgeois » et les « prolétaires ». Pour dramatiser alors cette opposition, on la présente d’une façon plus significative, dans sa naïveté ou sa perfidie, comme l’opposition entre les « riches », suppôts du Mal, et les « pauvres » qu’ils exploitent et qui, par leur dénuement qu’on trouve méritoire, se situent du côté du Bien (186).
Cette sommaire division du monde entre les « riches » et les « pauvres » n’est pas sans refléter quelque vérité. On entend même dire parfois que l’écart se creuse de plus en plus scandaleusement entre ces deux catégories, et ce ne sont pas les témoignages qui manquent pour en apporter la confirmation. Cependant, tout en reconnaissant le bien-fondé de cette division entre ceux qui détiennent les richesses du globe et ceux qu’accable la pauvreté, voire la misère, disons qu’une telle division ne rendrait qu’imparfaitement compte de la manière dont se distribue sur nos contemporains la double influence cosmique étudiée plus haut. En réalité, cette influence, pensons-nous, agit plutôt sur deux groupes dont les aspirations profondes paraissent irréconciliables : plus pertinemment répartis que les « riches » et les « pauvres », avec lesquels, sans plus réfléchir, on pourrait croire qu’ils coïncident, ce sont d’un côté, ceux qui s’accrochent sans nuance au passé, et de l’autre, ceux qui veulent en détruire tous les vestiges.(187). Ces deux groupes sont les seuls qui comptent vraiment car ce sont les plus vigoureux et les plus fondamentaux. Du reste, si l’on en juge par la progression actuelle du rapport entre la « solidification » et la « dissolution », tendances qui inspirent respectivement les deux groupes en question, c’est évidemment le second, finalement fauteur d’anarchie, qui serait appelé à « s’imposer » si les processus destructeurs de la Fin, bien proches de leur triomphe, lui en laissaient le loisir (188).
On voit que les deux tendances « adverses » de la force cosmique ne manquent pas d’intervenir dans le champ que l’on dit « politique », mais il est clair qu’en tout cela, les intérêts de la Cité ne sont que prétextes, et que ce dont il s’agit en priorité, pour chacun, c’est de promouvoir, puis d’imposer ses propres « idées ». En réalité les « raisons » que l’on invoque sont rarement autres que vénales, sentimentales ou modérément passionnées. Quant aux motivations profondes, n’est-ce pas de naissance que l’on se trouve être « réactionnaire » ou « révolutionnaire » ?
***
3. Depuis longtemps déjà, à mesure que s’enchaînent les sous-cycles des temps modernes, le conservatisme s’efforce de résister aux novateurs, puis, à la longue, la grande majorité des humains tend à se diviser en deux groupes opposés : ceux, d’abord, dont le caractère en est à la première étape de son durcissement, et qui ne songent qu’à garder les avantages acquis, voire à en accaparer de nouveaux, et ceux, ensuite, dont la dureté s’est amoindrie, amoillie, et qui, tenus en bride pour cette raison même, n’ont d’autre envie que d’égaler les premiers, puis de les supplanter. Aujourd’hui, où les tendances matérialistes sont à leur apogée, les uns ne pensent qu’à persévérer dans une expansion économique tentaculaire (189) désormais vouée à l’échec sinon à la catastrophe, tandis que les autres, écartés de cette émulation combative par leur paresse ou leur incapacité, s’acharnent à détruire une société malsaine, sans pour autant avoir les moyens, ni même le désir, de l’assainir. Les expansionnistes, alors, se « figent » contradictoirement dans un état de sclérose mentale proche du radotage, sorte d’induration générale que masque leur recherche opiniâtre de l’hypertrophie matérielle. Quant à leurs ennemis, qui sont aussi les candidats à leur succession, ils se révèlent, sous des aspects agressifs, comme les victimes d’un laisser-aller de tout leur être, où le goût de la « liberté », qui n’est au fond que leur assujettissement à l’inconséquence la plus fantaisiste, dissimule, à leur insu, quelque secrète tendance à l’autodestruction (190). Mais en fait, « retardataires » ou « précurseurs », les uns comme les autres, à des stades différents et sous une trompeuse vitalité, succombent à un encrassement apparemment inéluctable, à un durcissement qui en s’intensifiant ne saurait aller bientôt sans fissures, et qui, chez les « précurseurs », amorce déjà la dissolution (191).
Ces deux partis, qui sont d’ailleurs, le plus souvent, des « partis- pris », se sont vu distinguer, au cours des temps, par diverses appellations. Il y eut des conservateurs et des libéraux. Il y a encore des réactionnaires et des progressistes. Mais au gré de la décomposition qui triomphe dans les idées et dans le tissu social, les noms changent parfois de sens. Le libéralisme d’hier est souvent considéré aujourd’hui par les gens « avancés » comme une doctrine dépassée, voire passéiste, sinon réactionnaire… Cependant, peut-être vaudrait-il mieux voir, dans ces deux groupes, des patients et des impatients, les premiers sachant qu’il ne se fait rien de durable sans le temps, les seconds, qu’agacent les atermoiements, pressés de passer à l’action. On pourrait aussi les appeler les « vieux » et les « jeunes », quel que soit leur âge. Et il est bien naturel que les « vieux », tout perclus dans leurs membres ou dans leur allant, soient plus soucieux ou réfléchis, et que les « jeunes », plus souples et détendus, immortels comme sont tous les jeunes, soient plus enthousiastes, désinvoltes, hardis, téméraires et casse-cou (192). Les uns freinant, et les autres accélérant, les choses avancent peu à peu, mais de plus en plus vite, vers leur fin (193).
Ainsi va le monde, et depuis longtemps. Or ce qui nous frappe, dans l’évolution actuelle des événements, c’est l’apparente inéluctabilité du processus. Les nations courent à leur perte sans que leurs dirigeants puissent ou veuillent le leur éviter. De plus en plus sûrement, c’est la « dissolution » qui, chaque jour, l’emporte sur la « solidification », non pas discrètement du reste, mais de façon tout à fait ostensible, comme elle le fait déjà un peu partout, dans tous les domaines. Nous avons parlé, à propos des « dissipations » d’ordre substantiel, du gaspillage progressif, voire systématique, dont est victime le capital corporel de toute espèce terrestre : empoisonnement délibéré et destruction générale de la planète, jusqu’à nous intoxiquer gravement nous-mêmes et nous priver radicalement d’une partie de nos ressources alimentaires. Enfin, outre ces dégâts matériels dont est responsable une sotte mentalité, on constate aussi une dissolution toujours grandissante des moeurs, dissolution dont on nous donne l’exemple depuis les milieux les plus modestes jusqu’aux sphères les plus hautes de l’édifice social.
Nous avons dénoncé, lorsque nous les avons rencontrées, les tendances suicidaires qui affectent certains groupes d’individus. En vérité même, on le voit bien, c’est le genre humain tout entier qui, saisi d’une sorte de folie, s’est mis en devoir de se suicider. Non seulement il se détruit dans sa modalité physique, mais, ce qui est plus inconséquent encore, il s’applique à ruiner de son mieux ce qui peut lui rester de spiritualité, c’est-à-dire son bien le plus précieux.
***
4. Est-ce une caricature que nous brossons là, comme plusieurs doivent le penser ? Certes, c’en est une, mais bien amère, car elle s’identifie à ce monde qui nous cerne implacablement. Sans doute les grimaces, pour la plupart, en sont-elles longtemps restées plus ou moins imperceptibles, et c’est que les politiciens de tous bords sont depuis toujours habiles à les farder, comme ils se font maintenant eux-mêmes farder avant d’affronter leurs téléspectateurs. On étouffe les scandales les moins connus, on gomme les plus visibles, on se fait limer des canines par trop agressives. Surtout, on endort la clientèle, comme le fait l’anesthésiste, parce que toutes les « interventions », chirurgicales ou sociales, sont douloureuses. On berce alors les électeurs de beaux discours pleins de vent, on leur serine quelques slogans lénitifs ou pimpants : de la « qualité de la vie » au « mieux-disant culturel », il y en a pour tous les goûts…et les dégoûts. Mais le système, majoritairement et donc démocratiquement, fonctionne parfaitement, puisqu’il dure. Sous un optimisme de rigueur, gage supposé de « croissance » maximale, l’abcès mûrit…
Aujourd’hui, les événements se précipitent parfois de façon surprenante. Seule la sagesse, qui mesure les cycles, enseigne qu’il serait grand temps, pour les humains, de se démunir du superflu pour faire place à l’essentiel. Mais ce n’est plus la sagesse qui régit l’Histoire, ni dans le champ politique, ni dans celui, même, de la pensée, où elle n’est plus désormais qu’objet de dérision.
Pourtant, dans le grand désarroi des âmes, face à leur encroûtement et à leur déréliction que ne semble devoir interrompre que leur désintégration finale, il est encore, à l’écart des foules irresponsables, quelques êtres d’exception qui, dans la solitude et le silence, répondent à tous les défis outrageants par la rigueur de leur comportement, l’incessante disponibilité de leur bienveillance et le parfait achèvement de leur application contemplative. On dit même, parfois, que c’est à ces êtres seuls que le monde est redevable de sa survie…
(1) La Crise du Monde moderne,
p. 12, 13,15, 17-18.
(2) Comme tout le monde ne le sait peut-être pas, les autruches, ces créatures ingénieuses, ont trouvé une méthode pour parer à tous les dangers : elles se cachent la tête sous le sable…
(3) D’ailleurs, l’optimisme est surtout le fait de ceux qui profitent matériellement de la situation désastreuse, et qui, aveuglés par leur matérialisme, s’endorment dans les délices relatifs de cette nouvelle Capoue dont rêvent, se préoccupent et se repaissent les technocrates. L’optimisme, sans doute, est cet « alibi sournois des égoïstes » dont parlait Bernanos, mais il n’est jamais dépourvu d’une certaine naïveté, et c’est pourquoi les États l’encouragent de leur mieux chez les peuples.
(4) R. Guénon : Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, p. 247-248.
(5) Il faut dire que la crédulité publique a toujours été mise à contribution, et qu’elle ne déçoit jamais. On l’exploite, de nos jours, par les publicités abusives, les sondages de toutes couleurs, et bien d’autres moyens parfaitement admis et largement utilisés dans mainte carrière commerciale ou politique.
(6) Revue Télérama, 27 mars 1991.
(7) Il ne serait pas sans intérêt, ni sans humour d’ailleurs, de comparer ce « bêtisier », moderne sinon scientifique, aux prévisions que formulaient, sans arrogance mais sans illusion non plus, certains textes fort anciens, comme le Vishnu Purana par exemple, et qui concernent, à son apex et au moment de sa fin, cette Civilisation unique dont les Occidentaux sont en grande majorité si fiers !
(8) « Le slogan de l’‘objectivité scientifique’ n’est rien d’autre qu’un argument inventé par les chers professeurs qui désiraient se soustraire au contrôle du Pouvoir, alors que ce contrôle est indispensable ». Tel est le propos que tenait Adolf Hitler et que rapporte Hermann Rauschning (Hitler m’a dit, p. 299, Livre de Poche).
Rappelons, à ce sujet, les recherches actives que poursuivaient scientifiques et ingénieurs allemands devant la sollicitation pressante de l’odieux pouvoir nazi, recherches qu’encouragea bientôt après, aux USA, l’aimable pouvoir démocratique. Les Japonais en expérimentèrent le résultat à Hiroshima, mais les Anglo-Saxons auraient pu en déguster les mêmes effets à Londres ou à Washington. Il s’en fallut de peu, d’ailleurs.
(9) A propos du mot « crise », R. Guénon fait observer que « son étymologie (…) le fait partiellement synonyme de ‘jugement’ et de ‘discrimination’ » (La Crise du Monde moderne, p. 9). On pourrait même déceler encore, dans la racine indo-européenne du mot, les significations de « cène », de « tri », de « purification ».
(10) Ces tendances trouvent une satisfaction morbide, parfois vengeresse, dans la vision de certains films de violence ; mais elles y trouvent aussi un aliment dangereux. Le Quotidien de Paris, dans son numéro du 6 février 1992, p. 16, titre : « Au secours, le catastrophisme revient ! » Le ton, sans doute, se veut badin, et pourtant le texte qui suit sur deux pages, offre plus d’une raison de tempérer cet enjouement, car il donne quelque matière à réflexion sérieuse à ceux qui en sont encore capables.
(11) Introduction générale à l’étude des doctrines hindous (1921), p. 303-307.
(12) Sous le titre « Quelques remarques sur la doctrine des cycles cosmiques », l’article se trouve dans l’ouvrage Formes traditionnelles et Cycles cosmiques (Gallimard, 1970). M. Jean Robin en a fait un résumé fort complet dans son livre sur René Guénon, Témoin de la Tradition (Guy Trédaniel, 1976), p. 342-347.
(13) C’est nous qui soulignons.
(14) Formes traditionnelles et Cycles cosmiques, p. 13-14 et 24. En 1937 encore, dans un autre article, l’auteur justifie l’obscurité dont « certains côtés de la doctrine des cycles ont toujours été enveloppés » (ibid., p. 30). Il renouvelle ses réserves en 1945 dans Le Règne de la Quantité, p. 257.
(15) Formes traditionnelles et Cycles cosmiques, p. 48, note 2.
(16) René Guénon, Témoin de la Tradition, p. 348.
(17) Nous ne pousserons tout de même pas l’humour jusqu’à calculer les révolutions solaires !
(18) Sur cette ère qu’entendait désigner R. Guénon, Michel de Socoa, quant à lui, ne semble guère entretenir de doute. Il s’agit d’une « ère bien connue », dit-il, « qui ne peut être que l’ère juive » (Les grandes conjonctions, p. 8). Gaston Georgel, de son côté, considère cette datation de l’ère juive avec beaucoup de scepticisme, car il n’a pas pu en obtenir la justification ! Sic ! Aussi préfère-t-il se fier à certaines prophéties (Vers la Tradition, nos 13 et 14, p. 4). Ceci dit, on peut ne pas adhérer à certaines datations de G. Georgel, mais il faut lui reconnaître le mérite d’avoir, par ses livres, attiré l’attention sur l’importance des cycles pour une saine compréhension de l’Histoire.
(19) Le dieu du futur, p. 158-160.
(20) Rapportons ici le témoignage de Michel de Socoa, qui trouvait « fantaisiste » la chronologie de Nostradamus, et qui voyait d’ailleurs dans son art, après R. Guénon, plus de magie peut-être que d’astrologie, celle-ci n’étant qu’un « masque » pour dissimuler celle-là, prudence salutaire à cette époque. Quoi qu’il en soit, le mage, de son côté, se disait issu d’une tribu juive « renommée pour ses dons de prophétie » (Les grandes conjonctions, p. 14).
(21) Les « partisans » de l’Atlantide font observer de leur côté que des sondages sous-marins ont découvert des points qui auraient été recouverts de laves lorsqu’ils étaient encore émergés. Tel est le cas, paraît-il, d’un point situé à environ 900 km au nord des Açores. Mais évidemment, c’est là soutenir la thèse du « catastrophisme » tant redouté…
(22) Platon : Timée, 23e ; Critias, 108e.
(23) Critias, 108d et 113b.
(24) La teneur des archives égyptiennes, à ce sujet, est communiquée par un très vieux prêtre de Saïs à Solon, qui en fait le récit au grand-père de Critias, lequel raconte à son tour la chose à Critias, qui l’aurait rapportée à Platon. Quant au fait que Critias prétende conserver encore chez lui les manuscrits de Solon, ce n’est évidemment plus, aujourd’hui, une grand garantie d’authenticité (Critias, 113b).
(25) « Il existe une préparation à la sagesse plus élevée que la philosophie, qui ne s’adresse plus à la raison, mais à l’âme et à l’esprit, et que nous pourrions appeler préparation intérieure ; et elle paraît avoir été le caractère des plus hauts degrés de l’école de Pythagore. Elle a étendu son influence à travers l’école de Platon jusqu’au néo-platonisme de l’école d’Alexandrie » (R. Guénon : Mélanges, p. 51). Mais quant aux écrits eux-mêmes, n’est-ce pas Platon qui, dans le Phèdre, les critique sévèrement, jusqu’à n’y voir que « des mémentos » qui se réduisent souvent, par la force des choses, à « un badinage » (277e-278a) ? Pour lui, seule la parole est susceptible de répandre les germes de la spiritualité (276e-277a).
(26) Critias 120e-121c.- Il semble que ce soit toujours cette même enflure que l’on constate en fin de cycle, sous des formes diverses : enflure des appétits vulgaires, quels qu’ils soient, enflure de la vanité d’exister qui pousse au fétichisme anthropolâtre, lequel, d’ailleurs, se complait surtout dans le culte de soi.
N’est-ce pas là qu’en sont aujourd’hui la plupart des peuples et des hommes ? Leur vie ne se borne-t-elle pas à la convoitise des richesses exclusivement matérielles, à l’obsession de dominer pour se les approprier, ou même, symptôme d’une imminence de la fin, pour le seul et morbide plaisir de détruire et de tuer ?
(27) Le pessimisme des Anciens est la tare indélébile dont s’indignent, avec le plus de persistance, les champions de la modernité. C’est que, depuis leurs origines à cousinage simiesque, les modernes se sont rendu compte qu’ils ne cessaient de cheminer dans la voie du Progrès, et il en est même d’assez ambitieux pour croire qu’ils vont « devenir Dieu », ce principe qu’ils ont « inventé ». Mais, comme nous l’enseigne le « Créativisme », ne suffit-il pas de vouloir pour obtenir tout ce que nous désirons ?
(28) « Proclus, auteur d’un célèbre commentaire sur le Timée, rapporte que les prêtres de Saïs ont montré à Crantor de Soloï, premier commentateur de Platon, les mêmes papyrus et les mêmes écrits qu’à Solon ». C’est ce qu’écrit Jürgen Spanuth dans L’Atlantide retrouvée (Plon, 1954, p. 13). N’ayant pas à notre disposition le fameux commentaire, nous n’avons pu nous y reporter.
Jurgen Spanuth serait un théologien allemand qui aurait reçu sa formation dans les Universités de Tübingen, de Berlin et de Vienne, vers 1930. En fait, son récit concerne les événements qui ont précédé et suivi la date de 1200 avant notre ère : catastrophes naturelles, migrations, affrontements guerriers. Il essaye d’appliquer aux peuples du Nord le mythe atlantéen de Platon. Pour justifier cet important décalage dans le temps, il s’appuie sur une explication du savant Olaf Rudbeck (1630-1703) : « une faute de traduction ; au lieu de huit mille ans, huit mille mois sépareraient l’engloutissement de l’Atlantide de l’arrivée de Solon en Egypte »(p. 17 de l’ouvrage) ! ! ! Pourquoi passer des 9000 ans, indiqués par Platon, à 8000 ans, c’est-à-dire, selon l’hypothèse proposée, à 8000 mois ? Sans doute pour obtenir finalement une date correspondant mieux aux cataclysmes du Nord au XIIIe siècle. En effet, si l’on ajoute 8000 mois à 560 (date supposée de la visite de Solon en Égypte), on obtient : 560 + 666 ans (= 8000 mois) = 1226 avant J.-C. Six cent soixante six ans ! Curieuse coïncidence !
(29) Timée, 24e-25a.
(30) Il se peut, en effet, que ces 9000 ans « litigieux », tout en situant de façon assez satisfaisante l’ancienneté du cataclysme, aient été ainsi évalués en nombre rond par simple discrétion. Il s’agit du reste d’un nombre cyclique, dont le choix, avec son allusion symbolique, pourrait bien n’être rien d’autre qu’un clin d’oeil complice de Platon, et non pas une simple datation historique, aussi approximative soit-elle. Platon, par exemple, cite ailleurs, dans un tout autre propos et dans un sens purement symbolique, une même durée de « neuf mille années » (Phèdre, 257a).
(31) On sait que le fatalisme est une « doctrine » fausse, au point même qu’il serait peut-être souhaitable de le désigner de façon moins équivoque. On ne manque jamais d’en créditer les musulmans, à tort comme on le sait, ni de l’attribuer aux anciens Grecs, sans plus de raison sans doute, si l’on veut bien dépasser certaines conceptions sommaires sur leur Destin.
(32) L’indéfini on ne désigne pas ici les hommes politiques, lesquels, dupes majuscules et dorées, ne sont, à tout prendre, que les chiens d’un redoutable Chasseur.
(33) Nous recommandons aux lecteurs intéressés l’ouvrage de ‘Abd ar-Razzâq Al-Qâshânî : Traité sur la Prédestination et le libre arbitre (éd. Sindbad).
(34) On observe la même attitude vis-à-vis de l’Astrologie, qu’on accuse de déterminisme sans aller y voir de plus près. Et ce, en dépit des affirmations maintes fois répétées, dès le Moyen-Age : Astra inclinant, non necessitant.
(35) R. Guénon : Le Règne de la Quantité, p. 271-272.
(36) Ibid., p. 47-48.
(37) René Guénon, Témoin de la Tradition, p. 340-342.
(38) Le terme nous paraît tout à fait adéquat pour désigner la mentalité générale de l’époque. Etymologiquement d’abord, car la « gauche » (en latin, sinistra) et la mode gauchiste semblent devoir remporter désormais tous les suffrages. L’ensemble du monde, alors, brandit l’étendard du socialisme, cette doctrine accommodante et caméléonesque : bien sûr, l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, mais aussi son ennemi mortel, le Troisième Reich, nazi, c’est-à-dire national-socialiste, et encore, à sa manière, le fascisme italien, oeuvre du militant socialiste Benito Mussolini, sans parler des innombrables démocraties occidentales, sénilement entichées des « principes » socialisants qui s’affirmèrent en mode affectif dès le début du XIXe siècle, avec le romantisme et l’ « idéal » républicain, pour verser finalement dans la simagrée.
(39) Comme nous le verrons par la suite, cette période de troubles constitue la transition entre une époque de mercantilisme bourgeois et celle où va régner la chienlit prolétarienne et où la criminalité finira par tenir le haut du pavé à raison même de ses crimes.
(40) Il n’est pas difficile d’en faire l’observation : on verra que l’époque 1993,29-1999,77, dans nos cycles, se présente comme l’image aggravée de la période 1934,97-1999,77 dont elle est une sorte de minuscule Kali-Yuga, mais fortement « concentré » par le fait même de l’entassement excessif des événements.
(41) La Crise du Monde moderne, p. 133-134.
(42) Ces passages et les suivants sont empruntés à la traduction que Paul Mazon donne de l’oeuvre d’Hésiode : Les travaux et les jours.
(43) Leconte de Lisle traduit « dans cette cinquième génération des hommes ». Le grec genos, que traduisent les mots « génération » ou « race », comporte bien des acceptions. Il désigne l’origine, l’espèce (qu’il s’agisse de dieux, d’hommes ou d’animaux), la famille, un enfant, une phratrie, une caste, une corporation, une nation, une tribu, un sexe, toutes significations que donne Bailly outre celles de « race » et de « génération ». Pour A. K. Coomaraswamy, genos, c’est le sanscrit jâti (Autorité spirituelle et Pouvoir temporel, p. 10, note), lequel, selon Guénon, « désigne la nature individuelle de l’être », cette nature résultant « avant tout de ce qu’est l’être en lui-même et secondairement seulement des influences du milieu ». Comme varna (couleur), jâti (naissance, espèce) désigne ce qui justifie l’appartenance à une caste (Etudes sur l’Hindouisme, p.76-77).
(44) Ici, le vers 189 du texte grec est mis entre crochets. Mazon traduit en note : « mettant le droit dans la force ; et ils ravageront les cités les uns des autres ».
(45) A plusieurs reprises, R. Guénon a fait observer l’équivalence des 4 Ages de l’humanité, dont parlent les traditions grecque et romaine, avec les 4 Yugas du Manvantara hindou. Il en admet même l’égalité sous le rapport de la durée, et cela semble aller de soi, ne serait-ce que parce que ces traditions de l’Occident et de l’Orient prennent évidemment leur source commune dans la tradition primordiale.
(46) « ‘L’âge des Héros’ n’est aucun des 4 âges » du Manvantara, « mais plutôt une simple subdivision ; il faudrait pouvoir se reporter à ce que dit Hésiode, et que je n’ai pas ici ; mais (…) il semble bien qu’il se situe dans l’‘âge de fer’ même, dont il est peut-être comme la première phase ». C’est ce qu’écrivait René Guénon à Gaston Georgel dans sa lettre du 28 janvier 1948 (revue Etudes Traditionnelles 1968, p.241). Le Vêda, quant à lui, dénombre cinq Grandes Races humaines qui se succèdent au cours de notre Manvantara, mais il est vraisemblable que chacune de ces Races, surtout parmi les dernières sans doute, doivent comporter plusieurs branches et rameaux distincts.
(47) Etéocle et Polynice, frères issus du malheureux hymen d’Oedipe et de Jocaste, s’entre-tuent sous les murs de Thèbes.
(48) Ceux qui se livrent à la démesure, ou hubris, subiront les calamités et la destruction, qui leur viendront du Ciel (vers 238-247). D’après Bailly, hubris, c’est « tout ce qui dépasse la mesure » : orgueil, insolence, emportement, violence, bouillonnement, excès, outrage, sévices (particulièrement sur une femme ou un enfant). Or tout cela se rencontre pendant le siège et le sac de Troie, mais aussi ailleurs, à la même époque.
(49) Rappelons que l’on a compté au moins neuf villes superposées dans le site que découvrit Heinrich Schliemann. A propos de cette découverte, Immanuel Velikovsky, dans Les grands bouleversements terrestres (Librairie Stock) signale (p.211, note) que dès la fin du XVIIIe siècle, « Le Chevalier émit l’hypothèse qu’Hissarlik était le site de la Troie homérique ou Ilion. On ne tint alors aucun compte de cette identification ». Pour Velikovsky (Worlds in collision, V. Gollancz Ltd, Londres 1954, p.239), Troie aurait été détruite au tournant du IXe et du VIIIe siècles, et il appuie cette précision sur le fait de la fuite d’Enée et de sa fondation de Rome au milieu du VIIIe siècle. (50) Sans parler des terribles destructions matérielles qui réduisirent pratiquement à rien la culture précédente et ses raffinements, les cités grecques, avec l’installation des Doriens, vont renoncer au régime monarchique pour adopter le régime oligarchique. L’accent qui portait sur l’ « honneur », selon la terminologie platonicienne, va désormais se placer sur la richesse matérielle.
(51) Le monde égéen avant les Grecs (collection Armand Colin, 1947), p.95.
(52) N’oublions pas que le tournant cyclique dont il est ici question est suffisamment important pour laisser supposer qu’il a dû affecter plus d’une race en un point ou un autre de la terre.
(53) Parmi d’autres exemples, on pourrait citer celui de Pyrrhus qui, après la prise de Troie, opérée par fourberie, tue Politès, fils de Priam, sous les yeux de son père, puis tue le vieux roi lui-même après l’avoir arraché de l’autel de Jupiter-Protecteur qu’il tenait embrassé. Sa haine inassouvie, il jette du haut des remparts le jeune Astyanax, fils d’Hector et d’Andromaque. On reconnaît bien là le sang tumultueux d’Achille, son père. Finalement, par un juste retour des choses, pourrait-on dire, Pyrrhus sera tué au pied de l’autel d’Apollon par les Delphiens, sacrilège identique. Un autre exemple de profanation est celui que donne Ajax : il ne craint pas de violer la prophétesse Cassandre réfugiée dans le temple d’Athéna. N’est-ce pas là déjà le mépris moderne pour les lieux sacrés qui s’esquisse, et du même coup le mépris de l’homme, temple et image de la Divinité ?
(54) Il ne faut pas réglementer les guerres, disent les bons apôtres de la modernité, il faut les supprimer ! Ce qui laisse toute latitude, en attendant, pour commettre les pires turpitudes.
(55) Évitons de confondre les guerriers avec les soldats ou soudards. Mais comment, aujourd’hui, s’y reconnaître ? Il y a longtemps que l’authentique espèce guerrière a disparu, et s’il en reste quelques rares descendants, ils ont perdu jusqu’à la possibilité même de donner libre cours à leur nature héroïque. Alors que les premiers Kshatriyas ne dépendaient que de l’autorité spirituelle des Brahmanes, les soldats, maintenant, sont tenus d’obéir mécaniquement à des chefs soumis à un pouvoir temporel qui les nomme, les paye, les lance, les retient, pour servir des intérêts inavouables qu’on appelle « la Politique » et « les secrets d’État ».
(56) Mais évidemment, en nos temps d’expansion et d’efficacité, l’honneur a perdu toute signification : il ne rapporte rien ! Pas même des « honneurs » !
(57) « Des poètes très nombreux ont contribué au développement littéraire de la légende de Troie ou de celle d’Ulysse, bien avant l’époque où notre Iliade et notre Odyssée furent constituées » telles que nous les connaissons (Fernand Robert : La Littérature grecque, collection « Que sais-je ? », p.13).
(58) L’humanité devait attendre encore longtemps l’apex de la Civilisation où les grands savants lui découvriraient enfin, dans l’émerveillement des origines, son cousinage simiesque.
(59) La tradition veut que le célèbre aède ait été aveugle, ce qui, on le sait, est un hommage à ses dons de voyance, ou à sa connaissance spirituelle.
(60) Au cours d’une émission de radio (12 janvier 1981), nous avons entendu dire que, à l’époque de la guerre de Troie, les Grecs avaient apparemment vécu sous une sorte de régime de castes : en tête, une caste guerrière, les Achéens ; ensuite venaient les prêtres, exigeant des sacrifices ; puis des propriétaires terriens ; enfin des artisans, notamment des forgerons, bien considérés car fabriquant des armes.
Il n’en demeure pas moins que les chefs achéens, nous dit-on par exemple, suivaient les conseils, voire les injonctions, du grand-prêtre Calchas.
(61) A Marathon, fameuse bataille entre les Grecs et les Perses : moins de 7.000 morts. Grande Guerre (1914-1918) : 8 millions de morts sur les champs de bataille. Dernière guerre (1939-1945) : 17 millions de morts sur les champs de bataille et environ 30 millions de victimes diverses, qu’il s’agisse de civils, de prisonniers dans les camps de concentration ou de gens éliminés par les purges soviétiques, etc… Encore faudrait-il vérifier la signification de ces chiffres à la lumière de paramètres divers (pourcentage par rapport à chaque population avant les hostilités). Ainsi, au XVIIe siècle, la Guerre de Trente Ans a éliminé en Allemagne la moitié de sa population.
(62) Pour nos savants et ceux qui s’efforcent de les singer, les récits sur les malheurs de Troie n’ont été longtemps qu’élucubrations poétiques attribuées à un aède qui n’avait jamais existé. Pas plus qu’Ilion. Du moins jusqu’à ce qu’un amateur découvre, à partir du texte homérique, le site de la ville « imaginaire » et de quelques autres villes, ainsi que le témoignage de destructions et d’incendies. L’on sait donc depuis Schliemann, et même dans les milieux spécialisés, que la guerre de Troie a bel et bien eu lieu.
(63) La légende, c’est, étymologiquement, « ce qui doit être lu », mais aussi, dans un de ses premiers sens, « ce qui doit être rassemblé ». C’est dire, donc, qu’il s’agit de choses « éparses » que nous avons à relier entre elles jusqu’à en faire un tout.
(64) Pierre Waltz : Le monde égéen avant les Grecs, p.90-91.
(65) The New Encyclopaedia Britannica, tome 8, p.329.
(66) Ibid., tome 1, p.121.
(67) Ibid., tome 1, p.819-820.
(68) Ibid., tome 8, p.326. - Dans le Nord, où elles ont sévi, ces catastrophes ont été attribuées, par certains historiens et hommes de science, à la chute d’un météore. Il devait être, en ce cas, d’une belle taille !
(69) Bible Osty, p.141.
(70) C’est en effet sous le règne de Ramsès II (1290-1224, selon la Bible Osty) que les fils d’Israel construisirent les villes de Pitom et de Ramsès (Exode I : 11), comme le rapporte l’Histoire. C’est sous ce même règne, ou plus tard, que semble naître Moïse selon l’Exode, et il lui a fallu prendre le temps de devenir adulte et père de famille (II:21-22). Pendant son séjour au pays de Madian, un pharaon meurt (II:23) : Ramsès II ou un successeur de Ramsès.
(71) Mineptah règne de 1224 à 1214, selon la Bible Osty.
(72) Ce qu’Hésiode écrit des Ages d’Or, d’Argent et d’Airain, est souvent étrange, obscur, et la descente progressive du cycle nous y parait bien énigmatiquement exposée, alors qu’elle se présente très clairement dans le passage de la « race divine des héros » à celle « du fer ».
(73) The New Encyclopaedia Britannica, tome 8, p.326.
(74) Ibid., p.327.
(75) Il s’agit en effet de Pierre Waltz qui, en 1906, fit porter sur Hésiode sa thèse de doctorat, et publia ensuite plusieurs ouvrages sur la Grèce antique.
(76) Pierre Waltz : Le monde égéen avant les Grecs (1947), p.96. - Peut-être n’est-il pas sans intérêt de relever la première date de parution de ce livre, en 1934, car elle en situe dans le temps la mentalité particulière, encore que celle-ci ne soit pas nouvelle. L’année 1934 marque d’ailleurs, dans les cycles envisagés dans notre étude, le moment du passage à l’ère prolétarienne, c’est-à-dire, dans l’Age noir, à sa phase terminale, qui est évidemment la plus ténébreuse. C’est dans cette phase terminale que notre humanité a récolté et récoltera tout ce qu’elle a semé depuis la Renaissance, tant en mode « négativiste » qu’en mode « positiviste ».
Dans le court extrait que nous avons cité, nos lecteurs auront reconnu en passant tels concepts qui, s’ils sont suspects en contexte européen, sont encore plus déplacés dans le passé brumeux d’une Grèce aussi ancienne.
(77) Nous parlons naturellement des militants de base, et non pas de ceux qui veillent sur leurs intérêts.
(78) Les exemples ne manquent pas : la Tour de Babel, l’empire d’Alexandre de Macédoine, Rome, l’empire napoléonien… Et que dire de l’expansion économique, industrielle, idéologique, véritablement cancériforme, de la civilisation moderne, dont l’écroulement ne devrait plus guère tarder.
(79) L’auteur poursuit : … « Ce caractère féroce survit encore chez les Kurdes, qui habitent le sol de l’antique Assyrie, et les massacres d’Arménie ont renouvelé de nos jours les atrocités commises jadis par les peuples d’Assour et de Ninive. Les récits des Grecs, la Bible, les inscriptions et les bas-reliefs, tous les documents nous représentent les rois assyriens comme des despotes farouches et cruels, dont l’occupation favorite était la guerre » (Albert Malet et Jules Isaac : L’Orient et la Grèce (1932, chap.IV, p.67).
Est-ce un « choc en retour » que récoltent aujourd’hui les Kurdes ?
(80) Ibid., p.318.- De telles circonstances ne rappellent-elles pas plus ou moins le schéma bien connu de la « révolte des Kshatriyas », mais sous une forme dégradée ?
(81) Parmi les vestiges de la civilisation sumérienne, Léonard Woolley a découvert dans les tombes royales d’Ur, outre les cadavres royaux, les restes de nombreux serviteurs, dames d’honneur, guerriers, qui avaient été immolés pour accompagner leurs souverains au-delà de la mort. Certains indices, nous dit-on, montreraient clairement que ces gens n’étaient pas venus là de leur propre gré : il ne se serait donc pas agi, dans ce cas, de sacrifices proprement dits, mais de vulgaires massacres. Les riches trésors dégagés laissent par ailleurs supposer une civilisation avancée. La sépulture de la reine Shoubad daterait d’environ 3.500 (C.W. Ceram : Des dieux, des tombeaux, des savants, p.287, Plon).
(82) Malet et Isaac : L’Orient et la Grèce, p.64.
(83) La détérioration des moeurs n’expliquerait-elle pas la nécessité d’une législation plus dure ?
(84) The New Encyclopaedia Britannica, tome 11, p.981.
(85) Malet et Isaac op. cit., p.72.
(86) La seule différence avec nos grands technocrates est d’ordre quantitatif en ce qui concerne l’exécution, et d’ordre qualitatif dans le domaine psychologique ou moral. Assourbanipal ruinait volontairement une bonne partie d’un pays ennemi : il le faisait rageusement, pour se venger. Alors que notre civilisation le fait sottement à l’échelle planétaire, dans la sérénité de son inconscience, pour s’enrichir, se développer, s’enrichir encore…
(87) The New Encyclopaedia Britannica, tome 11, p.986.
(88) Les trois images choisies par Malet et Isaac (p.60) pour illustrer leur propos sont fort éloquentes. Cependant, il est évident que les siècles et diverses césures ne départagent pas seulement telle race ou tel peuple de telle ou tel autre, mais qu’ils divisent aussi chaque groupe ethnique en divers moments qui influent en passant sur son caractère sans qu’il en perde pour autant son identité profonde. C’est ainsi que l’on a distingué chez les Assyriens eux-mêmes, semble-t-il, une évolution assez comparable à celle que nous avons tracée pour la Mésopotamie en général : d’abord une certaine subordination du pouvoir temporel à l’autorité spirituelle, et ensuite une enflure de la royauté qui se rend à elle-même les honneurs divins et dont le gigantisme maladif s’exprime extérieurement par les arts, l’architecture et les conquêtes territoriales.
(89) C’est sur Radio France, le 7 novembre 1992 sauf erreur, que nous avons entendu recommander ce film comme tout particulièrement hilarant. Qu’ils rient donc, les Hexagonaux ! Qu’ils rient bien, mais qu’ils se dépêchent !
(90) The New Encyclopaedia Britannica, tome 4, p.300.
(91) Ibid., p.301. - Soupçonnerait-on ces anciens Chinois de se livrer aux mêmes subterfuges que les Etats modernes ? Mais tout le Kali-Yuga n’est-il pas suspect ?
(92) Ibid., p.300.
(93) Nous ne parlerons pas du fer dans cette période de transition, où pourtant en d’autres pays, il a pu nous servir d’indice. (On ne l’utilise en Chine, en effet, que vers 600 avant J.-C.
(94) Ibid., p.302.
(95) Les modifications de calendriers ne sont pas toujours faciles à expliquer, et surtout celles rendues indispensables après des cataclysmes d’une certaine ampleur. D’une part, les scientifiques ont tendance à ne pas se compromettre dans des problèmes ingrats, et d’autre part, les curieux qui s’y risquent ont souvent une idée préconçue à laquelle ils veulent faire concourir des faits qui ne s’y rapportent pas nécessairement. La Chine, riche d’histoire, de civilisations, de légendes et de catastrophes géologiques, se prête à des spéculations séduisantes dans lesquelles nous ne nous engagerons pas ici.
(96) The New Encyclopaedia Britannica, tome 4, p.303.
(97) R. Guénon : La Grande Triade, chap. XVII.
(98) Au cours de ces brèves recherches, certaines réalités d’ordre traditionnel nous ont paru « s’incarner », d’un continent à l’autre, et de façon parfois fort exemplaires, dans les vicissitudes événementielles de tel ou tel pays. Notons cependant qu’il serait inexact, malgré l’usage actuel, de parler d’une confirmation de la Tradition par la science historique. Loin de confirmer la Tradition, l’Histoire, lorsqu’elle tombe juste, ne fait que l’illustrer.
(99) Serait-elle « terrifiante » parce qu’on en pressent la ruine catastrophique ?
(100) Selon Segond. La Bible Osty traduit « inférieur ».
(101) Selon un commentaire de la Bible de Jérusalem que nous trouvons cité dans la Bible Osty, « les métaux sont énumérés par ordre de valeur décroissante : c’est que l’auteur a utilisé telle quelle l’imagerie des vieilles spéculations indo-européennes et mésopotamiennes sur les âges du monde, mais sans insister sur la dégénérescence absolue ou cyclique de l’humanité ». Comme il est peu probable que l’on reproche ici au prophète Daniel son manque d’insistance, faut-il supposer au contraire que l’on entende minimiser son propos en lui faisant emprunter « telle quelle », comme une simple fioriture en somme, une « imagerie » vieillie et peut-être quelque peu entachée de superstition ? Mais l’image en question, qui, loin d’être une « imagerie », n’est autre qu’un symbole, est ici parfaitement claire, et il est bien difficile d’y soupçonner autre chose que ce qu’enseignent toutes les traditions vraies.
(102) Cette « argile de potier », qui est « boueuse », est une image bien choisie pour évoquer la dissolution.
(103) On mesure tout le progrès accompli depuis les temps bibliques lorsqu’on entend aujourd’hui nos « prophètes » s’exprimer à leur tour. Ainsi, « Michel Serres plaide pour une nouvelle forme de progrès : le métissage. Lorsque l’on mêle son sang ou sa culture, on ne se fait pas la guerre » (Télérama, 27 février 1991, p.10). Sans doute était-ce en désapprobation du racisme et de la « guerre du Golfe » que notre grand académicien proposait ce remède. Les Serbes, semble-t-il, passent en 1992 à l’application « patriotique » et primaire de cette généreuse idée. Le mot d’ordre est donné aux soldats, dit-on, de violer individuellement ou collectivement les femmes et les filles d’ethnies « étrangères », donc « impures », dans le but, en somme, d’en « améliorer » la race. Les témoignages de ces femmes « sont si nombreux qu’aucun doute n’est plus permis sur le caractère systématique de cette pratique, dans le cadre du plan de ‘purification ethnique’ » (Le Nouvel Observateur, 14-20 janvier 1993). Lorsque toutes les populations auront été ainsi « purifiées », la paix civile s’installera-t-elle ?
Ceci dit, et dans la foulée irresponsable de nos « évangélistes » modernes, il ne manquera jamais d’amateurs pour s’inspirer de leurs étranges stupidités, ni de malins pour y trouver prétexte à satisfaire à bon marché leurs instincts les plus bas.
(104) Cette longue révolte eut lieu au milieu du deuxième siècle avant J.-C.
(105) Les quelques notations historiques sont prises dans la Bible Osty, pages 1877-1901.
(106) Flatterie bien innocente et prudence naturelle à l’égard d’un grand souverain dont dépendait la sauvegarde de Daniel et de tout son peuple, et qui, du reste, n’était que très relativement trompeuse, puisqu’en vertu de la détérioration graduelle des choses, on peut toujours considérer le présent comme plus heureux et plus brillant que les époques suivantes.
(107) Sur les 6 versets consacrés aux quatre « royaumes » (II:38-43), les 3 derniers versets sont réservés au mélange, celui du fer et de l’argile, et celui qui se fera « par de la semence d’homme », au cours de la phase ultime du quatrième « royaume ».
(108) Est-il possible d’admettre aussi que les prévisions de l’auteur s’étendent du début du règne de Nabuchodonosor (-604) jusqu’à la fin des temps (1999, dans notre hypothèse) ? Le nombre des années écoulées dans ce cas (2.603 ans) ne différerait guère de 2.592, durée d’un cinquième de la Grande Année, que l’on pourrait alors prendre en considération en admettant que le règne de Nabuchodonosor ait commencé 11 ans plus tard, c’est-à-dire en 593, ou bien qu’il s’agisse là tout simplement d’un moment important de son règne.
(109) « Alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or, furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s’échappe d’une aire en été ; le vent les emporta, et nulle trace n’en fut retrouvée » (Daniel, II:35, traduction de Segond). N’est-ce pas là une bonne image de la dissolution finale ?
(110) Raoul Auclair est de ceux qui ont étudié Le Songe de Nabuchodonosor, et, selon R. Guénon, « outre les quatre parties de la statue qu’on fait correspondre respectivement aux quatre empires, assyrien, perse, macédonien et romain, il considère les pieds ‘de fer mêlé d’argile’ comme formant une cinquième partie distincte, qui se rapporterait aux temps actuels, et les raisons qu’il en donne paraissent assurément très plausibles » (Comptes Rendus, p.175). Nous n’avons pas lu, quant à nous, cet article de R. Auclair, paru en 1947 dans la revue L’Age d’Or.
(111) Notre étude ne pouvait tenir compte de ces cycles sans s’alourdir exagérément. Et d’ailleurs, R. Guénon attire l’attention sur la difficulté, sinon même l’impossibilité, de pareille entreprise. « Nous ne pensons pas, écrit-il, qu’il soit possible d’établir un ‘synchronisme’ général, car, pour des peuples différents, le point de départ doit être également différent » (Formes traditionnelles et cycles cosmiques, p.29). A cela s’ajoute la difficulté de préciser ce qu’est un peuple, son origine véritable et son extinction. Il n’empêche que chaque peuple, par le fait même de vivre dans les limites de notre Manvantara, se trouve, à sa manière particulière, sous l’influence de ses lois cycliques.
(112) Nous utilisons ici le terme de « race » dans un sens très large, puisque dans ce changement c’est toute la famille humaine, déjà marquée par le Kali-Yuga, qui bascule dans une dernière phase de « densification » trompeuse car rongée par une « dissolution » de plus en plus manifeste pour qui sait voir dans les événements.
(113) Platon aborde brièvement le sujet à la fin du Critias. C’est un sujet dont on rencontre bien des échos et des exemples, depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Il semble qu’une grandeur indue se trouve toujours affligée d’une précarité proportionnelle à ses excès. « La Roche Tarpéienne est proche du Capitole », disait-on à Rome. On n’a cessé de le rappeler depuis. Tout expansionnisme se voit sanctionné par une régression d’un genre ou d’un autre. Tout excès comporte en soi son châtiment. Mais plus nous approchons de la Fin, et moins les hommes paraissent résister aux tentations de la démesure.
(114) Tel est le cas de Jurgen Spanuth qui, dans son ouvrage L’Atlantide retrouvée (1954), situe l’île célèbre dans la mer du Nord, où ses vestiges subsisteraient, par quelques mètres de fond et parfaitement visibles, à 8 km à l’est d’Heligoland. Les pêcheurs en connaissent bien les antiques murailles au pied desquelles ils viennent prendre leurs homards.
(115) C’est évidemment l’inverse qu’il faut faire aujourd’hui, si l’on veut être dans le ton. Ainsi, certains de nos plus médiatiques historiens ne craignent pas d’obéir à des modes actuelles, des théories pour le soins douteuses, y voyant l’explication d’époques lointaines dont l’esprit, de ce fait, dans ses expressions les plus signifiantes, leur échappe presque toujours totalement.
(116) Sans doute la fin des Atlantes, qui touche au début de la cinquième et dernière grande Race de l’humanité, a-t-elle été un avertissement salutaire entendu par les tout premiers humains de cette Race terminale, mais il est évident qu’aujourd’hui seuls quelques-uns de nos contemporains y trouveront matière à réflexion. Peut-être cet obscurcissement de la conscience s’est-il produit à partir du début du Kali-Yuga. Toujours est-il que les erreurs atlantes, la propension au gigantisme, à l’expansion, à l’auto-glorification, tous ces vices humains, nous les avons faits nôtres, et que maintenant ils sont près d’anéantir toute vie sur la planète. Or avant que toutes les âmes soient également anéanties, les Puissances célestes mettront un point final à la carrière de cette humanité déchue, devenue nocive à elle-même et à tout ce qui l’entoure.
(117) René Guénon : Formes traditionnelles et Cycles cosmiques, p.49.
(118) Le Règne de la Quantité, p.45.
(119) « The Carboniferous Mystery », Vol.162, Scientific American, January 1940.
(120) « Thunder In His Footsteps », Natural History, May 1939.
(121) Pourquoi des Indiens ? S’agirait-il d’artistes facétieux ligués dans un mouvement national pour ridiculiser et discréditer la science des Blancs ? La réalisation de tels faux nécessiterait en effet une entreprise de quelque ampleur, car ces empreintes ou « sculptures » mystérieuses se rencontrent fréquemment, parait-il, dans les strates les plus anciennes.
A propos de ce genre d’empreintes, René Guénon, quant à lui, pense que, « d’une façon générale », elles « représentent la ‘trace’ des états supérieurs dans notre monde » (Initiation et Réalisation spirituelle, p.238, note). Il y aurait d’ailleurs beaucoup à dire sur les empreintes de pieds que les hommes ont laissé dans le roc.
(122) Il ne manque pas de scientifiques sérieux pour réprouver ces « méthodes », qui sont celles de la mauvaise foi. Mais tout se passe comme si l’on avait affaire à une conjuration tout à fait générale dont le but serait d’étouffer les quelques restrictions honnêtes qui tentent de se faire entendre. Lisez par exemple le no 15 de la revue Totalité qui dénonce « Un crime contre l’Humanité : le Darwinisme » : vous serez édifié, au moins en ce qui concerne cette fable. N’oublions pas non plus la malodorante affaire de Glozel, où bien des « autorités » ont été compromises.
(123) Les grandes conjonctions, p.19. Cette « apparition » de l’homme, à laquelle l’auteur semble avoir voulu conférer quelque sens spécial, pourrait correspondre à la « sortie du Paradis terrestre » en 36.880,23, mais comme il spécifie ensuite « vers 30.000 ans avant J.-C. », cela pourrait correspondre à notre date de 30.400,23 et, dès lors, à une « mutation » de la troisième Race, et donc aussi de notre humanité.
(124) Et pourtant nous avons, en nos temps « vieillis », un exemple quotidien de cette souple « fluidité » des « jeunes » temps : tout le monde voit bien que les enfants jouissent d’une élasticité dont sont totalement dépourvues les personnes âgées.
(125) R. Guénon : Le Règne de la Quantité, p.113-115. Nous ne saurions mieux faire ici que de renvoyer à cet ouvrage magistral qui traite, dans son chapitre XVII, de la « solidification du monde ». On ne relit jamais assez de tels écrits.
(126) Ibid., chapitre V, p.47-48.
(127) Ibid., p.115-117.
(128) Ibid., p.128-132.
(129) Ibid., p.130.
(130) Tout se passe comme s’il en allait de même chez les humains : ceux-ci, dans l’ensemble de leur vie, vieillissent d’une manière régulière, ce qui n’empêche pas qu’ils « descendent », de temps à autre, d’un « palier » à un nouveau « palier », chaque fois plus « durs », plus fragiles, plus « cassants », plus proches de leur fin.
(131) Ibid., p.118.
(132) Ibid., p.116.
(133) Ibid., p.257-258.
(134) Autorité spirituelle et Pouvoir temporel, p.46, note.
(135) Ibid., p.46.
(136) Ibid., p.20, note 1.
(137) Ibid., p.20.
(138) R. Guénon aborde une fois de plus le sujet dans un article de 1936 où il relate une tradition grecque concernant la chasse au sanglier dans la forêt de Calydon. Mais il reste fidèle à ses autres commentaires, et précise bien que cette chasse n’est qu’une « figuration », d’ailleurs tendancieuse, de la révolte des Kshatriyas (Symboles fondamentaux de la Science sacrée, p.161).
(139) Aperçus sur l’Esotérisme chrétien, p.70, note.
(140) La tradition hébraïque, pour sa part, traduit la « coupure » dont nous parlons par l’image des Kerubim qui gardent, à l’Orient, l’accès de l’Arbre de Vie. Si l’on se rappelle que ces Kerubim sont, comme le dit Guénon, « les ‘tétramorphes’ synthétisant en eux le quaternaire des puissances élémentaires » (Le Symbolisme de la Croix, chapitre IX), on comprendra mieux, même en dehors de toute évocation « spectaculaire », la fracture immense que cela peut impliquer.
(141) C’est qu’en effet on peut regarder « autour » de soi sans qu’il y ait « extériorisation » à proprement parler. Il s’agit alors d’un regard qui franchit l’extériorité des choses et des gens sans s’y attarder, du simple fait qu’il vise à atteindre l’essentialité, le centre de ces choses ou de ces gens. Un tel regard, où qu’il se porte, est toujours pénétré d’intériorité.
(142) Revue Etudes Traditionnelles, 1979, p.41-42. Certes, d’aucuns pourraient peut-être souhaiter quelque chose de plus clair, mais il n’est guère possible, nous semble-t-il, d’être tellement plus clair sur un pareil sujet. Ces lignes, en tout cas, viennent ici à propos pour renforcer nos dires et rappeler quelques points sur lesquels nous avons insisté.
(143) Ce n’est qu’après leur sortie du Paradis qu’Adam et Eve engendrent Abel et Caïn. Or Fabre d’Olivet fait au sujet des deux frères quelques réflexions qui ne manquent pas d’intérêt. Pour lui, Abel et Caïn sont des « êtres cosmogoniques » exprimant ces deux grandes forces universelles que sont l’ « expansion » et la « compression » (La Langue Hébraïque Restituée, II, notes p.124 et suiv.). En outre, Caïn est le champion de la Volonté lorsque celle-ci se dresse contre la Providence. Or « l’homme volitif, tant qu’il persiste dans sa volonté propre,(…)ne doit point approcher de l’autel en qualité de pontife ; sa place est au camp ». Cependant, devant le refus de son sacrifice, « son orgueil se révolte » et il tue alors Abel, « l’homme providentiel » et religieux. Pourtant, les deux hommes pourraient « produire, par leur réunion, la perfection de la nature humaine ». Mais Lucifer « s’oppose à cette réunion » (Caïn, de Lord Byron, p.240-242, dans « Remarques philosophiques et critiques »).
R. Guénon note que le nom de Qaïn exprime la possession, sens dérivé de l’hébreu qan qui est le pouvoir matériel (Le Roi du Monde, p.54). Caïn pourrait donc bien représenter le pouvoir royal en révolte contre l’autorité spirituelle. Le premier fratricide, le premier « sang » versé, remonteraient-ils à l’an 30.400,23 de nos cycles ?
(144) Et R. Guénon précise en passant que cette dégénérescence est « possible principalement en Occident » (Autorité spirituelle et Pouvoir temporel, p.55). Bien entendu, au Trêtâ-Yuga, cela semble s’être traduit, au début du moins, de façon sensiblement différente.
(145) La « suprématie est attachée à l’essence même de l’autorité spirituelle et lui appartient tant qu’elle subsiste régulièrement, si diminuée qu’elle puisse être en elle-même, la moindre parcelle de spiritualité étant encore incomparablement supérieure à tout ce qui relève de l’ordre temporel » (Ibid., p.83-84).
(146) Celle-ci succède à la « terre du sanglier », comme la prédominance des Kshatriyas succède à celle des Brâhmanes, et sans doute aussi comme la Grande Ourse a fini par désigner la constellation polaire que désignait tout d’abord le sanglier (Guénon : Symboles fondamentaux de la Science sacrée, p.179-180). On raconte encore que Parashu-Râma a totalement exterminé les Kshatriyas, mais que leur caste renaîtra par les enfants qu’engendreront les Brâhmanes aux veuves des guerriers disparus.
(147) Ibid., p.189.
(148) Ibid., p.195. On voit combien toutes ces considérations touchent notre sujet : « condensation » et « dissipation », yin et yang, « expir » et « aspir », ne sont-ils pas en correspondance étroite avec les phases respectives de « solidification » et de « dissolution » dont s’occupe notre présente étude ?
(149) Ibid., p.215.
(150) Formes traditionnelles et cycles cosmiques, p.49, note.
(151) Symboles fondamentaux…, p.203.
(152) Nous avons fait toutes les réserves qui convenaient au sujet de nos propres datations, et à plusieurs occasions.
(153) Revue Etudes Traditionnelles, 1972, p.236-237.
(154) « The Earth’s Magnetism », dans Scientific American, septembre 1955.
(155) Ces renseignements sont pris aux pages 162-163 dans le livre d’Immanuel Velikovsky, Les grands bouleversements terrestres, traduit pour la Librairie Stock par Collin Delavaud à partir de l’ouvrage original, Earth in Upheaval (1955). Cet ouvrage, qui cite « des témoignages fournis par les roches »(p.8), vient confirmer les références à la littérature ancienne que contient un premier livre, Mondes en collision (Stock, 1951), traduit de Worlds in collision (sept. 1950). Ces ouvrages ont rencontré un intérêt certain auprès de diverses personnalités scientifiques et autres, « alors que l’atmosphère des milieux académiques était généralement empreinte d’animosité » (p.13), ce qui se comprend aisément.
(156) Pour la description des phénomènes, nous devons nous contenter de renvoyer aux livres d’I. Velikovsky, lesquels proposent du reste une cause plausible à ces inversions magnétiques d’une intensité nettement supérieure à l’ordinaire. Une cause qu’il n’est pas possible de faire intervenir « à volonté », que ce soit en laboratoire ou ailleurs.
(157) « L’inclinaison de l’axe terrestre (…), d’après certaines données traditionnelles, n’aurait pas existé dès l’origine, mais serait une conséquence de ce qui est désigné en langage occidental comme la ‘chute de l’homme’ » (R. Guénon : Formes traditionnelles et Cycles cosmiques, p.36, note). En effet, l’ordre humain et l’ordre cosmique réagissent constamment l’un sur l’autre, d’où « la relation qui existe entre certaines phases critiques de l’histoire de l’humanité et certains cataclysmes » (R. Guénon : Le Règne de la Quantité, p.113).
(158) Il s’agit de cette migration qu’évoque Michel de Socoa dans Les grandes conjonctions (p.19), et qui devait avoir pour résultat de transmettre aux Atlantes les éléments vivifiants de la tradition primordiale.
(159) « Les dualités cosmiques », dans la revue Etudes Traditionnelles, 1972, p.60,100.
(160) Ibid., p.4-6.
(161) Ibid., p.56.
(162) Peut-être ces phénomènes sont-ils surtout le fait des jeunes (« pèlerinages » en foules, ou manifestations estudiantines), mais on les rencontre aussi parmi les personnes âgées (voyages organisés pour le troisième âge…). Ces troupes se réunissent sous la sauvegarde d’ « animateurs » qui leur donnent ou leur rendent une « âme », aussi passagère soit-elle. Cette fusion dans un tel succédané d’unité serait-elle comme la caricature de la véritable unité ontologique à laquelle chacun aspire sans le savoir, et où tout être se trouve fondu mais non confondu ? Dans ces rassemblements de troupes dont nous parlons, ne serait-on pas, bien plus souvent, « confondu sans être fondu » ?
Ce retour à l’indifférenciation et cette régression de l’individualisation qui l’accompagne n’expliqueraient-ils pas, d’une certaine manière, le succès des théories et des injonctions « communistes » qui se sont répandues dans le monde depuis la fin du XVIIIè siècle ? Ne faudrait-il pas voir en « Gracchus » Babeuf, avec son « babouvisme », un des précurseurs de ces dangereuses chimères ?
(163) La Grande Triade, p.55-59. Il est utile de rappeler ici que les termes d’essence et de substance, ou plus encore, sans doute, les adjectifs essentiel et et substantiel, peuvent très bien en contexte cosmologique, être utilisés, non pas en leur sens propre, mais analogiquement (R. Guénon : L’Homme et son devenir selon le Vêdânta, p.78, n.1). On le constate, par exemple, quand on parle des tanmâtras et des bhûtas. Si les bhûtas sont nommés « déterminations substantielles » du fait qu’ils appartiennent au domaine corporel, très relativement « proche » de la Substance universelle, les tanmâtras, bien qu’appartenant à la manifestation subtile, très « éloignée » de l’Essence universelle mais plus « proche » d’elle que le domaine corporel, sont considérés comme des « déterminations essentielles » (R. Guénon : Etudes sur l’Hindouisme, p.46-47). C’est ainsi, écrit Guénon, que « le rapport des tanmâtras aux bhûtas est, à son degré relatif, analogue au rapport de l’‘essence’ à la ‘substance’, de sorte qu’on pourrait assez justement donner aux tanmâtras la dénomination d’‘essences élémentaires » (L’Homme et son devenir…, p.76). C’est évidemment aussi par analogie que l’auteur, dès 1912, dans la revue La Gnose, présentait ces « essences élémentaires » comme « non manifestées » (Mélanges, p.109). On accorde également une large extension à la signification du terme de principe. Par exemple, Brahma est le Principe suprême, alors que c’est à un degré beaucoup plus modeste que les tanmâtras sont les « principes » des bhûtas (L’Homme et son devenir).
(164) Revue Etudes Traditionnelles, 1972, p.97-98.
(165) Inferno, XXXIV, v.110-111 : « Le point vers lequel de toutes parts, les poids sont attirés », selon la traduction de A. Brizeux, publiée par l’Ambassade du Livre.
(166) Si l’on tient compte de ces diverses remarques, on comprend que ce soit au milieu d’un cycle que les corps humains, et sans doute aussi ceux des animaux et des végétaux, sont le plus pondéreux. Curieusement ( ?), en juin 1996, nous avons entendu dire autour de nous, dans un climat spécifiquement féminin, que la mode était « en ce moment » aux dames « potelées » : or 1996,53 est justement la date médiane du petit cycle 1993,29-1999,77, et correspond au mois de juillet.
(167) L’Esotérisme de Dante, p.70-72.
(168) Etudes Traditionnelles, 1972, p.58-59.
(169) A la fin de notre Manvantara, qui correspond au tournant médian de notre Kalpa, se mêlent donc passagèrement « solidification » et « dissolution ». Ne pourrait-on en trouver l’image dans la dureté et la mollesse, l’exigence et la permissivité qui ruinent la stabilité de nos sociétés ?
(170) Il y a une préfiguration de l’esprit de révolte, dans le monde angélique, lorsque Lucifer refuse de s’incliner devant la supériorité d’Adam : cet orgueil est la marque d’un égocentrisme forcené, et cette affirmation outrageuse d’individualisme, preuve de densification, entraîne la chute de l’Archange. Autre insubordination : Eve, mue par le « serpent » (= nahash = force compressive, selon Fabre d’Olivet), désobéit à l’ordre divin par curiosité, convoitise ou concupiscence, mais quoi qu’il en soit, c’est un besoin de s’approprier quelque chose de plus, d’acquérir, en fait, plus de compacité, et cette densification cause la « chute » du premier couple humain.
(171) R. Guénon : L’Homme et son devenir, p.156, n.2 ; L’Erreur spirite, p.118 ; 210, note. Ibn ’Ata’ Allâh : Traité sur le nom Allâh (introduction, traduction et notes par Maurice Gloton), p.153. Outre les exemples d’Henoch, de Moïse et d’Elie, on pourrait citer celui du Christ Jésus. Dans ce genre de phénomènes, comme le remarque R. Guénon, « il n’y a pas de mort à proprement parler ».
(172) « L’individualité humaine, même dans ses modalités extra-corporelles, doit forcément être affectée par la disparition de sa modalité corporelle » (R. Guénon : L’Homme et son devenir, p. 151, note).
(173) Ce ne sont pas des « sciences occultes » ! Honni soit qui mal y pense !
(174) Maurice Schumann ne publie-t-il pas son ouvrage Bergson ou le retour de Dieu (1995) ? Le retour de Dieu avec Bergson qui fut président de la Society for Psychical Research ? Cela ne manquera pas d’intérêt !
(175) Si ce n’est pas le Non-manifesté, c’est du moins, à un niveau beaucoup plus bas, ce qui « y correspond en un sens relatif » (R. Guénon : La Grande Triade, p.56). Il est évident qu’en tout cela, il ne faut pas confondre la « dissipation » des « composés individuels » sous l’influence de l’ « attraction du Ciel », tout à fait générale en fin de cycle, avec quelque « promotion » spirituelle que ce soit.
(176) Elle est spectaculaire chez certains médiums, par exemple au cours de l’émanation d’un ectoplasme, mais les autres participants en sont également affectés, bien que dans une moindre mesure.
(177) En fin d’expérience, les divers éléments retournent normalement à l’organisme dont ils ont été momentanément « détachés », mais il semble aussi que certains éléments puissent rejoindre des organismes qui leur sont étrangers. En ce dernier cas, il y aurait « perte » pour des assistants, et « acquisition » indue pour d’autres. Alors, si les transferts revêtaient une certaine importance, cela n’irait pas sans quelque altération de l’identité psychique, voire corporelle, chez les uns et les autres. D’ailleurs, les pratiques spirites présentent bien d’autres dangers physiques, psychiques et même intellectuels (R. Guénon : L’Erreur spirite, p.385-397).
(178) En 1986, dans le Royaume-Uni, sévit une épidémie inconnue parmi les vaches : elles sont atteintes de ce que l’on appelle une « encéphalopathie spongiforme bovine ». On en a décelé la cause dans le fait que l’élevage moderne utilise, pour nourrir les bovins, des farines à base de sous-produits d’abattoir contaminés par des restes de moutons malades de la « tremblante ». Les causes de l’épidémie, trop lucratives sans doute, n’ayant pas été supprimées, il faut en 1996 abattre, dans le royaume, des millions de vaches atteintes. Coût pour enrayer la crise : plus d’un milliard de livres cette année. Mais il faudra poursuivre cet effort dans les années qui viennent. L’Europe y participera. En attendant, l’épidémie se répand en France, dit-on, depuis 1991. De même, en 1988, en Espagne, peste équine et peste porcine déciment le bétail. Des cas de la seconde se sont rencontrés en France et en Belgique, nécessitant des abattages massifs. Ces deux maladies nous viennent d’Afrique.
(179) Des phénomènes déplaisants se produisent çà et là, sans que la Science soit en mesure de les comprendre. On cite par exemple des cas de plus en plus nombreux de mort subite de nourrissons en bonne santé. Ce mystère commence à frapper l’opinion publique dès le début de 1994. Une association s’occupe déjà de la recherche concernant ce phénomène nouveau que les médecins n’expliquent pas. Comme la mortalité n’est pas tout à fait de 2 sur 1000, le financement des pouvoirs publics dans ce domaine de la recherche est assez limité.
(180) « Il existe également des filles, ajoute le professeur, qui sont au régime à longueur d’année, et qui de temps à autre s’offrent un bon repas, mais elles se font aussitôt vomir. Cette ‘mode’, venue des Etats-Unis(…), fait des ravages, comme une épidémie », car ces demoiselles se communiquent la recette.
(161) Tous ces avis sont extraits de l’article de Marie-Thérèse Guichard, « La dictature du poids », dans Le Point, 16 avril 1994.
(182) La tuberculose est actuellement en recrudescence, sous une forme nouvelle, et l’on sait que c’est une maladie qui ronge. Dans le cas de la myopathie, ce sont les muscles qui fondent peu à peu. Le SIDA, qui se répand de nos jours, est une maladie au cours de laquelle le corps, progressivement privé de ses systèmes de défense, se voit envahi par divers éléments étrangers provoquant toutes sortes d’affections. La déperdition des forces entraîne un amaigrissement typique. En Ouganda, on appelle le SIDA « slimo », la maladie de la maigreur, celle qui ronge. Ce qui conduit à peu près certainement à la mort.
(183) Ce sont en tout cas les impressions que nous retirons d’un article d’Annick Colonna-Césari (L’Express, 21 octobre 1993).
(184) La tendance à réduire les corps à leur plus simple expression lorsqu’un cycle tire à sa fin, pourrait trouver son inverse, au milieu de ce cycle, dans un certain culte de l’embonpoint qui correspondrait au moment culminant de la densification corporelle. Nous n’en avons pas recherché d’exemples de manière systématique, mais nous en avons peut-être rencontré qui pourraient être significatifs. Le premier concerne l’an 1675,77, date médiane du cycle moderne (1351,77-1999,77), et donc importante puisque marquant le tournant central de 648 années d’Histoire. Or autour de cette date, à la cour de Louis XIV, modèle de l’Europe, la mode voulait que les dames eussent des formes plantureuses. Autre exemple : 1986,81 est le milieu d’un petit cycle secondaire (1980,33-1993,29), et c’est vers cette date que triomphe la pulpeuse Marthe Lagache, bien connue des téléspectateurs en raison des films publicitaires qu’on lui consacre et de ses créations dans la mode de la chaussure qu’elle a été invitée à présenter à Tokyo. Ceci dit, il nous paraît bien difficile de s’y reconnaître en ces derniers temps où se bousculent les dates médianes et les dates finales de sous-cycles de plus en plus restreints. Et il reste encore que la pulpeuse Marthe Lagache puisse très bien inspirer le désir d’un « retour à la terre matricielle », comme d’ailleurs les dames potelées de 1996,53 que nous avons citées plus haut (note 166).
(185) Peut-être n’est-il pas d’usage de parler de « maladie » ou de « mort » pour les roches. Mais elles se désagrègent.
(186) De bons bergers s’en indignent, tout consumés d’amour, et brandissent des foudres dont on ne sait guère s’ils entendent les emprunter à leur Divinité ou à saint Marx. Ainsi a-t-on entendu le pasteur Jean-Paul Perret, le 26 février 1989, faire cette promesse : « Dieu enlèvera aux nantis pour donner aux pauvres ».
(187) C’est qu’il existe des exceptions. Quelques riches, haineux ou sots, sont prêts à abandonner leur fortune à des aventuriers à la seule condition que ceux-ci détruisent l’ordre ancien. Mais moins rares, peut-être, sont les pauvres qui préfèrent conserver cet ordre, car, en connaissant bien les détours, ils ne désespèrent pas de s’y diriger vers une situation enviable.
(188) On ne saura sans doute jamais si tous ces gens, d’un parti ou d’un autre, auraient été un jour capables de gouverner à proprement parler, autrement qu’en répandant ou en laissant répandre des flots de sang. Nous savons, en revanche, par des exemples quotidiens, sur quelles voies s’acheminent, en raison du Progrès, toutes ces belles républiques « démocratiques » dont se toque le monde moderne.
(189) Cela n’a rien d’un débordement ou d’une effusion : c’est, au contraire, un accaparement, un accroissement de puissance entre les mêmes mains, qu’il s’agisse d’un individu ou d’un groupe.
(190) Étrange liberté qui, depuis 1968, et après 1789, se veut « éclatement », et y réussit parfois, avec ou sans drogue, dans la désintégration progressive du psychisme et de la chair.
(191) Cette dissolution générale, que nous avons vue à l’oeuvre dans les corps, s’exprime évidemment aussi dans la décomposition morale dont témoignent la corruption, la criminalité et la déliquescence généralisées, décomposition que favorisent le laxisme et la lâcheté morbides de nos sociétés. La psyché, séparée de son pôle spirituel recteur, s’animalise, se bestialise chez certains individus. Chez d’autres, elle s’affaiblit, se dissout en quelque sorte devant l’adversité, ce qui, par désespoir, peut conduire au suicide. On cite quelques exemples au sein du Pouvoir. Mais qui dira les milliers d’autres cas dont les médias ne signalent rapidement que quelques-uns faute de place, faute d’intérêt aussi pour des misères qui se dissimulent dans la médiocrité, et où le drame survient à cause du chômage, de la maladie, des « tracasseries » administratives ou policières s’exerçant à l’encontre de gens sans défense au pays hypocrite des « droits de l’homme » ?
(192) Mais qu’il soit question de retenue ou d’impudence, il y a longtemps que ces attitudes sont sans le moindre rapport avec la morale d’antan.
(193) On pourrait même se rappeler ici les phénomènes de l’embonpoint et du décharnement dont nous avons parlé. Comme si, vers la fin des temps, la corpulence et le conservatisme que représentent les « vieux », devaient céder la place à la maigreur et à l’audace plus ou moins inconséquente qu’incarnent les chats de gouttière et que représentent alors les « jeunes » aventuriers du Progrès.
Il va sans dire qu’à travers l’Histoire, et surtout, répétons-le, dans les derniers temps, toute application de la doctrine des deux tendances adverses ou complémentaires est rendue particulièrement délicate en raison de l’entrecroisement et du chevauchement des cycles principaux avec leurs cycles secondaires, telle période de condensation pouvant recouvrir une phase de dissipation, mais sans cependant la rendre nulle et inopérante.
En outre, il ne faut pas oublier que c’est toujours et avant tout de cette condensation et de cette dissipation qu’il s’agit sous les diverses mots qui les illustrent et parfois les masquent. Ainsi, au milieu du cycle, l’embonpoint, en dépit de sa dilatation apparente, doit être entendu comme une densification, une condensation, alors qu’à la fin du cycle, l’enflure, en dépit de son énormité impressionnante, provoque au contraire une perte de densité, une dispersion des divers éléments en jeu, une dissipation, et c’est ce qui fragilice l’enflure en question.
(194) « Cela sent mauvais », disaient jusqu’ici, dans certains cas, les moins éveillés. Mais depuis 1993, un consensus de plus en plus large reconnaît, de façon définitive et quelque peu résignée, que la « pourriture », maintenant, règne « partout ».
(195) Cette corruption, cette transformation d’une circonstance ou d’un état en son « contraire », on en trouve un exemple dans le passage de la vie à la mort, de l’organique à l’inorganique : nous le constaterons aussi dans la déchéance qui se révèle progressivement au sein des castes, d’abord, puis, plus tard, dans des catégories sociales qui, avec le progrès du temps, n’en sont plus que des parodies.
